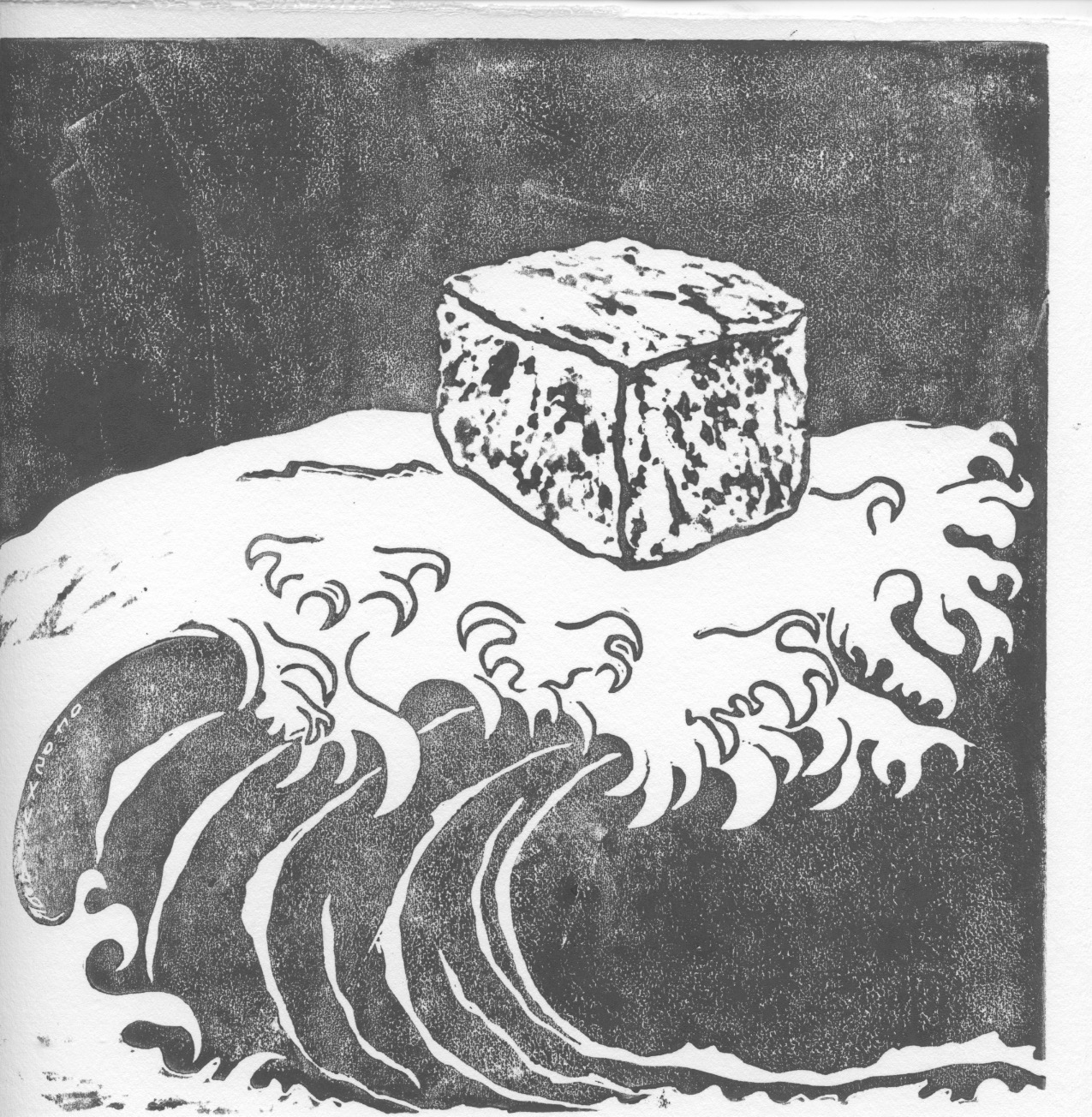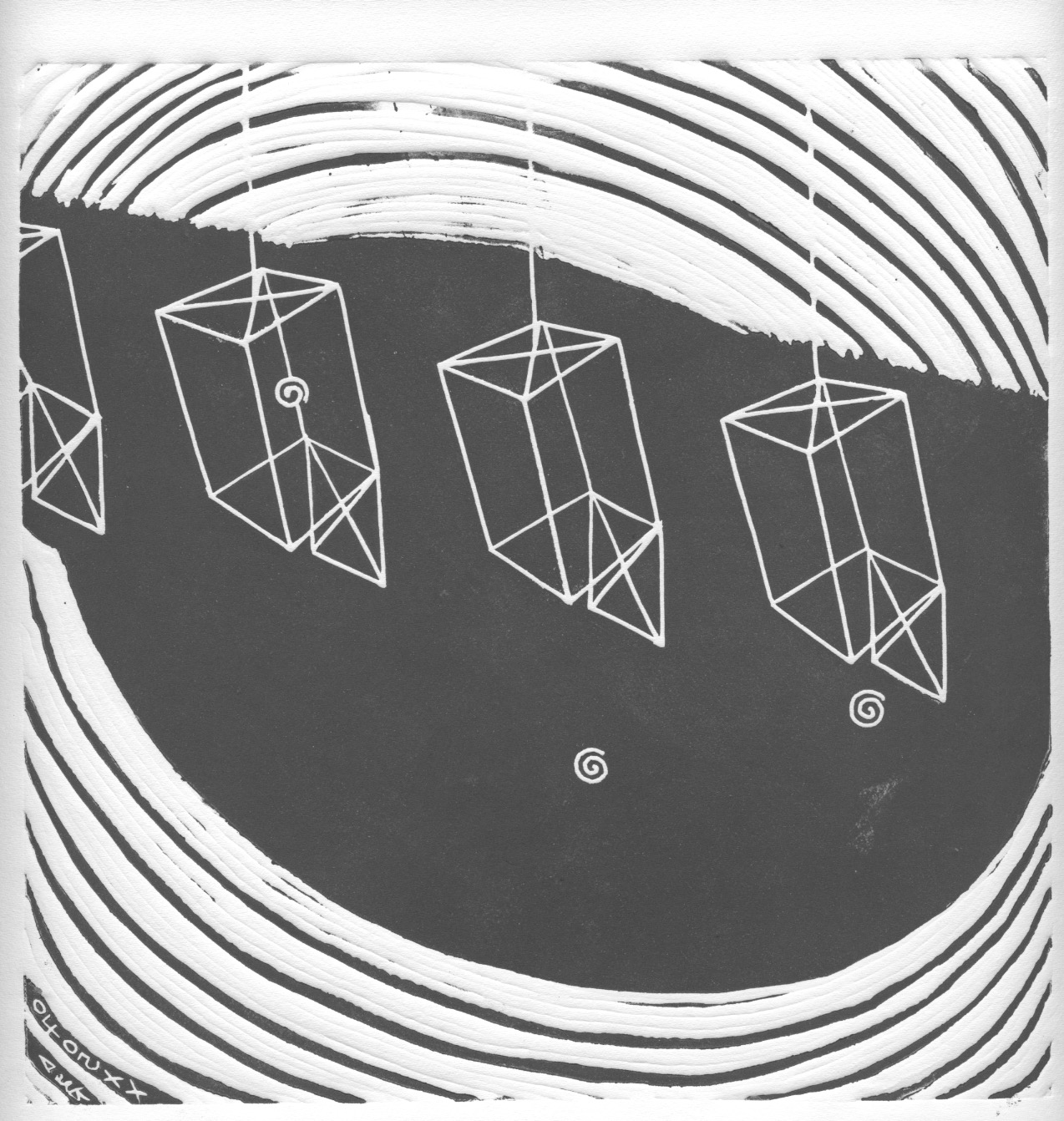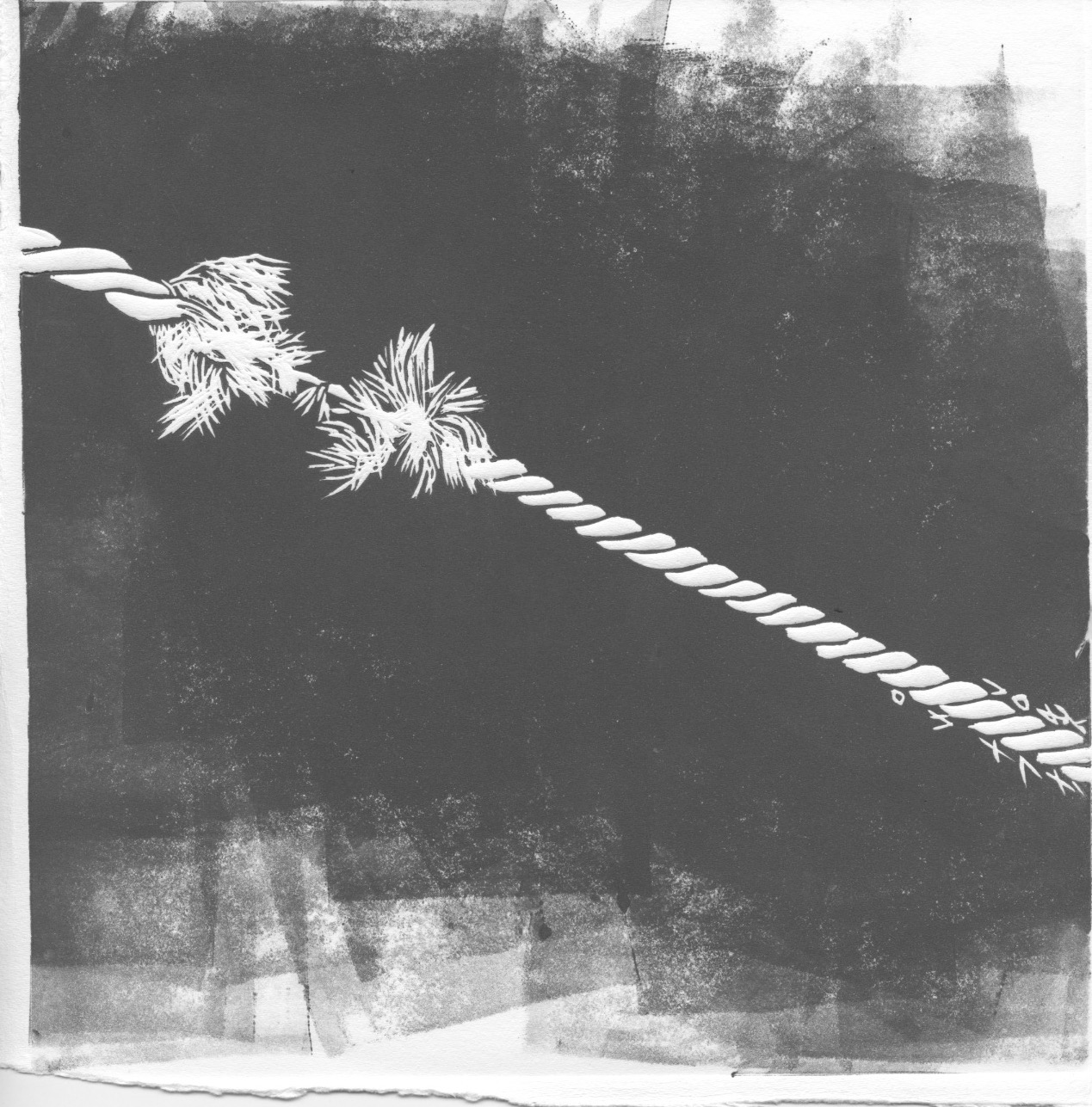A SUIVRE
A propos de virus (III) : « Primum Non Nocere » ? « Si vis Pacem para Bellum » ! Sur la prolifération biosécuritaire…
Si elle continue, à l’image de sa cousine porcine, son « bonhomme de chemin », encore récemment un peu partout en Inde , en Europe et ces jours derniers en Afrique, la grippe aviaire n’a pourtant pas encore tenu toutes ses « promesses pandémiques » telles que résumées, entre des milliers d’autres, par un article (de 2006) de l’Institut National de Recherche et de Santé : « Jamais le monde n’a été aussi proche d’une nouvelle pandémie grippale puisque toutes les conditions préalables sont réunies, sauf une : l’établissement d’une transmission interhumaine efficace ». En l’occurrence l’apparition de nouveaux variants plus transmissibles, ainsi récemment chez les porcs et leur transmission effective quoiqu’encore occasionnelle des volailles aux humains, comme en avril en Chine, ou la fuite en avant dans l’industrialisation de la production, qui se fait en Asie au détriment de basses-cours présentées comme havres de toutes les infections ( pour une synthèse critique sur ce point : voir notamment Natalie Porter, « Risky Zoographies: The Limits of Place in Avian Flu Management« ), et son encadrement « sanitaire » ( vaccinations, antibiotiques, etc) laissent présager de nouveaux développements prometteurs…
Pronostic qui ne sort pas de l’ordinaire puisque depuis quelques décennies déjà, pour ce qui est des pandémies, dans le discours public, la question n’est plus « si » mais « quand » et « où ». Ainsi on pourrait dire du Covid-19, qu’il est probablement le fléau le mieux annoncé de l’histoire d’une espèce qui n’a pourtant eu de cesse que de prédire Apocalypse, Armageddon et autres « Fin des temps ». C’est qu’illustre par exemple le vaste ensemble d’ouvrages prophétiques écrits à ce sujet ces dernières années, et ce pour tous les goûts, que ce soit sur le mode du récit de « virologue baroudeur » comme The Viral Storm. The Dawn of a New Pandemic Age de Nathan Wolfe ou Spillover. Animal Infections and the Next Human Pandemic de David Quammen; de l’avertissement d’épidémiologistes sur le pied de guerre comme Deadliest Ennemy. Our War Against Killer Germs de Michael Osterholm et Mark Olshaker ou Pandemic. Tracking Contagions From Cholera to Ebola and Beyond de Sonia Shah ; ou d’ouvrages moins « sensationnalistes » et souvent plus instructifs que ce soit sur les tendances de long terme ( An Unnatural History of Emerging Infections de Ron Barrett et George J. Armelagos sur lequel on reviendra dans un post sur la « troisième transition épidémiologique ») ou sur le jour le jour de la veille pandémique ( Les sentinelles de pandémies de Frédéric Keck).
Si la toute fin du XXe, et les débuts de la grippe aviaire et l’orée du XXIe siècle, avec l’épidémie de SRAS, ont certes fourni un terreau suffisant au développement des inquiétudes « biosécuritaires », celles-ci remontent toutefois à un peu plus loin. On pourrait grossièrement distinguer plusieurs phases dans l’histoire de la perception des risques liés aux maladies infectieuses en Occident depuis 1945 avec une première période où dominent encore les peurs d’attaques bactériologiques associées à la guerre froide à laquelle succède une longue phase d’un optimisme amplement justifié, la prévalence de maladies infectieuses telles que le paludisme, la tuberculose, la diphtérie, la poliomyélite ou la rougeole, etc, s’écroulant littéralement dans le monde développé, et l’éradication globale de la variole étant célébrée en 1980. Un optimisme qui ira dans les déclarations (réelles ou attribuées) de plus d’une autorité médicale jusqu’au pronostic de la fin imminente « des maladies infectieuses » mais qui commencera sérieusement à être mis en doute avec l’émergence progressive du SIDA et ce, jusqu’à ce que le tournant des années 2000 ses nouvelles épizooties, zoonoses et « menaces terroristes » vienne parachever la naissance d’un nouveau paradigme.
On pourrait paradoxalement noter qu’avant même l’apparition au grand jour du SIDA ( dont on sait désormais que l’histoire remonte à « beaucoup » plus loin, voir, parmi de nombreux autres textes, Stephanie Rupp et alii « Beyond the Cut Hunter: A Historical Epidemiology of HIV Beginnings in Central Africa« ) la fin des illusions « éradicatrices », ou plutôt une nouvelle dialectique entre « éradication » et prolifération, s’est, d’une certaine manière, manifestée dès la seconde partie des années 70, via la réaction précipitée à l’apparition de la grippe porcine en 1976 et la campagne de vaccination en masse pour le moins hasardeuse menée aux États-Unis ( qui provoqua des milliers de cas du syndrome de Guillain-Barré) – qui n’est pas sans évoquer la « sur-réaction » qu’on a reproché à l’OMS face à une grippe du même type en 2009, voir plus loin- puis la « grippe russe » de 1977 dont il est désormais admis qu’elle a été le produit d’une fuite de labo, ou d’un essai de vaccination ayant mal tourné, en Sibérie ( voir notamment Michelle Rozo et Gigi Kwik Gronvall, « The Reemergent 1977 H1N1 Strain and the Gain-of-Function Debate« , qui offre une bonne synthèse des hypothèses existantes tout en essayant assez absurdement de dédouaner certaines recherches actuelles « en gain de fonction »).
Martin Furmanski dans son article « Laboratory Escapes and “Self-fulfilling prophecy” Epidemics » et Shanta M. Zimmer et Donald Burke dans « Historical perspective–Emergence of influenza A (H1N1) viruses » n’hésitent d’ailleurs pas à rapprocher directement les deux événements, la fuite de 1977 représentant un malheureux contre-coup de l’affolement de 1976 : « L’histoire du virus de l’influenza H1N1 est ponctuée par de fréquentes et sporadiques transmissions entre espèces notamment entre les porcs et les humains. Bien que les virus porcins transmis sporadiquement aux humains soient suffisamment pathogènes pour causer des maladies, ils se transmettent ensuite rarement entre humains. L’exposition et l’infection sont nécessaires mais pas suffisants pour qu’un nouveau virus épidémique émerge ; le virus doit aussi s’adapter et se transmettre. La seule grande exception à cette loi générale que les virus porcins ne se transmettent pas entre humains fut la contamination à Fort Dix [en 1976]. La virus ne s’est jamais répandu en dehors de l’installation militaire, car sa contagiosité intrinsèque était tout simplement trop faible. Pourtant la réponse globale à cet événement fut percutante, surtout compte tenu du fait que l’épidémie s’est auto-limitée. La décision de vacciner en masse la population américaine résulta en un nombre regrettable de cas de syndrome de Guillain-Barré. Une des conséquences encore plus sérieuse fut la dissémination accidentelle d’une variante adaptée à l’homme du H1N1 depuis un laboratoire [russe], menant à la résurrection et la diffusion globale de ce virus autrefois éteint, aboutissant à ce qu’on peut considérer comme une « prophétie épidémiologique auto-réalisatrice ». » ( Zimmer et Burke, P. 284). Expression qui n’a, semble-t-il, rien perdu de sa pertinence !
Malgré le cafouillage de 1976 et ses retombées ultérieures, les avertissements, toujours d’actualité, d’un René Dubos, la multiplication des zoonoses mises à jour dans les dernières décennies du XXe siècle ( citons parmi les « moins » connues – extraites de la liste donnée par David Quammen dans Spillover : Virus Machupo (1959), Marburg (1967), Fièvre de Lassa (1969), Hendra (94), Nipah (98), Nil Occidental (99)), l’échec, relatif, des campagnes d’éradication globales menées dans la foulée de celle de la variole et le maintien ou revival de certaines maladies infectieuses qu’on pensait en voie de disparition, ont contribué à dissiper un certain esprit conquérant mais un changement « ad-hoc » de paradigme va permettre à certains acteurs de la santé publique et de la recherche d’accompagner le ressac en limitant la casse.
Car bien évidemment aux États-Unis comme ailleurs, il s’agit toujours d’abord de naviguer au milieu des restructurations permanentes et autres coupes claires à répétition qui caractérisent ce secteur de la santé publique depuis plusieurs décennies. Mike Davis dans The Monster Enters : Covid-19, Avian Flu and the Plagues of Capitalism ( qui sort en septembre en français) le rappelle longuement dans son huitième chapitre, « Homeland Insecurity », déplorant notamment l’impréparation, particulièrement de la recherche vaccinale, face aux risques de nouvelle pandémie grippale. Pourtant, et d’ailleurs le succès dans la mise en oeuvre des vaccins anti-covid est venu en partie démentir son tableau alarmiste ( pour les pays riches), certains acteurs ont su, au nom de la prévention des risques infectieux, tirer leur épingle du jeu. Qu’on prenne par exemple la France, où les « mauvais coups portés à l’hôpital » ne doivent pas oublier les nouvelles sinécures ouvertes à « l’élite du welfare » par ce que certains chercheurs ont qualifié « d’agencification de l’État sanitaire« , c’est à dire la multiplication, au fil des crises sanitaires et de l’émergence de nouvelles menaces, de toute une galaxie « d’agences sanitaires » qui accompagne « une révolution doctrinale » de la santé publique s’articulant autour de la notion de « sécurité sanitaire ». L’époque est donc aux « épidémiologistes d’État » comme l’indique François Button et Frederic Pierru dans » Instituer la politique sanitaire. Mise en circulation de l’épidémiologie appliquée et agencification de l’État sanitaire. » : » Observer, surveiller, alerter » : telle est désormais la triple mission de ces épidémiologistes d’État situés aux avant-postes de la guerre contre les menaces sanitaires. Une fois établis au cœur de l’État, ces épidémiologistes ont pu, avec l’appui de l’administration centrale, élargir leur champ d’observation en étendant la catégorie du risque bien au-delà des maladies transmissibles et infectieuses. Ils ont profondément transformé la vieille « police sanitaire ». »
Ce sont les États-Unis qui ont, comme il se doit, ouvert la voie dans le domaine. Ainsi, dès 1989, le National Institutes of Health en collaboration avec la Rockfeller University organisa une conférence sur les « virus émergents » qui eut un profond impact comme le relate Nicholas B. King dans son article « Security, Disease, Commerce : Ideologies of Post-colonial Health » : « Dans la décennie qui a suivi, les inquiétudes exprimées lors de cette conférence seront largement relayées par ses participants, qui les consolideront en un ensemble orthodoxe de prédictions et de recommandations qui sera ensuite repris par un groupe plus large de personnes comprenant d’autres scientifiques, des journalistes de premier plan, des responsables locaux et nationaux de la santé publique et des experts de la sécurité nationale. La vision centrée sur les maladies émergentes en est vite venue à dominer la compréhension américaine de la santé publique internationale. » Certes, comme nous l’avons rappelé plus haut la situation sanitaire globale avait effectivement « objectivement » changé mais il s’agissait aussi de faire d’une pierre deux coups : « Associer les maladies infectieuses aux intérêts économiques et sécuritaires américains ( …) permettait aux initiateurs de la campagne de solliciter des fonds non seulement auprès des institutions de santé traditionnelles mais aussi du département de la défense. Cela constituait une opération politique astucieuse à une époque où le financement de la santé publique était régulièrement l’objet de coupes sévères. »
Ce qu’il faut retenir, plus que l’habileté institutionnelle, c’est l’habileté conceptuelle puisque le nouveau paradigme « biosécuritaire » qui émerge alors ne va avoir de cesse de s’étoffer et d’étouffer toute autre réflexion sur la gestion des nouveaux « risques ». Faire des maladies émergentes une question de sureté nationale et internationale s’articulait en effet parfaitement à la ré-configuration de la théorie et de la politique sécuritaire à l’ère de la globalisation triomphante. Comme le soulignent Bruce Magnusson et Zahi Zalloua dans leur introduction au recueil Contagion, Heath, Fear, Sovereignty » Depuis plusieurs décennies, la contagion est devenue une métaphore de choix pour à peu près tout, allant du terrorisme globale aux attentats suicides, de la pauvreté à l’immigration, des crises financières globales aux droits de l’homme, du fast-food et de l’obésité au divorce et à l’homosexualité. La prolifération sans précédent de la contagion comme outil heuristique ou catégorie interprétative devrait toutefois nous donner à penser. Qu’arrive-t-il quand le concept de contagion sort de son contexte épidémiologique originel et commence à contaminer les autres discours dans les sciences sociales et les humanités ? » Selon eux la contagion est devenu « le maitre-mot controversé de la mondialisation, une épée à double tranchant pour penser les processus globaux. » D’ores et déjà la peur de celle-ci rebattant les cartes de la souveraineté puisqu' »un virus est là, prêt à surgir et à briser les défenses hygiéniques, physiques et intellectuelles les plus élaborées des États et des individus souverains. » Cette reconversion heuristique des maladies émergentes a été également longuement soulignée par Bruce Braun dans son article « Biopolitics and the Molecularization of Life« : » Avec l’attention accrue portée à des phénomènes comme la grippe aviaire, le virus Ebola, la maladie de la vache folle et autres zoonoses, la vie moléculaire a été pensée comme intrinsèquement instable et, dans un sens, comme perpétuellement menaçante. La vie humaine est en retour conçu comme jetée dans ou exposée à ce monde moléculaire soumis à un constant changement chaotique. Loin du corps indépendant doté d’un code génétique clair – le fantasme d’une identité essentialisée stockée comme une banque de données sur un cd-rom- ce que nous trouvons dans le discours médical et politique sur les « maladies infectieuses émergentes » c’est un corps radicalement ouvert au monde, projeté dans le flux de la vie moléculaire où les recombinaisons ne sont pas ce que nous contrôlons mais ce que nous craignons. (…) La biosécurité est la réponse au problème de la mutabilité et de l’imprévisibilité de la vie biologique au sein d’un ordre politico-économique fondé sur l’intégration économique globale. »
Le virus érigé en révélateur du monde des flux, du juste-à-temps et de l’interconnexion globale ? Il s’agit certes désormais d’un lieu commun, d’autant plus depuis le début de la pandémie de Covid-19. Mais ce qui caractérisait à l’époque le discours et la pratique biosécuritaire c’est le changement d’approche qu’elle faisait découler de ce constat. Andrew Lakoff dans sa contribution « Epidemic Intelligence. Toward a Genealogy of Global Health Security » au recueil Contagion, Heath, Fear, Sovereignty le résume ainsi : « Ces projets contemporains de gestion des maladies infectieuses à une échelle globale prennent des aspects des politiques de santé publique précédentes mais les adaptent à un ensemble de circonstances différentes. La sécurité sanitaire globale cherche à orienter certaines structures des systèmes de santé nationaux existants vers son objectif de détection précoce et d’endiguement rapide des infections émergentes. Puisqu’elle se concentre sur des éclosions potentielles de maladie, dont on ne peut pas calculer la probabilité en utilisant des méthodes statistiques, elle développe des techniques de simulation d’épidémie qui modélise l’impact éventuel de celle-ci. » Steve Hinchliffe ( dont on recommande les nombreux textes sur le sujet) et alii dans Pathological Lives. Disease, Space and Biopolitics proposent une synthèse voisine : « La nature non calculable du comportement microbien, l’érosion des régulations étatiques de même que ce qui est perçu comme une hyper-connectivité des voyages et communications globaux, ont conduit à un tournant des logiques d’anticipation, de la prévention des risques connus à la préparation à l’événement sanitaire inconnu mais visiblement inévitable. » Pour ceux qui s’en souviennent, on retrouve bien entendu ici bien des ingrédients (menace omniprésente et permanente) et méthodes (« frappe » préventive) de la guerre anti-terroriste du tournant des années 2000, la secte aum et les lettres à l’anthrax ayant évidemment donné un utile petit coup de pouce à cette fusion avec la lutte contre les « infections émergentes »…
C’est Melinda Cooper dans son article » Pre-empting Emergence. The Biological Turn in the War on Terror » ( repris dans son livre Life as Surplus que nous évoquons plus loin) qui a le mieux, à l’époque (2006), analysé ce tournant où, pour « La défense américaine la frontière entre la guerre et la santé publique, la vie microbienne et le bio-terrorisme est devenue stratégiquement indifférente ». La vie microbienne, envisagée sous l’angle de la guerre, appelant donc la même redéfinition des limites de la souveraineté et les mêmes mesures « préventives ». Une institution centrale du complexe militaro-industriel américain, la DARPA ( Defence Advanced Research Project Agency) va poser les bases de la nouvelle politique bio-sécuritaire : » La DARPA, le centre chargé au Pentagone du financement des technologies militaires innovantes travaille sur une réponse similaire aux problèmes des maladies infectieuses émergentes et du bio-terrorisme. Un des projets actuels de la DARPA inclut des technologies de détection avancées (…) elle utilise notamment les nouvelles techniques de recombinaisons aléatoires d’ADN ( célébrées comme la seconde génération d’ingénierie génétique à cause de leur capacité hautement accélérée à recombiner aléatoirement des segments entiers de génome). La DARPA travaille sur une évolution préventive. Alors que la recherche est menée sous la bannière de la biodéfense, la DARPA se retrouve dans la situation paradoxale d’avoir à créer d’abord de nouveaux agents infectieux, ou des formes plus virulentes des pathogènes existants, afin de mettre au point un remède. Brouillant la différence entre recherche défensive et offensive, innovation et préemption, le Pentagone semble avoir décidé que la contre-prolifération agressive est la seule défense possible contre un futur biologique incertain. C’est une solution sans retour – si la possibilité d’émergence de résistances biologiques est inépuisable, la guerre préventive de la DARPA contre les maladies infectieuses et le bioterrorisme ne peut être qu’infinie. » Signalons également l’article antérieur (2004) et tout aussi éclairant de Susan Wright « Taking Biodefense too Far » qui dénonçait « la course aux armes biologiques contre nous-mêmes » que représentaient déjà ces manipulations génétiques visant à volontairement accroitre la virulence de microbes, bacilles et autres virus et menées sous prétexte de « biodéfense ».
On pourrait certes dorénavant passer directement de cette hâtive esquisse de « préhistoire » à l’Institut de Virologie de Wuhan et son éventuelle responsabilité dans la pandémie actuelle mais ce serait faire l’impasse sur une décennie d’évolutions, et parfois même de relatives involutions, significatives de ce secteur biosécuritaire. Le livre de Melinda Cooper Life as Surplus. Biotechnology and Capitalism in the Neoliberal Era, paru en 2009, témoigne, selon nous, assez bien à la fois des ambitions sous-jacentes aux projets biosécuritaires, et plus largement biotechnologiques et, quand on le relit aujourd’hui, des limites qu’a rencontré et rencontre encore une certaine « hybrisocène » technoscientifique. Pour Cooper, « Alors que les domaines de la (re)production biologique et de l’accumulation capitaliste se rapprochent, il devient difficile de penser les sciences de la vie sans solliciter les concepts de l’économie politique. (…) Nous devons désormais être sensibles à l’intense trafic entre les sphères économiques et biologiques, sans réduire l’une à l’autre, ni pétrifier l’une au bénéfice de l’autre. » Et si « le néo-libéralisme souhaite éliminer les séparations entre les sphères de la production et de la reproduction, entre le travail et la vie, le marché et les tissus vivants », il ne cherche pas « tant à imposer la marchandisation généralisée de la vie quotidienne – l’assujettissement de la sphère extra-économique aux nécessités de la valeur d’échange- que sa financiarisation. Son impératif n’est pas tant la mesure du temps biologique que son incorporation dans la temporalité non commensurable, a-chronologique de l’accumulation du capital financier. (…) Le néo-libéralisme et l’industrie biotechnologique partagent l’ambition commune de surmonter les limites économiques et écologiques à la croissance associées à la fin de la production industrielle au travers d’une réinvention spéculative du futur. »
Cooper, dans la lignée d’une certaine tradition post-operaïste, tend donc à hypostasier les ambitions tant de la science que de la finance dans la première décennie des années 2000 : » En l’absence d’un quelconque actif tangible ou de profits réels, ce que la start-up de la biotech peut offrir c’est une revendication de propriété sur les futures formes de vie auxquelles elle pourrait donner naissance, en même temps que les profits que celles-ci généreraient. » Car, » Tandis que la production industrielle dépend des réserves limitées disponibles sur la planète, la vie, comme la production contemporaine de dette, doit être analysée comme un processus de constante autopoïèse, un auto-engendrement de la vie à partir de la vie, sans début ni fin concevables. » Si Cooper n’en souligne pas moins longuement tous les paradoxes et limites de l’entreprise et que son ouvrage est bien plus riche et foisonnant que ne le laisse présager ces quelques citations, la perspective qu’elle dessine ne s’est pas réalisée jusqu’ici puisqu’une fois de plus ( cf. la crise financière de 2000 puis celle de 2009) la « Frontière » biotechnologique n’a pas tenu ses promesses, que ce soit d’ailleurs, pour parler comme Jason Moore, en terme d' »appropriation » comme de « capitalisation ».
Depuis l’orée, le secteur ne va en effet que de boom en crash, mais ce n’est certes pas que la faute de la finance. Comme le résumait magistralement André Pichot ( cité dans l’indispensable présentation de son parcours et de sa réflexion par Bertrand Louart : Le vivant, la machine et l’homme. Le diagnostic historique de la biologie moderne par André Pichot & ses perspectives pour la critique de la société industrielle) : » À en croire les médias, la biologie serait le dernier bastion de la révolution permanente. Il ne se passe pas un mois sans qu’on nous trompette une fabuleuse découverte susceptible d’éradiquer à jamais la misère et la faim, un bouleversement conceptuel annonciateur d’ébouriffantes perspectives thérapeutiques, à moins que ce ne soit, plus modestement, un exploit technique incongru ou photogénique, et donc riche de sens supposé. Merveilles répétitives forcément doublées d’enjeux financiers superlatifs, mais prudemment commentées au futur, temps des promesses sans garanties, et conjugaison préférée des biologistes – avec le conditionnel, qu’ils utilisent quand le morceau est un peu dur à avaler.
Devant un tel spectacle, les mauvais esprits (mauvaises langues, mais bons yeux) diront qu’une science qui connaît une révolution tous les quinze jours est une science qui tourne en rond. Et qu’une science qui ressent un tel besoin de se mettre en scène dans les médias en promettant tout et n’importe quoi est une science qui a perdu pied et se noie dans un fatras de résultats expérimentaux qu’elle est incapable d’évaluer et d’ordonner, faute d’une théorie cohérente. À y regarder de près, c’est bien le cas. Pour l’essentiel, ces prétendues révolutions ne sont que des affaissements successifs par lesquels pan par pan, s’effondre le cadre théorique de la génétique moléculaire (et par là, celui de la biologie moderne dont la génétique est le pivot). » (Mémoire pour rectifier les jugements du public sur la révolution biologique, revue Esprit, août-septembre 2003)
Même si on voit discours optimistes voire triomphalistes repointer le bout de leur nez, les deux décennies qui s’achèvent n’ont principalement débouché que sur des apories. Qu’on prenne le secteur agricole, et de l’aveu, il y a quelques temps déjà, d’un de ses plus précoces critiques : » Le besoin de maintenir les niveaux d’investissement et le cours des actions en bourse a mis une pression énorme sur les compagnies biotechnologiques pour qu’elles développent et déploient des produits aussi vite que possible. (…) Mais la vie est beaucoup plus compliquée que les sociétés de biotechnologie ou leurs équivalents académiques ne l’avaient anticipé. (…) la révolution génétique n’a pas encore eu lieue. Après plus d’une décennie à se précipiter pour lever des fonds au nom du code génétique, les géants du gène n’ont été en mesure d’amener sur le marché que deux OGM pour 4 productions agricoles. Les coûts financiers ont été énormes. Et au bout du compte, les coûts en terme de perte de capital culturel et politique dans la lutte contre les régulations et classifications ont peut-être été encore plus importants. » ( Jack R. Kloppenburg, First the Seed. The Political Economy of Plant Biotechnology, voir également sur le sujet, Jason Moore Le Capitalisme dans la toile de la vie pp. 368-375) Il en va de même pour la médecine où le séquençage individualisé du génome n’a pas donné les résultats escomptés ( voir sur ce point » Playing the Genome Card » de Ari Berkowitz et l’article « L’eldorado de la médecine sur mesure » de Raùl Guillén dans Le Monde Diplomatique de septembre), les ambitions de la recherche sur les cellules souches soulèvent de plus en plus d’interrogations et les thérapies géniques déçoivent.
Les folles ambitions du tournant du siècle et la crise, certes larvée mais tout autant économique qu’épistémique, qui lui a succédé constituent donc un arrière plan fondamental de la prolifération biosécuritaire, qui n’a pas, elle non plus, manqué de zigzaguer. Ainsi la transition de l' »international » au « global » de la santé publique mondiale qu’elle accompagnait, c’est à dire le passage d’une collaboration entre États souverains sur les questions de santé à la subordination de ceux-ci à des autorités transnationales, subordination rendue nécessaire par l’approfondissement de l’interdépendance et l’accélération de la circulation mondiales, ne s’est pas déroulée non plus comme prévu ( sur cette transition voir: Brown, Cueto et Fee « The World Health Organization and the Transition From “International” to “Global” Public Health« ) Ce fut notamment illustré en 2007 par le refus de l’Indonésie de continuer à collaborer avec l’OMS dans la collecte des échantillons de virus de la grippe aviaire qui frappait le pays. Refus motivé par la volonté du pays de passer un accord directement avec une firme pharmaceutique pour mettre au point un vaccin et non plus passer par l’OMS, que le gouvernement indonésien accusait de pourvoir l’industrie pharmaceutique en échantillons de virus sans s’assurer derrière que le vaccin mis au point serait accessible à un prix abordable pour les pays en développement. Les accusations à peine voilées de « biopiraterie » lancées par Jakarta, mais aussi par la Thaïlande, soulignant que les États du Sud refusaient d’être les idiots utiles d’une santé globale pensée comme un investissement des pays riches dans leur « auto-protection »( voir notamment David P. Fidler « Indonesia’s Decision to Withhold Influenza Virus Samples from the World Health Organization: Implications for International Law » et « A Science that Knows No Country: Pandemic Preparedness, Global Risk, Sovereign Science » de J Benjamin Hurlbut). Que le conflit ait été réglé grâce à l’intervention de la fondation Gates, modèle s’il en est de la nouvelle (plouto)philanthropie sanitaire, n’a fait qu’également souligner le déclin de la suprématie de l’OMS mais aussi de toutes les institutions nationales de sécurité sanitaire au profit de ce type de structures, certes peut-être plus enclines à financer la prolifération mais bien plus sujettes à la vigilance ou la méfiance du public et de la presse ( du moins celle qui ne survit pas grâce à leurs subsides cf le journal Le Monde en france). A propos de prolifération sans frontières, notons que le chercheur hollandais Ron Fouchier a tenté en 2012 de contourner l’interdiction qui lui avait été faite de publier les résultats de ses bidouillages à hauts risques sur la grippe aviaire (voir plus loin) en invoquant justement cette « souveraineté génomique » indonésienne puisque ses souches du virus provenaient de l’archipel… ( voir Porter et Hinterberger, « Genomic and Viral Sovereignty: Tethering the Materials of Global Biomedicine« )
Le cas de l’OMS et de ses homologues nationaux n’a en tout cas pas été arrangé par la « grippe porcine » de 2009, déclarée pandémique le 11 juin de cette année là alors qu’elle s’avérera au bout du compte plus bénigne que la grippe saisonnière ( cf le précédent de 1976, voir plus haut). D’autant que cet excès de précaution alimenta de nombreux soupçons concernant une collusion de l’institution internationale avec les compagnies pharmaceutiques. Le Docteur Wolfgang Wodarg, épidémiologiste, député européen social-démocrate et ancien président du sous-comité sur la santé du parlement de Strasbourg résumait bien ces soupçons lors d’une déclaration devant une commission de l’assemblée du Conseil de l’Europe en 2010 : » En conséquence du bruit fait autour de la grippe aviaire de 2005/2006, de nombreux contrats furent signés entre les États nationaux et des entreprises pharmaceutiques afin de garantir la disponibilité de vaccins spécifiques en cas de future pandémie . Les compagnies commencèrent alors à produire une seconde ligne de vaccins destinés à être utilisés lors d’une pandémie. Ils développèrent leurs nouveaux vaccins en utilisant des adjuvants brevetés. C’est la raison pour laquelle ces vaccins purent être monopolisés par quelques compagnies et vendus bien plus chers que les vaccins saisonniers, qui sont traditionnellement produits dans des oeufs de poule et qui peuvent donc, de ce fait, être produits très rapidement par de nombreux laboratoires de par le monde en utilisant des procédures non brevetées. (…) La fourniture de ces vaccins anti-pandémiques au niveau national était liée, par contrat, dans de nombreux pays à une clause de non recours en cas d’effets secondaires non désirables. Ces contrats et engagements commerciaux devaient prendre effet en cas de déclaration d’une pandémie par l’OMS. Donc celle-ci a simplement déclenché l’application des plans de préparation anti-pandémique et libéré ainsi d’importants revenus pour les producteurs de vaccins impliqués. » Ce qui aurait au total coûté aux États la rondelette somme de 18 milliards de dollars… ( voir également à ce sujet l’enquête « WHO and the Pandemic Flu « Conspiracies » publiée en 2010 dans le British Medical Journal)
Avec cette « fausse alerte », c’est évidemment le coeur du paradigme biosécuritaire, le développement de tout un appareil de surveillance et de recherche autour d’une partie du « vivant » érigé en menace, qui se trouvait pris en défaut. Ce qui n’empêcha pas, bien au contraire, cet appareil de surveillance de continuer à s’étendre y compris dans la collecte de données permettant un suivi toujours plus poussé des individus ( c’est la thèse défendue par Bronwyn Parry dans « Domesticating biosurveillance: ‘Containment’ and the Politics of Bioinformation« ). On a d’ailleurs surtout l’impression d’un empilement continu d’institutions, programmes, projets sur les maladies infectieuses émergentes : ainsi aux États-Unis, la création du Real Time Disease Outbreak System (RODS), système de surveillance en temps réel des données de santé pour déceler un début éventuel d’épidémie venant doubler celle du programme Biosense du CDC, autre programme de « surveillance syndromique » automatisé ; la DARPA lançant en 2018 sur le même créneau que le programme PREDICT de l’USAID ( abandonné en 2019 puis relancé par Biden), son programme PREEMPT, le tout venant concurrencer sur son terrain le Global Virome Project, etc, etc. Mais ce n’est certes pas que cette balkanisation qui explique les miracles accomplis en 2019 par tous ces professionnels de l’anticipation – quoique la france qui se croyait championne mondiale de la prolifération bureaucratique semble vouloir y puiser une inspiration nouvelle – puisque le système chinois de déclaration des maladies, qui faisait la fierté des responsables sanitaires du pays, est lui aussi passé à côté du virus.
Cette incompétence pourrait bien sûr ne sembler qu’anecdotique et bien inoffensive si l’autre versant de cette manie anticipatrice n’étaient pas de très concrets bidouillages de laboratoires. Et, comme dans toute cette histoire, il est principalement question « de voir venir », on peut, à défaut d’un panorama complet, suivre le développement de ces diverses manipulations et autres créations de chimères au fil de la montée progressive des inquiétudes à leur sujet (on trouvera par ailleurs un bon résumé analytique des divers rebondissements évoqués ci après dans l’article « L’alarme d’Antigone » de Frederic Keck). Ainsi, comme le rappelait Susan Wright dans « Taking Biodefense too Far » : « Dans le passé, certains biologistes ont avancé qu’il serait impossible de créer des organismes plus épouvantables que ceux déjà fournis par la nature – ce qui supposait que de folles tentatives de créer de nouveaux pathogènes seraient vouées à l’échec. Mais ce n’est plus le cas. Si des doutes demeuraient, ils ont été dissipés à la fin des années 90 quand la tentative par des scientifiques australiens de créer un vaccin contraceptif pour les souris, qui périodiquement prolifèrent hors de tout contrôle dans certaines parties de l’Australie, a pris un tournant inattendu. » En effet la manipulation génétique visant à garantir la stérilité a abouti à la création d’une version plus foudroyante d’un virus existant ( mousepox, la variole de la souris ?), ou comme le résumait le journal Libération à l’époque : « Au lieu de créer un vaccin anticonceptionnel pour les souris, les chercheurs ont mis au point une véritable bombe biologique, un virus nettoyeur de rongeurs. Il n’a pas quitté leur labo, mais son efficacité les a un peu décontenancés. « S’ils ont bien travaillé, il n’y a aucun risque de dissémination», explique Louis-Marie Houdebine, chercheur à l’Institut national de recherche agronomique (Inra) et spécialiste français des organismes transgéniques. Les chercheurs opèrent en principe en milieu confiné et dans des conditions de sécurité très élevées. Le virus génétiquement modifié des Australiens n’a probablement pas d’avenir. Trop difficile à contrôler et beaucoup trop dangereux. (…) D’après New Scientist, les scientifiques australiens redoutent surtout l’utilisation d’un vaccin transformé par des bioterroristes. «Si un imbécile introduisait ce gène de l’IL4 dans le virus de la variole humaine, la mortalité augmenterait de façon assez spectaculaire», explique le magazine. » Sachant que cette mortalité était déjà de 30 à 40%, sans oublier les très importantes séquelles pour les survivants…
Cette question de l’usage des données de recherche et de la variole humaine, dont on aurait pu espérer que l’éradication aurait découragé les vocations, s’est d’ailleurs reposée deux ans plus tard avec la publication d’un autre article, dans lequel des chercheurs décrivaient comment, pour étudier les facteurs respectifs de virulence du virus de la variole humaine et du virus de la vaccine ( à partir duquel Jenner a inventé la vaccination contre la variole), ils avaient mis au point une variante bien plus virulente de cette dernière, ce que certains ont décrit comme mode d’emploi pour une opération bioterroriste. Il faut noter l’argumentaire pour le moins saugrenu des chercheurs pour lesquels, puisqu’il reste, « officieusement », des échantillons du virus dans des laboratoires militaires américains et russes ( et pas seulement : comme on s’en est aperçu, par hasard !, en 2014 dans un labo du National Institutes of Health américain), la menace de la variole n’est pas éradiquée, ce qui autorise donc leurs manipulations pour la « ressusciter ». La récréation en 2005 du virus de la grippe espagnole, sous l’égide du CDC américain, suite à la récupération d’un échantillon du virus sur le corps d’une victime de l’époque conservée dans le permafrost en Alaska, toujours sous prétexte d’en comprendre la virulence, ne manqua pas de provoquer des angoisses similaires et ce, même chez certaines autorités sanitaires. Ces épisodes successifs ont donc amené le Conseil National de la Recherche américain a théoriser, dans Biotechnology Research in an Age of Terrorism le « dilemme de l’usage dual « , c’est à dire le fait que » la même technologie puisse être utilisée légitimement pour l’amélioration du sort de l’humanité ou pour le bioterrorisme » et à recommander d’affubler certaines recherches du label » Dual Use Resarch of Concern ». Après deux guerres mondiales, deux bombardements atomiques et une longue succession d’incidents nucléaires, industriels ou sanitaires jusqu’à aujourd’hui, il était effectivement temps de constater à quel point cette question du « double usage » préside à toute l’histoire de la technologie moderne et notamment de la bactériologie (voir entre autre les travaux de Paul Weindling ou l’article de Edmund Russel : « A propos d’annihilation » : mobiliser pour la guerre contre les ennemis humains et insectes, 1914-45″ qui paraît en novembre dans notre anthologie Épidémies et rapports sociaux) !
Dans la seconde décennie 2000, ce sont surtout les recherches dites, selon la définition officielle, « de gain de fonction entrainant une accroissement de la capacité de transmission ou la virulence de pathogènes potentiellement pandémiques » qui passeront au premier plan. En effet lors d’une conférence qui se tenait à Malte en septembre 2011, le professeur Ron Fouchier du Centre Medical Erasmus de Rotterdam présenta les résultats d’expériences de gain de fonction menées sur une souche humaine du H5N1 afin de faciliter une transmission inter-humaine, le virus étant ensuite inoculé à des furets ( l’animal fétiche des recherches sur la grippe depuis les années 30, du fait de la similarité des symptômes et modes de transmission du virus chez ces animaux et les hommes). Via des contaminations successives des animaux entre eux, Fouchet et son équipe étant ensuite parvenu à une transmission par les voies respiratoires, dont on sait, depuis qu’en 1933 un chercheur fut, pour sa plus grande joie, infecté par un de ses furets de laboratoire, qu’elle présage une transmission inter-humaine équivalente. L’annonce peu après par le chercheur japonais Yoshihiro Kawaoka et allii de la modification réussie d’une souche du H5N1, « grâce » à des techniques de génétique inverse, afin de faciliter la transmission inter-humaine, toujours par voies respiratoires, du virus vint à point nommé compléter le tableau. Plutôt que de retracer les controverses qui s’ensuivirent, avec notamment en 2014 la suspension provisoire du financement par la maison blanche de certaines recherches, les protestations de Fouchier et Kawaoka, etc, ce que l’article « L’alarme d’Antigone » de Frederic Keck fait très bien, il semble plus intéressant de relayer les critiques émises par certains chercheurs à l’époque.
L’un des plus connu et actif de ces critiques est l’épidémiologiste Marc Lipsitch qui s’est très tôt élevé contre certaines recherches en « gain de fonction » au nom d’ailleurs de méthodes de recherches alternatives et bien moins hasardeuses. Ainsi en 2014 dans l’article, co-écrit avec Alison P. Galavani, « Ethical Alternatives to Experiments with Novel Potential Pandemic Pathogens » il constatait » L’évaluation des risques entourant la recherche biomédicale n’a pas suivi le rythme des innovations scientifiques en termes de méthodologie et d’applications. Cet écart est particulièrement déconcertant concernant les recherches impliquant des « pathogènes potentiellement pandémiques » qui risquent d’être accidentellement libérés dans la nature et de se propager globalement. (…) Il existe des approches expérimentales plus sûres, qui sont à la fois scientifiquement plus porteuses d’informations et plus facilement applicables afin d’améliorer la santé publique via une surveillance, prévention et traitement approfondie de la grippe. » Dans un débat avec entre autres, le lui aussi très actif, Ron Fouchier, il notait « Contrairement à d’autres expériences à gain de fonction, la création de pathogènes potentiellement pandémiques (PPP) comporte le risque unique qu’un accident de laboratoire puisse déclencher une pandémie qui tuerait des millions de personnes. La question n’est pas de mener des recherches sur les PPP ou ne rien faire, c’est plutôt de savoir si on a un portefeuille d’approches pour battre un virus sans créer de risque pandémique et si il faut inclure les PPP dans ce portefeuille. Nous devrions par exemple décider si nous consacrons nos ressources limitées à des recherches qui créent expérimentalement des PPP – recherches qui sont couteuses, souvent poussives, d’une faible productivité, peu généralisables et qui créent un risque pandémique – plutôt que de les consacrer à développer les autres aspects de ce portefeuille de prévention de la pandémie grippale. » Il appelle même un peu plus loin, au vu des risques représentés par ces recherches, à ce que le public s’implique dans le débat, ce qui n’a pas du manquer de paraître une abomination à ses interlocuteurs et collègues ! (On peut également lire avec profit du même Lipsitch « Why Do Exceptionally Dangerous Gain-of-Function Experiments in Influenza?« )
Autre scientifique inquiet des dangers présentés par les opérations préventives de la recherche biosécuritaire, le virologue de l’institut pasteur Simon Wain-Hobson, rappelait dans « The Irrationality of GOF Avian Influenza Virus Research » que ces « expérimentations d’évolution forcée sur les virus grippaux n’ont que très peu de chances de délivrer des informations à partir desquelles un ministre de la santé pourrait agir. » Mais que par contre une fois publiées » ces études sont facilement réplicables à moindre coûts. Savoir ce que c’est faisable suffit. Et si la reproduction de ces expériences se fait dans d’autres laboratoires avec des normes de confinement moindre, ces nouvelles souches pourraient proliférer, avec un risque accru de libération accidentelle. » Là encore ce n’est pas la prolifération bioterroriste mais bien plutôt « bioerroriste » qu’il faut donc craindre, surtout vu la multiplication vertigineuse des laboratoires dits de « haut niveau de biosécurité » ces dernières années de par le monde.
Alexandra Peters décrit bien le phénomène dans son article « The global proliferation of high-containment biological laboratories: understanding the phenomenon and its implications » et constate que si « cette prolifération est paradoxale : plus nous construisons de laboratoires pour nous protéger, plus notre environnement devient précaire » elle n’en est pas moins à la fois « horizontale et verticale, c’est à dire que plus d’États construisent des laboratoires de haute sécurité et que les États qui ont déjà des laboratoires de ce type en construisent plus ». Précisons qu’il est question ici de laboratoires de type P3 ( laboratoires qui peuvent manipuler des pathogènes mortels pour lesquels des traitements ou des vaccins existent) et P4 ( laboratoires qui manipulent des pathogènes mortels pour lesquels aucun traitement n’existe). La carte mondiale des laboratoires P4 (ci contre), tirée du site de suivi et d’analyse Global Bio Labs , illustre presque caricaturalement ce bourgeonnement biosécuritaire.

Celui-ci est certes grandement facilité par la faiblesse de l’encadrement national et international. En effet en 2007 déjà, un rapport de l’United States Government Accountability Office, High-Containment Laboratories: Preliminary Observations on Federal Efforts to Address Weaknesses Exposed by Recent Safety Lapses, notait, dans ce qui fait penser au tableau clinique de la propagation d’une maladie, » Il se produit une prolifération majeure de laboratoires de haute sécurité de type P3 et P4 aux États-Unis (…) cette expansion se déroule dans de de nombreux secteurs – fédéraux, académiques et privés – et à travers tous les États-Unis. On est ainsi passé de 5 laboratoires P4 en 2001 à 15 aujourd’hui. » Au vu de la liste donné un peu plus loin dans le rapport ( p5 et 6) il semblerait n’importe quelle agence sanitaire ou sécuritaire voulait désormais son laboratoire de haute sécurité, cette mode étant facilité par le fait » Qu’il n’existe pas d’agence fédérale ayant la mission de surveiller et de déterminer les risques associés à l’expansion des laboratoires P3 et P4 aux États-Unis et aucune agence ne sait combien il y a de laboratoires de ce type dans le pays. Par conséquent personne n’est responsable des risques associés à la prolifération de ces laboratoires de haute sécurité. » Un paradoxe de plus de « l’agencification » ? En tout cas dans son rapport de 2017, l’organisme ne constatait pas d’évolution décisive sur ce plan.
La prolifération est bien évidemment également mondiale et à peine plus régulée, avec pas moins de 25 laboratoires P4 dans 23 pays ( 9 en Europe, 7 en Asie et 3 en Afrique). En Chine, comme le retrace l’article « Current status and future challenges of high-level biosafety laboratories in China » de Yuan Zhiming, la création de laboratoires de ce type a fait l’objet, d’abord en 2004 puis en 2016 d’un grand plan national de construction, allant pour ce dernier jusqu’en 2025, bien que, comme le note Zhiming, la surveillance à l’échelle nationale et la formation du personnel laissent à désirer et que faute de financement suffisant ( les laboratoires P3 et P4 ont des frais de fonctionnement annuels équivalent à 10% de leurs frais de construction) « plusieurs laboratoires de haute sécurité disposent de fonds opérationnels insuffisants pour mener des opérations de routine vitales. Du fait de ces ressources limitées, certains laboratoires P3 fonctionnent avec des coûts opérationnels extrêmement limités voire parfois nuls. »
Dans ce contexte la sempiternelle question des accidents et autres fuites ne manque pas de se reposer et à été d’ailleurs soulevée à de très nombreuses reprises par plusieurs chercheurs, en particulier Lynn C. Klotz, dont les travaux sont incontournables sur ce sujet. Rappelons que depuis la fuite en 1978, probablement par le système d’aération, du virus de la variole d’un laboratoire de Birmingham qui fit deux morts ( dont le directeur du laboratoire qui mit fin à ses jours), il ne s’agit certes plus de science-fiction. Encéphalite équine vénézuélienne en Amérique du Sud en 1995, SRAS en 2003 à Singapour et Taïwan puis 2004 en Chine, fièvre aphteuse en Angleterre en 2007, et les contaminations importantes et à répétition par la brucellose depuis des laboratoires chinois ces dernières années : les exemples spectaculaires, tragiques et plus ou moins admis par les autorités sont légion. Mais comme le souligne très justement Klotz, c’est le jour le jour des « évités de justesse », ou, si l’ont veut, d’un autre « juste à temps », qui semble plus effrayant encore. Dans son article de février 2019 ( sic!), « Human error in High-Biocontainment Labs: A Likely Pandemic Threat« , qui s’appuie sur 749 accidents de laboratoires de haute sécurité recensés aux États-Unis de 2009 à 2015, elle constate que ceux-ci sont à près de 80% dus à une erreur humaine et se distribuent selon sept catégories : 1) coupure ou piqure 2) chute d’un contenant ou projections de liquides 3) morsures par un animal de laboratoire 4) manipulation d’un pathogène hors d’une zone sécurisée 5) exposition due à un non respect des procédures de sécurité 6) défaut d’un équipement de protection 7) défaut d’une machine ou d’un équipement mécanique (Klotz ne mentionne pas par contre les coupures de courant, comme cela s’est produit a Atlanta en 2007, ou les inondations accidentelles ).
A cela s’ajoute la mise en circulation, voire le transport clandestin, lors d’échanges entre laboratoires, d’échantillons de virus insuffisamment désactivés, voire même parfois de confusion entre les lots, comme cela a été le cas à plusieurs reprises aux États-Unis pour l’anthrax ou les virus Ebola et Marburg … Enfin le climat va comme partout venir probablement mettre son grain de sel, et ce alors que les 3/4 de ces laboratoires se trouvent en zone urbaine. Comme l’ont calculé, il y a quelques temps déjà, Van Boeckel et alii dans « The Nosoi commute: a spatial perspective on the rise of BSL-4 laboratories in cities » « la population globale vivant à 30 minutes d’un laboratoire P4 est passée de 30 165 678 personnes en 1990 à 42 456 931 en 2000 et 96 986 631 en 2010. Les prédictions se basant sur les laboratoires construits depuis 2010 ou actuellement en construction suggèrent que ce chiffre pourrait atteindre 126 146 118 personnes en 2012. Dans l’ensemble, cela représente une multiplication par 4 du nombre de personnes concernées et le passage de 0,57% de la population mondiale à 1,8% après 2012. » On remarquera que si, par exemple, les récentes révélations de cas d’infections à la Maladie de Creutzfeldt-Jakob dans des laboratoires français a donné lieu à un peu de bruit médiatique et même à la mobilisation de proches d’une de ces « morts pour la science », on a pas encore entendu parler de protestations contre les nombreux laboratoires P3 et P4 qui maillent le territoire français, il n’y a certes pas de zones d’achalandage alternatif à y développer…
Si nous évoquerons dans la suite et fin du texte les manipulations menées plus spécifiquement sur les coronavirus et le nouveau paradigme « One Health » et les expériences transgéniques, etc qu’il promeut, on peut à l’issue de ce très « lapidaire » panorama de la prolifération biosécuritaire depuis le début du XXIe siècle, évoquer quelques pistes de réflexion sur ces « recherches préventives qui pourraient bien finir par engendrer ce qu’elles anticipent » (dixit Carlo Caduff dans The Pandemic Perhaps). D’ores et déjà la montée progressive des inquiétudes chez plus d’un acteur du « sérail » ( scientifiques, bureaucrates ou journalistes) et les critiques précoces de nombreux universitaires que nous avons cité, manifestent bien assez que ce n’est pas la pandémie de COVID-19 qui a permis de mettre au jour le phénomène, bien qu’il faille le relire un peu différemment à l’aune de l’hypothèse de la fuite de laboratoire à Wuhan. On pourrait de toute façon parfaitement considérer cette fuite en avant bio-sécuritaire comme une manifestation quasiment caricaturale de toute les tares originelles de ces techniques de manipulation du vivant que disséquait dès 1999 l’indispensable Remarques sur l’agriculture génétiquement modifiée et la dégradation des espèces : » Ces techniques de dégénération de la vie sont ainsi en elles-mêmes le désastre qu’elles préparent, et les ravages matériels à venir sont intégralement inscrits dans les ravages spirituels déjà là : car c’est dés maintenant que par tous leurs modus operandi elles excluent la conscience ; et même la simple connaissance de la réalité exacte de leurs manipulations, puisque si les généticiens se rêvent en programmateur de la nature ( et de la nature humaine) en réalité ils ne font que la bombarder à l’aveugle (…) Le terrain inconnu sur lequel s’avancent les techniciens de la mutation, ils le fabriquent ainsi en toute ignorance non seulement des effets à long terme de leurs manipulations, mais même de leurs résultats immédiats : ils ne savent ni ce qu’ils font, ni comment ils le font. » ( Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances)
Il ne vaut effectivement mieux ne pas s’arrêter au simple paradoxe ( « ils produisent ce qu’ils prétendent empêcher ») mais on est bien obligé aussi de constater que la « blitzkrieg » biotechnologique ne s’est pas déroulée comme annoncée pas plus d’ailleurs que n’a émergé tel ou tel « nouveau mode de production » et de subsomption ( cf l’hypothèse de Cooper dans Life as Surplus : » Ce qui est en jeu et nouveau dans les sciences de la vie contemporaines ce n’est pas tant la marchandisation de la vie biologique que sa transmutation en plus-value spéculative. ») et c’est plutôt cette « contingence » que souligne la prolifération biosécuritaire. De même la continuité qu’elle incarne avec la technoscience issue de la seconde guerre mondiale ( représentation scientifico-prétorienne du vivant, culture de l’urgence et de la mobilisation permanente débouchant sur des recherches expérimentales à visées pratiques et opérationnelles immédiates, « nationalisation » de la science et complexe militaro-industrialo-universitaire, optimisme scientiste fanatisé, etc, etc cf. Amy Dahan & Dominique Pestre (eds) Les sciences pour la guerre) signale, plus qu’un immuable grand projet cybernétique, de bien prosaïques nécessités de survie et reconversion pour des pans entiers des appareils sanitaires, scientifiques, etc, d’État. Bref, pour prendre au sérieux ces « apprentis-sorciers », mieux vaut ne pas les prendre au pied de la lettre.
Et tant bien même on le souhaiterait, il faudrait alors reconnaître le démenti apporté par la crise actuelle et celles qui l’ont précédé aux deux piliers « axiomatiques » qui semblent présider aux divers projets biosécuritaires, c’est à dire d’un côté l’utopie ou l’obsession du contrôle ou de l’anticipation du comportement de toute « forme vivante » et de l’autre, le rêve, lointain héritage de la révolution de la biologie microbienne, d’une éradication des menaces qui dispenserait d’avoir à prendre en compte l’ensemble des conditions qui les rendent possibles ( voir à ce sujet la bonne synthèse de Nancy Leys Stepan Eradication. Ridding the World of Diseases for Ever ?). On pourrait également noter que la « santé globale », dont la prolifération biosécuritaire représente la pointe la plus avancée, semble aussi « échouer » par là même où elle croyait réussir ( « urgentisme », ingérence dans l’indifférence aux situations locales, primat des solutions technologiques, etc cf. l’analyse de Randal M. Packard dans son introduction à A History of Global Health). Mais empiler les constats d’échec ne démentira toutefois pas l’adage « la guerre c’est la santé de l’État et de la science » et l’efficacité avérée de ce « plus vieux plan de relance du monde », d’autant plus depuis que sa mise en oeuvre n’a plus besoin d’être littérale (quoiqu’il ne faille jamais, bien sûr, exclure cette hypothèse). De ce point de vue le complexe biosécuritaire n’a donc pas de soucis à se faire : la simple réalité virologique ( « Il ne peut y avoir d’équilibre final dans la bataille contre les microbes car il n’y a pas de limites assignables à la coévolution de la résistance et de la contre-prolifération, de l’émergence et de la contre-émergence » René Dubos), les effets du changement climatique sur le développement de nouvelles maladies infectieuses ou le revival d’anciennes, etc, etc tout vient et viendra apporter de l’eau au moulin institutionnel et financier de sa guerre préventive contre le « bioterrorisme de mère nature » ( formule qui selon Debora Mackenzie tient lieu de « mantra » chez les virologues).
C’est dans ce contexte que l’hypothèse de la fuite depuis l’institut de virologie de Wuhan prend donc une importance certaine, comme hypothèse bien entendu et non comme vérité dernière ( que le pouvoir chinois s’est certainement désormais assuré de rendre invérifiable). On remarquera pourtant que c’est déjà trop demander à la critique sociale qui, quand elle ne chouine pas sur « l’appât du gain [qui] freine la recherche et la prévention » sur les pandémies ( 4eme de couverture de la version française du livre de Mike Davis), balaye d’un revers de main cette possibilité qui ne cadre pas avec ses raccourcis théoriques ( Social Contagion du groupe Chuang)… Un rapide coup d’oeil aux autres hypothèses existantes ne justifie certes pas un telle indifférence. Si le pangolin a ainsi été dédouané, le marché de Wuhan semble perdre un peu de sa centralité dans les débuts de la pandémie et les contres-théories du complot chinoises ( une fuite dans un laboratoire à Fort Detrick) ont été plusieurs fois prises lourdement en défaut. La seule hypothèse réellement mise en avant par l’équipe d’enquêteurs de l’OMS dans leur rapport, les élevages d’animaux sauvages, et semble-t-il plus particulièrement les élevages de visons, n’a par ailleurs pas connu de nouveaux développements depuis ce printemps et risque fort d’être difficile à étayer à l’avenir comme le déploraient récemment ces mêmes chercheurs.
Quant au sympathique, mais fourre-tout, théorème, très repris dans l' »anti-capitalisme » : « c’est l’extension des activités humaines qui en détruisant l’habitat des chauves-souris facilite le contact de celles-ci avec les animaux domestiqués et les humains et donc la propagation des virus », il est certes toujours absolument vrai et dans un sens rassurant ( opposer une « pure nature » à la « cupidité » des hommes) mais fait également fi de bien des réalités, comme le rôle indispensable que remplissent ces mêmes chauves-souris dans l’agriculture mondiale. En effet, leur centralité dans la lutte anti-nuisibles, dans la pollinisation, la qualité de leur guano très largement utilisé en Asie, au point que certains en ont créé des fermes, la menace que représente le syndrome du nez blanc qui les frappe en masse en Amérique du Nord ( où l’on soupçonne qu’il est arrivé sous les bottes d’un spéléologue européen !) pour la production agricole locale, voilà des réalités difficiles à réconcilier avec les essentialisations panthéistes. D’ailleurs, notons pour l’anecdote, et le paradoxe, que la « source originelle » probable de la fuite accidentelle de Wuhan, si fuite accidentelle il y a eu, c’est la mine de cuivre désaffectée de Mojiang au Yunnan peuplée de chauves-souris où six mineurs clandestins étaient justement venus, en avril 2012, récolter du Guano, mineurs qui sont par la suite tombés malades avec des symptômes très proches du Covid actuel, dont trois d’entre eux ne survivront pas. Ce qui n’avait pas manqué d’attirer l’attention des « chasseurs de virus » de l’Institut de Virologie de Wuhan ( IVW) qui y ont par la suite effectué d’intensifs prélèvements et mis à jour de nombreuses souches de coronavirus, dont l’une s’avérera, comme ils l’annonceront le 20 janvier 2020, à 96% identique au Covid-19.
Nous ne détaillerons certes pas ici tous les développements des débats autour de la validité ou non de l’hypothèse de la fuite de laboratoire de l’IVW, puisqu’on trouve aisément de bonnes synthèses dans la presse et surtout dans les textes de Nicholas Wade pour le Bulletin of Atomic Scientists (sic !). Par contre on ne peut que constater combien tout cela s’inscrit parfaitement dans tout le cours de la prolifération biosécuritaire évoquée jusqu’ici. Ce qui permet d’ores et déjà de faire un sort aux accusations de sinophobie ( Chuang parle même d’orientalisme !) lancées à ceux qui soulèvent cette question : les errements de la « recherche préventive » lapidairement décrits ici ne sont certes pas spécifiques à « l’empire du milieu »et il est toujours bon de rappeler que cet institut de virologie et son laboratoire P4 est un pur produit, certes dans des circonstances contrariées, de la prolifération scientifico-sécuritaire à la française, pays qui a également assuré la formation de la désormais fameuse « batwoman » Shi Zhengli dont les recherches étaient en partie financées par le National Institutes of Health américain via l’officine biosécuritaire EcoHealth alliance dirigée par le virologue Peter Daszak qui faisait parti de la mission d’enquête de l’OMS à Wuhan. Les débats quant au fait de savoir si ce financement de « recherches à gain de fonction » répondait aux critères fixés par le gouvernement américain n’a d’ailleurs fait qu’illustrer que ces régulations n’ont, selon l’expression de Alina Chan aucune prise ( « Have no teeth ») réelle sur ce qui se manipule dans les laboratoires.
D’ailleurs personne ne pouvait se leurrer sur ce qui pouvait bien se tramer depuis au moins 2015, avec la publication dans la revue Nature d’un article de Shi Zhengli, du chercheur américain Ralph S. Baric et d’une dizaine d’autres annonçant la création d’une « Chimère virale », version hybridée d’une souche de coronavirus prélevée sur des chauves souris ( probablement dans la mine du Yunnan préalablement évoquée) afin de la rendre plus transmissible chez les souris et de là chez les humains. Les auteurs notaient d’ailleurs comiquement à la fin de leur texte : « La possibilité de se préparer à et de réduire les risques de futures épidémies doit être envisagée au regard du risque de créer des pathogènes plus dangereux. Dans les développement des politiques de recherche à l’avenir, il est important de considérer la valeur des données générées par ces études et si ces types d’études à partir de chimères virales doivent continuer compte-tenu de leurs risques inhérents. » (On pourrait relire ce genre de profession de mauvaise foi à l’aune de l’analyse donnée par Shi Zhengli de la pandémie actuelle : « Le coronavirus 2019 est la nature punissant l’humanité pour avoir gardé des habitudes de vie non civilisées. »)
C’est ce genre de précédents qui ont en tout cas alimenté certains soupçons sur la nature effective du coronavirus, la thèse complotiste de l’arme biologique, ou celle, rapidement réfutée, d’un croisement intentionnel avec le VIH, venant à point nommé, pour le lobby biosécuritaire et ses divers relais, occulter des hypothèses bien moins fantaisistes. Yuri Deigin et Rossana Segretto ont ainsi soulevé, sans la trancher, la question du caractère « chimérique » du Covid-19 dans plusieurs articles dont « The genetic structure of SARS-CoV-2 does not rule out a laboratory origin« . L’un des enjeux principaux sur ce point c’est que comme ils le notent dans « Should-we discount the Laboratory Origin of the Covid-19 ? » : « Plusieurs caractéristiques du SARS Cov-2 prisent ensemble ne s’expliquent pas aisément par l’hypothèse d’une origine zoonotique naturelle. Cela inclut un faible taux d’évolution dans la première phase de transmission [ c’est à dire que le SRAS-COV2 à ses débuts ressemblait beaucoup à son prédécesseur de 2002-2003 tout en se montrant bien mieux adapté aux cellules humaines] ; l’absence de preuves d’une recombinaison virale ; la forte affinité de sa protéine Spike avec les récepteurs ACE2 ; l’insertion d’un site de clivage par la furine (…) » C’est ce dernier point en particulier qui a retenu l’attention car comme le constate Deigin et Segretto : » La site de clivage par la furine confère au SARS-Cov2 une plus grande pathogénicité pour les humains et n’a jamais été identifié dans aucun autre coronavirus. Et dans le même temps des insertions de site de clivage par la furine dans des coronavirus ont été réalisées de façon courante dans des expériences en « ‘gain de fonction ». »
Dans « Retrouver les origines du SARS-CoV-2 dans les phylogénies de coronavirus » Erwan Sallard et ses co-auteurs premettent de replacer dans son contexte cette épineuse question :
« Avant 2002, et bien qu’à l’origine d’épidémies importantes chez les animaux de rente (ou animaux de production), les Coronavirus étaient considérés comme des virus de faible intérêt en santé publique : ils n’étaient principalement responsables que de pathologies bénignes, comme les rhumes saisonniers. Depuis l’émergence du SARS-CoV, en 2002-2003, des études ont testé la possibilité de transfert zoonotique des virus de chauves- souris (Bat-SCoV) chez l’homme et ont tenté d’élucider les processus conduisant à l’émergence de nouveaux pathogènes. À partir du génome de ces virus Bat- SCoV, des virus recombinants potentiellement adaptés à l’espèce humaine ont été construits dans des laboratoires américains et chinois, notamment en remplaçant le RBD de chauve-souris par celui du SARS-CoV humain. Ces expériences ont révélé que l’infection des cellules humaines reste cependant souvent limitée car l’activation de la protéine S nécessite une protéolyse par des protéases exprimées par les cellules de l’hôte, qui est incomplètement réalisée par les cellules humaines pour des virus animaux. Cette difficulté peut néanmoins être contournée en laboratoire en traitant les virus par la trypsine (une protéase), ou en ajoutant, en aval du domaine RBD du génome viral, un site de protéolyse par la furine. Ces manipulations ont été réalisées et on en retiendra que, d’une part, il est possible d’adapter les virus de chauves-souris pour infecter des cellules humaines ou des cellules de différents modèles animaux, et que, d’autre part, les CoV de chiroptères ont un potentiel de transmission zoonotique directe vers l’homme, notamment s’ils acquièrent un site de protéolyse adapté, ce qui ne nécessite que quelques mutations ou l’insertion d’une courte séquence riche en acides aminés basiques. Un facteur aggravant le risque lié aux manipulations génétiques qui produisent des gains de fonction doit aujourd’hui être pris en considération : les progrès spectaculaires des méthodes de biologie synthétique et de génétique inverse réalisés ces 20 dernières années permettent en effet d’assembler, en une dizaine de jours, un génome viral à partir de différents fragments d’ADN synthétisés à partir de séquences d’un ou plusieurs génomes de virus sau-vages. On obtient ainsi un « nouveau » virus en moins d’un mois. »
Si bien évidemment tout cela est difficile à suivre pour le profane, on remarquera que même de fermes opposants à la thèse de la fuite de laboratoire, comme le chercheur Etienne Decroly (ici dans un entretien au journal du CNRS) admettent que la question reste en suspens : « Devant la difficulté à comprendre l’origine de ce virus, nous avons conduit des analyses phylogénétiques en collaboration avec des bio-informaticiens et des phylogénéticiens. Leurs résultats montrent que trois des quatre insertions que l’on observe chez le SARS-CoV-2 se retrouvent chacune dans des souches plus anciennes de coronavirus. Notre étude indique de façon certaine que ces séquences sont apparues indépendamment, à différents moments de l’histoire évolutive du virus. Ces données invalident l’hypothèse d’une insertion récente et intentionnelle de ces quatre séquences par un laboratoire. Reste la 4e insertion qui fait apparaître un site de protéolyse furine chez le SARS-CoV-2 absente dans le reste de la famille des SARS-CoV. On ne peut donc pas exclure que cette insertion résulte d’expériences visant à permettre à un virus animal de passer la barrière d’espèce vers l’humain dans la mesure où il est bien connu que ce type d’insertion joue un rôle clé dans la propagation de nombreux virus dans l’espèce humaine. »
Notons enfin que la découverte toute récente chez des chauves souris au Laos de coronavirus plus proches encore du Covid actuel que la souche présentée (et probablement largement utilisée précédemment dans leurs manipulations) en janvier 2020 par les chercheurs de l’institut de virologie de Wuhan ( voir plus haut) n’a pas permis encore d’élucider le problème comme le note Marc Gozlan sur son blog : » La totalité des sarbecovirus des espèces chauves-souris capturées au Laos (R. marshalli, R. malayanus, R. pusillus) partagent une caractéristique majeure : ils sont dépourvus d’une séquence particulière, dénommé « site de clivage de la furine », que possède en revanche le SARS-CoV-2 et qui joue un rôle majeur dans la fusion entre les membranes virale et cellulaire, ainsi que dans la transmission du virus. (…) Selon les auteurs, il n’est pas impossible que des prélèvements supplémentaires chez des chauves-souris finissent par aboutir à l’identification de souches virales possédant un site de clivage de la furine. On ne peut toutefois exclure d’autres hypothèses, à savoir que ce site de clivage ait été acquis à la faveur de la transmission du virus à un hôte intermédiaire, voire après une circulation du coronavirus passée inaperçue chez des individus ne présentant que peu de symptômes. »
Au-delà de cette question du caractère « chimérique » ou non du virus, on trouvera, dans la presse et dans le texte de Nicholas Wade évoqué plus haut, de nombreuses autres pistes et conjectures sur cette question qui recoupent les inquiétudes habituelles entourant les pratiques quotidiennes des institutions biosécuritaires, ainsi le niveau des normes de sécurité dans le laboratoire P4 de Wuhan qui alarmait depuis un certain temps, ou la possibilité de la contamination d’un employé de l’institut par une chauve souris avancée récemment par un des enquêteurs de l’OMS le docteur danois Peter Ben Embarek… Que cette responsabilité de l’institut de virologie de Wuhan soit un jour établie ou infirmée, elle n’en permet donc pas moins en tout cas d’illustrer, et ce dans tous ses aspects, la trajectoire de la prolifération biosécuritaire de ces dernières décénnies (et le patient zero de cette autre pandémie n’est certes pas né au bord du Yangzi-Jiang !). Mais l’indifférence quasi-générale au « 50-50 » qui entoure désormais cette hypothèse signale aussi fondamentalement une forme d’assentiment, ce qui était malheureusement prévisible au regard de l’immuabilité du consensus étatiste et étatisant que sont notamment parvenus à imposer, à force de matraquage idéologique, etc. , ces « fractions de classe » pour qui l’État est seul horizon car unique prébende.
Cela ne laisse donc pas présager de « retour de bâton » mais, de toute façon, la prolifération biosécuritaire ne manque pas de ressources comme en témoigne une de ses dernières moutures, le paradigme « One Health » (« une seule santé »). La définition officielle (ici sur le site de l’INRA – on ne s’étonnera pas de retrouver, comme à l’habitude, un certain pays en première ligne dès qu’il s’agit de commettre des infamies au nom de grands principes-) est plutôt convenue : « Le concept One Health, c’est penser la santé à l’interface entre celle des animaux, de l’Homme et de leur environnement, à l’échelle locale nationale et mondiale. Cette manière d’aborder la santé dans le contexte mondial actuel de la pandémie liée à la Covid 19, permet de raisonner l’ensemble du système et trouver des solutions qui répondent à la fois à des enjeux de santé et des enjeux environnementaux. » Sauf que bien évidemment, il ne s’agit que d’un faux semblant d’approche « écosyndémique » puisque comme le rappellent Nathalie Porter et Javier Lezaun dans leur passionnant article « Containement and Competition. Transgenic Animals in the One Health Agenda » : « L’émergence de l’agenda « One World, One Health » (OWOH) coïncide avec l’essor d’approches alternatives de la gestion de rapports humains-animaux : la manipulation génétique des animaux pour réduire leur capacité d’être des vecteurs ou des hôtes de pathogènes humains. (…) Les modifications génétiques promettent une forme d’évolution animale dirigée, qui épargnerait aux humains d’avoir à changer leurs comportements afin de prévenir les maladies. »
L’issue de cette nouvelle vague de manipulations est bien sûr grotesquement prévisible : » Du fait de sa perspective obtue, la solution transgénique est donc aveugle aux dynamiques interspecistes qui vont probablement émerger des interventions biotechnologiques et néglige les nouvelles cascades parasitaires que l’arrivée d’une nouvelle vie génétiquement modifiée risque de provoquer. (…) La promesse du fix transgénique est en fait d’établir un périmètre d’isolement au sein de l’organisme de l’hôte ou du vecteur. Le principe n’est pas de contenir l’activité humaine mais plutôt de l’étendre et de la rendre incontrôlable ». Bref « les animaux génétiquement modifiés seraient moléculairement adaptés à l’anthropocène. » Le fameux Aedes aegypti dont les ravages sont bien connus est semble-t-il le cobaye préféré de cette nouvelle vague de bidouillages mais l' »International Barecode of Life » ne devrait pas manquer de continuer à ouvrir de passionants horizons, comme la re-création d’espèces disparues qu’on nous annonce depuis deux décennies déjà… « Une seule santé » disent-ils mais qui s’appuiera donc sur une « seconde nature », modifiée ou générée en laboratoire et le contrôle tatillon et permanent de ce qui reste de « vie sauvage » ( voir à ce sujet, en attendant mieux, l’insuffisant livre de Nathanael Rich Second Nature. Scenes from a World Remade). Et pour les humains, le « deep mutational scannning« , nouvelle étape de l’évolution préventive qui permettra de prévoir en amont les mutations virales, offrira la possibilité de « Protéger les gens en programmant leur système immunitaire contre de futurs pathogènes et non seulement contre ceux qui circulent; cela constituerait un tournant fondamental dans le sens, la mission et l’éthique de la vaccination » ( Predict and Survive in The Economist 07/08/21). On n’est effectivement jamais trop prudent, surtout vu l’ampleur que semble prendre une autre prolifération, le biohacking, où de simples quidams peuvent opérer leurs propres bidouillages génétiques ou autres dans leur cuisine grace à la démocratisation de la technique de modification du génome CRISPR-Cas ( voir l’édifiant article « The Rise of the Biohacker » in FT 22/09/2021). C’est certes presque indéfiniment que s’énumérent ces calamités qui se mijotent plus ou moins délibéremment…
Bref pour conclure et reprendre les termes de l’alternative un peu grossière qui chapeaute cette serie de textes, la crise du covid pourrait effectivement constituer le signe d’une crise d’époque, particulièrement si on prend en compte l’hypothèse qu’un secteur technoscientifique de pointe de ce mode de production a éventuellement généré une pandémie dont le bilan tutoiera peut-être celui de la grippe espagnole. La « guerre préventive aux microbes » et l’obsession de contrôle du vivant menant donc à une forme sans précedent historique de retournement « non militaire » de l’activité humaine contre elle-même. Certes comme disait Nietzsche « En temps de paix, le belliqueux s’agresse lui-même. » ( Par-delà bien et mal) ! Mais on peut tout autant y voir un acccident de parcours nécessaire et les prolégomènes d’une possible transition sous l’égide d’une nouvelle organisation capitaliste de la nature qu’incarneraient notamment, et ce coup-ci effectivement, les biotechnologies et leur appendice biosécuritaire. Cette transition ne se déroulant bien évidemment pas sur le mode joyeusement inéxorable et progressiste qu’elles nous vantent mais plutôt au rythme de la progression des désastres que sous pretexte de prévenir, etc. De toute façon, la question ne sera pas tranchée sur une paillasse de laboratoire et l’analyse critique de ces proliférations technoscientifiques, de leur trajectoire historique et de leurs déterminants sociaux, est donc plus indispensable que jamais. Et ce dans bien des secteurs, comme nous tacherons de l’illustrer dans le prochain post sur l’aquaculture…
Vers la fin du Capitalocène ?
A lire sur l’indispensable site La vie des idées, la dense et très pertinente recension du livre par Jean-Baptiste Vuillerod : » L’appropriation, l’exploitation et l’asservissement de la nature, selon un courant qui entend renouveler le marxisme à la lumière de l’écologie, mènent le capitalisme à ses limites structurelles. Mais cette crise enveloppe-t-elle les conditions de son dépassement ? »
A propos de virus (II) : au bord du Lac Qinghai
Rappel : ces quelques notes profanes (ici comme sur nos autres sites associés) n’ont bien entendu aucune prétention « exhaustive » et à fortiori « scientifique »….
Comme cela a été indiqué au détour d’une citation dans le post précédent, le plateau tibétain, appelé le plus souvent plateau Qinghai-Tibet ( quoique qu’il n’y ait qu’une partie du plateau tibétain qui soit effectivement située dans la province de Qinghai en République Populaire de Chine) est considéré comme le foyer principal de la grande Peste Noire du XIVe siècle. Les recherches les plus récentes confirment l’importance des changements climatiques de l’époque dans le déclenchement du « tour du monde » de la Yersinia Pestis ( voir par exemple Boris V. Schmid et alii dans « Climate-driven introduction of the Black Death and successive plague reintroductions into Europe ») mais avancent également que cette interaction climat/peste est peut-être loin d’avoir dit son dernier mot, la peste étant encore endémique chez les rongeurs du plateau. Ainsi Kyrre Linné Kausrud et d’autres auteurs notent dans « Modeling the epidemiological history of plague in Central Asia » : « Comme zoonose, les facteurs environnementaux façonnent l’épidémiologie de la peste via des effets sur ses principaux réservoirs chez les rongeurs, ses moustiques vecteurs, la bactérie elle-même et les hôtes secondaires et vecteurs alternatifs. (…) Les fluctuations climatiques à grande échelle ont eu et vont probablement avoir des conséquences importantes pour la prévalence de la peste dans le monde sauvage et pour la santé humaine dans les zones vulnérables. » (On trouve également une ébauche de recension des hypothèses récentes dans « Plague and Climate: Scales Matter » de Tamara Ben Ari et alii). A propos de résurgence éventuelle, notons, pour l’anecdote, que, lors de visites au fameux marché de Wuhan juste avant la pandémie, une équipe de chercheurs n’y a pas trouvé de chauves-souris mais à pu constater que l’animal sauvage le plus cher ( 25$/kg) sur les étals n’était autre qu’un habitant bien connu du plateau, la marmotte de l’Himalaya ( Marmota himalayana) mais ils oubliaient de préciser que c’est une des principales « espèces-réservoirs » de la Yersinia Pestis…
La question des interactions entre foyers endémiques et changement climatique est d’autant plus « brulante » sur ce plateau Qinghai-Tibet qui joue un rôle central encore trop méconnu pour toute la région et au-delà. La liste, non exhaustive, des qualificatifs qu’on accole généralement au « toit du monde » le suggère bien : troisième pôle et plus grande zone glaciaire de la planète après l’Arctique et l’Antarctique, plus vaste et plus haut plateau et plus grande zone pastorale au monde, source de 4 des plus grands fleuves d’Asie dont le Gange et le Yang-Tsé-Kiang et « château d’eau » du continent puisqu’en provient l’eau que consomme près de 47% de la population mondiale, etc.. Comme le note Huai Chen et une dizaine d’autres auteurs dans « The impacts of climate change and human activities on biogeochemical cycles on the QinghaiTibetan Plateau » il est plus encore que ses homologues du nord et du sud confronté aux effets du changement climatique : » Le récent rythme de réchauffement sur le plateau Qinghai-Tibet a été plus élevé que celui de l’hémisphère nord, de l’hémisphère sud et du monde dans son ensemble. Avec un réchauffement plus précoce et plus intense, le plateau Qinghai-Tibet sert d’indicateur sensible du réchauffement climatique régional et global ». Comme le soulignent les auteurs, l’enjeu principal sur le plateau c’est les 1,4 million de km2 d’un permafrost « relativement chaud et mince » donc beaucoup plus sensible aux variations de température et qui en fondant définitivement va progressivement transformer la zone en émetteur massif de carbone. D’ailleurs l’intensité du dégel et regel sur le plateau est considérée comme un facteur déterminant du climat pour toute une partie de l’Asie ( sur cet enjeu et d’autres, voir l’article, Responses of permafrost to climate change and their environmental significance, Qinghai-Tibet Plateau, et le très complet document publié par l’administration tibétaine en exil en 2009 : The Impacts of Climate Change on the Tibetan Plateau: A Synthesis of Recent Science And Tibetan Research ). On peut ainsi noter ses effets présents et à venir sur la mousson en Inde, au moment où un nouveau régime de celle-ci est d’ores et déjà en train de se dessiner ( voir Climate impacts of anthropogenic land use changes on the Tibetan Plateau et Robust increase of Indian monsoon rainfall and its variability under future warming in CMIP6 models ).
Dans ce contexte l’activité humaine et ce à toutes ses échelles, allant pour ainsi dire du pastoral au géopolitique, prend une importance démesurée qu’elle n’a certes pas eu précédemment, du moins jusque la seconde partie du XXe siècle, sur un plateau en grande partie désertique et qui n’abritait qu’une petite population d’éleveurs nomades. Le pouvoir chinois ne s’y était d’ailleurs pas trompé puisqu’en plus de quelques « laogai », il y avait installé à la fin des années 50 le Qinghai Yuanzi Cheng ( « cité atomique de la mer bleue ») où fut mise au point la première bombe atomique chinoise… On ne détaillera pas ici les enjeux strictement géopolitiques associés au plateau Qinghai-Tibet mais le lecteur trouvera de bonnes ébauches de synthèse notamment dans le livre de Thant Myint-U Where China meets India , celui de Bertil Lintner Great Game East ou dans un article de Kenneth Pomeranz traduit en français, « Les eaux de l’Himalaya : barrages géants et risques environnementaux en Asie contemporaine ». On remarquera toutefois que le plateau se caractérise par une superposition pour le moins exemplaire des logiques de frontières. Il y a bien sûr la question classique des « démarcations étatiques » ( enjeu des récents affrontements et rodomontades à haute altitude sino-indiennes) puisque celles-ci se situent pour les deux pays, » dans des régions très isolées, des régions d’une diversité ethnique et linguistique incomparable, de royaumes oubliés et de sociétés montagnardes qui étaient jusque récemment hors du contrôle de Pékin et New-Delhi. « ( Thant Myint-U). A cet enjeu de démarcation s’ajoute donc la question des frontières internes, la Frontière entendue au sens de « Front pionner » domestique, ainsi la « colonisation Han » que dénonce la propagande tibétaine et en tout cas les éventuelles valorisations minières, touristiques, etc de ces espaces et donc, enfin et éventuellement, la « Frontière d’appropriation » au sens de Jason Moore ( » Ces « Frontières » d’appropriation sont des faisceaux de travail-énergie non capitalisé pouvant être mobilisés avec des dépenses minimales en capital, au service de l’augmentation de la productivité du travail dans la sphère marchande. Ces « Frontières » peuvent se situer aux limites géographiques extérieures du système, comme dans le complexe sucrier esclavagiste des débuts de la modernité, ou se trouver dans les zones centrales de la marchandisation, comme pour la prolétarisation des femmes tout au long du XXe siècle. » Le capitalisme dans la toile de la vie, p.203). Certes avec moins de gesticulations sous-marines ou cartographiques que ce qui accompagne, entre autre, « l’ouverture du passage du nord-ouest » dans l’Arctique, le plateau Qinghai-Tibet connait lui aussi son « grand jeu » quoique pas toujours dans les termes rassurants d’un certain crétinisme géostratégique …
En effet ces divers enjeux « frontaliers » y sont peut-être un peu plus qu’ailleurs immédiatement, ou en tout cas manifestement, articulés aux enjeux environnementaux et ce, comme cause et effet. C’est ce que symbolisent notamment les voies ferrés que Pékin construit inlassablement dans et autour de la zone (voir la carte ci jointe), un moyen traditionnel d’affirmation de son hégémonie politique sur ses confins selon le rapport Crossing the Line de l’International Campaign For Tibet.

L’achèvement de la ligne ferroviaire la « plus haute du monde » entre Lhasa et Golmud en 2006 avait été ainsi vantée comme une prouesse technologique inégalée puisqu’il avait fallu poser les rails directement sur le permafrost, sauf qu’un réchauffement accéléré menacerait d’ores et déjà la pérennité de toute l’affaire, tout ces travaux herculéens ayant eu par ailleurs d’autres conséquences imprévues que nous évoquerons dans la suite du texte. De même, l’inauguration, à la fin juin 2021, de la nouvelle ligne Lhasa-Nyingchi et ses nombreux ponts ferroviaires sur le fleuve Brahmaputra ( en l’occurrence un épisode de plus d’une forme de « guerre des ponts« ) n’a pas manqué de réveiller de vieilles angoisses indiennes et bangladaises , notamment concernant les barrages côté chinois qui menaceraient l’approvisionnement en eau du sous-continent, barrages qui seront toutefois eux-mêmes à la merci de la fonte des glaciers et des glissements de terrain. Ces éventuelles « Frontières d’appropriation » risquant donc de ne pas tenir leurs promesses…
Ce qui ne serait d’ailleurs qu’un épisode de plus de la gestion finalement assez erratique de cette Frontière par le pouvoir chinois qui se retrouve la plupart du temps à écoper les conséquences de ses politiques précédentes. En témoigne, par exemple, la question des « zones humides » du plateau qui jouent un rôle central de régulation du débit des fleuves et de rétention de carbone. Comme le rappelle Emily T. Yeh dans son passionnant article From Wasteland to Wetland? Nature and Nation in China’s Tibet, sur cette question, comme sur d’autres afférentes, le plateau est progressivement devenu le « décor » de l’affrontement entre deux « nationalismes écologiques » ( » processus de légitimation et de consolidation de la nation médié et construit via la référence à la nature »), l’un chinois « modernisateur » aux formulations certes fluctuantes et l’autre tibétain « essentialiste », c’est à dire postulant une harmonie pré-invasion chinoise entre les hommes et la nature sous l’égide du bouddhisme. Or, note Yeh, avant la colonisation chinoise : » Plutôt que d’être exemptes de manipulations et de significations humaines, les zones humides étaient profondément socialement et activement gérées. Loin d’être « primaires » ces zones humides étaient activement transformées par le travail humain et imbriquées dans les rapports sociaux. Et tout cela ne se produisait pas sous l’égide des idiomes universels de « l’interdépendance des éléments vivants et non-vivants » et de l’harmonie avec la nature, comme le voudrait la sagesse environnementale tibétaine contemporaine mais était au contraire à la fois localisé et politiquement motivé par le besoin de remplir les obligations fiscales vis à vis du pouvoir tibétain. »
Après 1951, c’est certes toutefois une autre « organisation de la nature » qui se met en place, car comme disait Mao : » Si les gens qui vivent dans la nature veulent être libres, ils vont devoir utiliser les sciences naturelles pour comprendre, vaincre et changer la nature; ce n’est que comme cela qu’ils se libéreront de la nature. » (1966). Cette citation est tirée d’un article de Peter Ho, « Mao’s War against Nature? The Environmental Impact of the Grain-First Campaign in China« , qui s’il tient à en relativiser certains effets, rappelle tout de même les absurdités des campagnes agricoles des années 50, notamment celles des conversions de terres liées au » grand bond en avant ». Témoigne de ces absurdités, dans une zone pastorale très froide comme celle du plateau Qinghai-Tibet, cette annonce triomphaliste du bureau de l’agriculture de la province de Qinghai en 1959 : « Sous la direction du Parti, nous avons enfin maitrisé la nature et transformé des pâturages désolés depuis des siècles en terres agricoles fertiles » ( cité dans Ho p. 51). Dans la même foulée, de vastes campagnes d’asséchement des zones humides du plateau furent menées par l’armée et exécutées par les prisonniers politiques, ce qui contribuera à une urbanisation galopante et paradoxalement (une fois abandonnés les grands rêves d’édification d’un grenier tibétain) à au bout du compte ouvrir une partie de ces zones au pâturage. Il est probable que les conséquences de cette reconversion avortée du plateau se font encore sentir…
Et c’est ce qui a en tout cas mené à un progressif changement de cap du pouvoir chinois. Il y eut bien sûr la libéralisation progressive des campagnes du début des années 80 qui s’est en grande partie déroulée au Tibet comme ailleurs en Chine ( on en trouve un bon résumé dans un article de Fabrice Dreyfus, « Politiques pastorales et transformations de l’élevage des yaks sur le plateau tibétain(…) ou encore dans « Rangeland Privatization and Its Impacts on the Zoige Wetlands on the Eastern Tibetan Plateau » de YAN Zhaoli et Wu Ning). Mais la forte augmentation de la population ( multipliée par 3 depuis 1950) et l’explosion du cheptel ( +300% depuis 1978) initiée par ces mêmes mesures de libéralisation provoquant une surpâturage voire même en certains endroits une désertification, la privatisation des cheptels et zones de pâture s’est ensuite accompagnée de mesures de sédentarisation des populations nomades locales, notamment via le programme des « Quatre constructions » ( « Ces programmes étaient destinés à permettre à chaque famille 1) de clôturer une surface donnée de pâturage d’hiver, 2) d’y construire une maison, 3) d’y construire une étable, et 4) de clôturer de petites surfaces pour la production de cultures fourragères pouvant être récoltées et stockées en foin. » Fabrice Dreyfus). Depuis le tournant des années 2000, le but est désormais clairement de réduire l’élevage sur le plateau, quitte à fournir logement en ville et subsides aux éleveurs pour qu’ils cessent leur activité ( voir notamment R.B. Harris, « Rangeland degradation on the Qinghai-Tibetan plateau: A review of the evidence of its magnitude and causes« ). Comme le constate Yeh dans son article « From Wasteland to Wetland ? » » On incite désormais les tibétains à se transformer en désirable citoyen du futur non pas en transformant la nature via leur travail mais en en disparaissant et en laissant sa beauté devenir objet de consommation pour les touristes. » Si, bien sûr, les considérations sécuritaires ne sont jamais absentes, surtout avec les révoltes récurrentes des populations locales, cet abrupt tournant écologiste fait effectivement du plateau Qinghai-Tibet un cas d’école de ces changements de cap gouvernementaux et de cette nouvelle écologie d’État qu’on retrouve un peu partout. Écologie d’État qui n’en courra pas moins que ses prédécesseurs développementistes ou industriels derrière les causes et effets qu’elle génère en permanence.
Ainsi, quoique, comme nous l’avons déjà signalé, la peste n’a peut-être pas dit son dernier mot puisqu’on s’inquiète aussi d’une de ses mutations qui résisterait aux antibiotiques ( voir « A novel mechanism of streptomycin resistance in Yersinia pestis: Mutation in the rpsL gene ») et de sa transmission de plus en plus courante ces dernières années des marmottes aux moutons et de là aux hommes ( voir « Human plague associated with Tibetan sheep originates in marmots »), c’est du fait d’un autre fléau que le plateau a fait parler de lui depuis une quinzaine d’années. En effet, en mai 2005, on a trouvé au bord du Lac Qinghai, situé au nord-est du plateau, plus de 6 000 oiseaux morts, la plus grande mortalité d’oiseaux sauvages jamais attribuée au virus H5N1, mieux connu sous son appellation courante de « Grippe aviaire ». Comme le rappellent Diann J. Prosser et alii dans « Wild Bird Migration across the Qinghai-Tibetan Plateau: A Transmission Route for Highly Pathogenic H5N1« : « Le lac Qinghai est une aire de reproduction et une zone de transit essentiel pour les oiseaux aquatiques migrateurs, recevant 150 000 migrateurs chaque année de plus de 200 espèces dont 15% de la population reproductrice mondiale d‘oies à têtes barrées . Il se situe à l’intersection de voies migratoires centrales : la voie migratoire d’Asie centrale qui part de l’ouest de la Sibérie via l’Asie centrale jusqu’à l’Inde et la voie migratoire d’Asie de l’est qui va de la Russie via la Chine vers l’Australie. » Signe du choc provoqué par cette découverte le lac avait été à l’époque l’objet d’un long ( et bien documenté) article du magazine TIME qui le qualifiait d’équivalent pour les oiseaux migrateurs d’un hub aéroportuaire international.
Si cette épisode de 2005 a tant fait parler de lui, c’est qu’il venait de façon spectaculaire alimenter le débat sur le rôle des oiseaux migrateurs dans la grippe aviaire, que ce soit dans l’évolution du virus, c’est à dire, selon le jargon, le passage de l’Influenza Aviaire Faiblement Pathogène (IAFP) à l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) lors de contacts avec la volaille d’élevage ou de la diffusion de l’épizootie de par le monde. Si tout paraît tenir au premier abord de controverses sur « la poule et l’oeuf », il faut néanmoins remarquer que ces deux questions, intimement liées bien entendu, ont été l’objet d’assez vives controverses notamment après l’épisode du lac Qinghai, qui a permis, un temps, à certains de tenter de dédouaner, en sur-soulignant le rôle des oiseaux migrateurs, les pratiques d’élevage intensif de la volaille de leur responsabilité. Or comme le rappelaient Rogier Bodewes et Thijs Kuiken dans « Changing Role of Wild Birds in the Epidemiology of Avian Influenza A Viruses » : « Tandis que la transmission de l’IAHP des oiseaux sauvages à la volaille a été l’objet de nombreuses études, la voie de transmission opposée n’a été que peu étudiée. Compte tenu du fait que les oiseaux aquatiques migrateurs ne sont normalement pas infectés par l’IAHP et que l’évolution de l’IAFP à l’IAHP n’a été établie que pour les volailles, la détection de l’IAHP chez les oiseaux sauvages suggère qu’une transmission de celle-ci des volailles vers les animaux sauvages doit se produire. » Rob Wallace dans Big Farms make Big Flu, va dans le même sens : « beaucoup de sous-types de l’IAFP présents chez ces oiseaux sauvages ne développèrent une plus grande virulence qu’une fois entrés dans les populations d’oiseaux domestiqués ». On aurait donc notamment une transmission de l’IAFP des oiseaux sauvages vers les volailles d’élevage puis une infection en retour des oiseaux sauvages par l’IAHP lors de contacts avec des volailles ayant incubé cette version plus virulente du virus du fait de leurs conditions d’élevage. (On trouvera des indications plus précises sur le variant particulier du virus qui a fauché les oiseaux du lac Qinghai dans le chapitre 8, « From Hong-Kong to Qinghai Lake and Beyond », du livre Their Fate is our Fate de Peter Doherty) Dans Victims and vectors: highly pathogenic avian influenza H5N1 and the ecology of wild birds, John Y. Takekawaa et alii soulignent également le rôle éventuel des marchés d’animaux domestiques et sauvages vivants dans cette mutation ainsi que l’effet de la disparition progressive des zones humides, notamment sur le plateau Qinghai-Tibet, qui amène les oiseaux aquatiques migrateurs à se concentrer en plus grand nombre sur de plus petites zones marécageuses ce qui donne donc plus d’opportunités au virus pour se diffuser. D’autant que comme le notent Kurt J. Vandegrift et alii dans Ecology of avian influenza viruses in a changing world, ces disparitions des terres marécageuses, etc est souvent associée à un extension de la riziculture un peu partout en Asie, ce qui met de plus en plus en contact les oiseaux migrateurs avec les canards domestiqués massivement utilisés pour la lutte anti-parasitaire dans les rizières, « moyens et fins » de l’intensification de la production mais qui sont également considérés comme une des principales espèces-réservoirs du virus ( « La niche intensive canard-riz en Asie résulte d’une série de changements dans les pratiques agricoles – ancestrales ( riz), impériale tardive ( canard) et actuelle ( intensification de la production de volailles) – se mélangeant de façon à soutenir de façon unique l’évolution et la persistance de multiples influenza aviaires » Rob Wallace Big Farms make Big Flu. Voir également, entre autres, Avian influenza, domestic ducks and rice agriculture in Thailand).
Mais c’est surtout l’étape d’après, c’est à dire le rôle des oiseaux migrateurs dans la diffusion de l’IAHP au niveau régional puis mondial qui a donné lieu à des débats. On retrouvera un peu partout la thèse dominante plus ou moins étayée, ainsi dans « Avian influenza H5N1 viral and bird migration networks in Asia » qui note « Une forte corrélation positive entre les foyers d’épidémies successifs et le temps moyen de vol entre les arrêts successifs sur les voies de migration (…) La vélocité de l’épidémie et la vitesse de migration des oiseaux étant positivement associés cela indique qu’ils partagent les mêmes caractéristiques spatio-temporelles. » Ou encore dans le rapport du Global Consortium for H5N8 and Related Influenza Viruses, « Role for migratory wild birds in the global spread of avian influenza H5N8« . Le rôle des migrations dans la propagation du virus, en plus bien évidemment de recycler un amalgame oh combien séculaire, a été d’autant plus volontiers évoqué que le changement climatique commence effectivement à modifier la donne dans ce domaine. Comme l’évoquent Diann J. Prosser et alii dans « Animal Migration and Risk of Spread of Viral Infections » : « Certains changements cruciaux potentiels et d’ores et déjà observés liés au changement climatique qui affecteraient la circulation virale incluent : 1) des changements dans le comportement migratoire de la population hôte comme des modifications de trajectoires, de périodes de migration et d’aires de répartition 2) des changements dans la biologie moléculaire des pathogènes qui pourrait affecter leur durée de persistance dans l’environnement, leur virulence et leur capacité d’infection (…) » Le changement climatique risquerait donc de modifier en permanence cette interaction entre migration et virus, notamment du fait de la modification des corridors de circulation ( voir notamment Climate change could overturn bird migration (…) ) ou de l’usage des sols et donc des terrains plus ou moins propices à l’infection que rencontreraient les oiseaux sur leur trajet ( voir M. Gilbert et alii Climate change and avian influenza, pp. 5 et 6).
Toutefois, le rôle effectif des oiseaux migrateurs dans la diffusion de la grippe aviaire a été largement questionné dans de nombreux textes. Dans « Ecologic Immunology of Avian Influenza (H5N1) in Migratory Birds » Weber et Stilianakis rappellent ainsi que l’infection réduit très probablement la capacité de migration des oiseaux qui ne sont donc au mieux que des vecteurs locaux de propagation. C’est dans « Recent expansion of highly pathogenic avian influenza H5N1: A critical review » de Michel Gauthier-Clerc, Frederic Thomas et C. Lebarbenchon, qu’on trouvera la réfutation la plus complète des thèses d’une primo-responsabilité des oiseaux migrateurs. Après un vaste bilan des différentes hypothèses, les auteurs soulignent que « bien qu’il reste possible que les oiseaux migrateurs puissent répandre l’IAHP-H5N1 et contaminer la volaille domestiquée, les faits accréditent massivement l’hypothèse que les déplacements par des humains de volaille domestiquée ont été à ce jour le principal agent de la dispersion du virus. » Et ils concluent : » la globalisation naturelle des échanges des oiseaux migrateurs semble occulter la globalisation – sans contrôle sanitaire strict- des échanges commerciaux de volailles comme mécanisme reconnu de diffusion de la maladie. » Sur cette « autre » circulation on peut également se reporter à « Environmental Factors Contributing to the Spread of H5N1 Avian Influenza in Mainland China » qui rappelle que les premiers foyers de grippe aviaire étaient généralement situés non loin des autoroutes nationales chinoises, qui du fait de leur gratuité, de la localisation des marchés sur leur itinéraires et de l’interdiction du transport de volailles par trains constituent effectivement un corridor de contamination idéal.
Ce qui nous ramène au bord du lac Qinghai. Quoique l’urbanisation puis la sédentarisation des nomades évoquée plus haut aient été l’occasion de développer le réseau routier sur le plateau (non sans aléas, voir Highway Planning and Design in the Qinghai–Tibet Plateau of China), l’isolement de ce dernier constituait prétendument la preuve d’une dynamique endogène de propagation du virus chez les oiseaux migrateurs. Or, dès 2006 un article paru dans la revue Nature, relayant les révélations d’un blogueur chinois, indiquait : » Depuis 2003, une des principales espèces migrantes affectée [lors de la mort en masse d’oiseaux de 2005], l’oie à tête barrée, était artificiellement élevée à côté du lac. Les fermes d’élevage – qui participaient d’un programme expérimental pour à la fois domestiquer ces oiseaux et en relâcher une partie pour accroître la population sauvage – soulèvent la possibilité que ces oiseaux domestiqués aient été la source de la contamination. » Cette hypothèse, qui, à notre connaissance, n’a pas été réfutée à ce jour, a été étayée dans plusieurs textes ultérieurs qui décrivent le développement de cette nouvelle industrie. Ainsi Captive Rearing and Release of Bar-headed Geese (Anser indicus) in China: A Possible HPAI H5N1 Virus Infection Route to Wild Birds de Chris J. Feare, Taichi Kato et Richard Thomas en retrace une des sources locales : » L’élevage en captivité des oies à têtes barrées a commencé en 2003 au bord du lac Yamzho Yumco à 100km au sud de Lhassa [capitale de la province « autonome » du Tibet] par la « Lhasa Nida Natural Ecology Development Bar-headed Goose Artificial Breeding Company ». Plusieurs centaines d’oeufs d’oies à têtes barrées abandonnés furent collectés dans une colonie en déclin, dont on a prétendu qu’elle comprenait 30 000 individus autour du lac, et furent artificiellement incubés. L’entreprise fut étendue au district de Xaina, dans la préfecture de Nagqu ( à environ 300km au nord-est de Lhassa) où 500 oies à têtes barrées furent élevées avec succès « pour répondre aux besoins du marché ». La compagnie sous-traita également une partie de sa production à un villageois du district de Gonggar, au sud de Lhassa. En 2006, une unité d’élevage fut établie dans le même village, au bord d’un marécage et d’un bassin apte au développement d’une activité d’aquaculture, et ce, afin de booster l’élevage en vue de l’ouverture de la ligne ferroviaire Lhasa-Golmud la même année. » Sans évoquer directement 2005, les auteurs ne manquent toutefois pas de noter prudemment que plusieurs foyers de grippes aviaires chez les oiseaux sauvages de 2006 à 2010 se situaient non loin de ces zones d’élevage.
La chercheuse indépendante, et autrice de deux textes importants sur le sujet ( Riding the Permafrost Rooster across the Roof of the World et Opening Pandora’s box at the roof of the world: Landscape, climate and avian influenza (H5N1). ), Barbara Canavan, s’encombre de moins de précautions : » Le réseau de causalités spécifiques ayant présidé à l’émergence du variant Qinghai de la grippe aviaire semble multifactoriel. Au vu des éléments que nous avons avancé, la cause la plus immédiate de l’émergence du variant Qinghai à partir de 2005 a été l’élevage d’oies à têtes barrées à proximité de volailles domestiques. L’élevage en captivité d’oies à têtes barrées représente une piste plausible d’évolution de la grippe aviaire vers une forme plus dangereuse et mortelle. C’est la boite de pandore de Qinghai, celle qui a ouvert une nouvelle voie au virus pour atteindre volailles et oiseaux sauvages (..) Une cause indirecte de cette épidémie de Qinghai c’est la construction et mise en service de la ligne ferroviaire QTR ( Lhasa-Golmud) qui a provoqué une hausse exponentielle de la demande en nourriture dans la zone, ce qui a mené en retour à l’élevage en captivité des oies à têtes barrées. » Le paradoxe que représente cette « troisième voie », ni exactement sauvage ni exactement domestique, d’infection a été magistralement analysé par Lyle Fearnley dans « Wild Goose Chase: The Displacement of Influenza Research in the Fields of Poyang Lake, China« . Quoique portant sur un autre lac et une autre espèce, ses analyses n’en sont pas moins probablement valables pour les oies à têtes barrées du lac Qinghai. Fearnley retrace en tout cas en détail les conditions d’émergence de cette nouvelle industrie : » L’élevage de volailles domestiques fut un des premiers secteurs à qui on a permis une libre activité de marché après les réformes de l’économie planifiée de Deng Xiaoping, l’élevage de volailles devenant rapidement une source importante de revenus pour les foyers et les entrepreneurs ruraux. Néanmoins durant les années 90, de grandes entreprises industrielles de production de volailles, organisées comme des compagnies » à tête de dragon » verticalement intégrées ont commencé à prendre de plus en plus de parts de marché. Les statistiques montrant une chute rapide du nombre de petits éleveurs. (…) Beaucoup de ces petits éleveurs n’ont pas nécessairement entièrement abandonné le secteur mais se sont au contraire spécialisés dans des productions locales ou inhabituelles. Une de ses voies de spécialisation c’est l’élevage d’animaux sauvages, pour répondre à la demande particulière des élites fortunées. » Ainsi « les éleveurs de volaille au bord du lac Poyang transforment qualitativement l’interface entre le domestique et le sauvage, mixant et reconstituant les propriétés du « sauvage » et du « domestique » via l’élevage d’oiseaux sauvages. » Il est à noter que le Lac Poyang est comme le lac Qinghai un lieu privilégié de « villégiature » des oiseaux migrateurs, et qu’il est encore plus que son homologue tibétain ( voir Analysis of Long-Term Water Level Variations in Qinghai Lake in China et Numerical study on the response of the largest lake in China to climate change) soumis à asséchement rapide, du fait notamment du fameux barrage des Trois Gorges (voir Linkage between Three Gorges Dam impacts and the dramatic recessions in China’s largest freshwater lake, Poyang Lake), ce qui a par exemple amené les autorités de la province à déployer des hélicoptères pour fournir de la nourriture aux oiseaux migrateurs en 2012….
Alors, la boucle est bouclée ? Hé bien pas exactement car nous n’avons pas encore évoqué une autre hypothèse concernant l’épisode de 2005, le rôle de l’aquaculture dite intégrée. En effet, le lac de de Qinghai, avait été désignée en 1990 dans un rapport de la F.A.O. comme une zone pilote, parmi d’autres pour le développement de l’aquaculture en Chine, notamment sous sa forme dite intégrée, c’est à dire des élevages à la fois de volailles et de poissons où les déjections des premières viennent nourrir les seconds. C. J. Feare relate ainsi dans Fish farming and the risk of spread of avian influenza ( un des bien trop rares articles sur le rapport aquaculture intégrée / grippe aviaire avec Fish farming and influenza pandemics et Avian Influenza and the practice of Integrated Fish Culture ) les efforts engagés autour du lac pour permettre l’expansion de cette industrie, du fait notamment de son assèchement progressif qui crée iles et micro-lacs propices à l’installation de nouvelles structures. Quoique nous réserverons à un autre post de cette rubrique le rapide panorama de cette industrie qui semble, plus que toutes les autres, organisée autour de ses contrecoups « viraux », notons que du fait de la transmission possible du virus via les déjections de volailles et la persistance de celui-ci dans l’eau, elle offre une nouvelle voie royale et ou, « à défaut », parfaitement envisageable, à la propagation de la grippe aviaire chez les oiseaux migrateurs…
Donc ci-git l’aubaine de diversion qu’a pu paraître représenter cette soudaine mort en masse des oiseaux de 2005. Cette manie désormais courante de transformer tel ou tel mammifère en dangereux « porteur de peste » a été d’ailleurs finement analysée dans le recueil dirigé par Chistos Lysteris Framing Animals as Epidemic Villains. Histories of non-Human Disease Vectors. Celui-ci rappelle dans son introduction que « l’absence de certitudes scientifiques concernant les véritables réservoirs du SRAS ou d’Ebola est compensée par les représentations systématiques et très répandue de quelques animaux, tels les chauves-souris ou les civettes, comme des voyous épidémiologiques [« epidemiological rogues »] (…) Tous les discours sur le « One Health« , les relations et partenariats entre les espèces s’effacent et se met en place, pour protéger l’humanité des zoonoses et des maladies dont les animaux sont vecteurs, tout un appareil d’abatage, de marquage, de désinfection, de séparation et d’éradication (…). » Frederic Keck, dont les nombreux textes en français comme en anglais constituent une source incontournable sur cette question et bien d’autres, note quant à lui dans la postface de l’ouvrage : » Si l’imagerie des vilains épidémiques découle souvent de la peur des migrants, les techniques de régulation des maladies animales trouvent leur origine dans les politiques de gestion des migrations, comme nous pouvons le voir avec l’actuelle construction de barrières à la frontière du Danemark pour empêcher que les sangliers sauvages infectent les porcs d’élevage avec la grippe porcine. » (On lira par ailleurs avec profit sa contribution, « Contagious Wilderness. Avian Flu and Suburban Riots in the French Media » au recueil Disease and Crime. A History of Social Pathologies and the New Politics of Health, où il se livre à un très éclairant parallèle entre la représentation dans la presse française des émeutes de 2005 et de l’épidémie de SRAS). L’oiseau migrateur qui constitue donc lui aussi un « bon client » risque toutefois de ne plus l’être longtemps puisque certains s’aventurent déjà à prédire une fin progressive des migrations, qu’annoncerait déjà leur déclin accéléré ( Voir entre autres « Going, Going, Gone: Is Animal Migration Disappearing » ou le livre No Way Home. The Decline of the World’s Great Animal Migrations)….
Il serait difficile de conclure de façon grandiloquente ce bref itinéraire bibliographique autour du plateau et du lac Qinghai et absurde de chercher à sortir de son chapeau un « sujet historique » qui viendrait miraculeusement « rédimer » tout cela ( Le textes de Emily Yeh « Tibetan pastoralism in neoliberalising China: continuity and change in Gouli » décrit par exemple assez bien la néolibéralisation des mentalités chez les toujours ou ex-nomades). Notons tout de même que les perspectives ouvertes par cette « Frontière » et ses divers « surplus écologiques » (Moore) afférents semblent donc s’épuiser très prématurément, épuisement qui se manifesterait donc, entre autre, « épidémiologiquement », notamment comme répercussion, certes relativement marginale ( cf la « niche » de l’élevage d’oiseaux sauvages), du processus entamé dés la fin des années 70 dans le Guandong et magistralement décrit par Rob Wallace, l’intensification de la production de volailles et la pression sur les zones humides du fait de l’industrie et de l’essor de la population facilitant la naissance d’une variante plus virulente d’influenza aviaire vouée à se déployer régionalement puis mondialement ( Big Farms Make Big Flu, p.70 et suivantes notamment). La particularité du plateau tenant notamment à la présence, en embuscade, de la peste à qui la prolifération de rongeurs provoquée par le surpâturage pourrait bien ouvrir de nouvelles perspectives. D’ailleurs notons, pour l’anecdocte, qu’en novembre 2019, au moment même où le virus du Covid-19 faisait probablement ses premiers pas à Wuhan, un vent panique à soufflé sur Pékin lorsque deux cas de peste pneumonique ( la variante la plus létale et contagieuse) ont été dépistés chez deux habitants de Mongolie intérieure venus en désespoir de cause se faire soigner dans la capitale…
Coïncidence mise à part et là comme partout ailleurs, les maladies infectieuses, anciennes ou nouvelles, reprennent donc la place centrale qui leur revient dans la crise de la « modernité-dans-la-nature », ce qui suppose de les réinscrire en permanence dans le champ en constant bouleversement des interactions entre phénomènes climatiques, « naturels » et sociaux. Et si face à l’emballement des désastres, il est toujours tentant d’espérer une accalmie pour rentrer gloser à l’ombre des vieilles théo- et téléologies, ces quelques notes profanes souhaitaient également, et modestement, signaler, que n’en déplaise à bien des « spécialistes », à un moment sans précédent d’accès au savoir dans l’histoire de l’espèce ( la plupart des textes cités ici sont librement téléchargeables et sinon tout le monde sait comment procéder… du moins on l’espère !), la critique sociale ne se trouve pas nécessairement désarmée pour continuer à penser le monde et la possibilité de son renversement. A condition bien sûr d’envisager cette critique sociale comme saisie de la centralité de l’activité humaine, de ses dynamiques et des possibilités qu’elle recèle malgré tout et non sous la forme de ratiocinations sous-panthéistes ( « l’homme est mauvais ») ou sous-marxistes ( « Eurêka ! c’est la faute du capitalisme ») qui n’ont d’ailleurs, le plus souvent, que cette société pour horizon…
Energy Humanities : an Anthology
- Energy Humanities : an Anthology, édité par Imre Szeman et Dominic Boyer, John Hopkins University Press, 2017.
On ignore si la création de courants transdisciplinaires et transnationaux autour d’un concept ad-hoc est effectivement une nouveauté ou une tendance lourde dans le monde universitaire mais si c’est le cas, les « Energy Humanities » pourront certes apparaître comme un modèle du genre. C’est ce dont témoigne cet ouvrage qui tient presque plus du patchwork que de l’anthologie ( Energy Humanities : an Anthology ) publié sous la direction de Imre Szeman et Dominic Boyer en 2017. Comme l’indique une introduction relativement oecuménique » Energy Humanities : an Anthology rassemble des recherches attentives aux défis sociaux, culturels et politiques posés par le réchauffement climatique et la destruction de l’environnement. Comme le suggère le titre, les articles réunis ici se penchent sur un problème spécifiquement lié aux défis environnementaux d’aujourd’hui, celui de l’énergie. » Énergie à qui il s’agit de redonner sa véritable place au centre de la trajectoire du monde actuel : » Si l’histoire de la modernité n’est pas réductible à l’usage de l’énergie sur une échelle toujours plus grande, une explication de ses développements, transgressions et contradictions qui n’aborderait pas le rôle joué par l’énergie dans la formation de ses infrastructures ( les villes conçus pour l’automobile) et de ses subjectivités ( des consommateurs mobiles dotés de pouvoirs quasi infinis – comme celui de communiquer avec quelqu’un de l’autre côté du globe) et tout ce qui trouve entre ces deux pôles, ne peut que contribuer a donner une idée fausse des forces et processus qui déterminent le développement historique, particulièrement ces deux derniers siècles. »
Le concept central des Energy Humanities c’est la notion d »‘inconscient énergétique » (inspirée par le classique du marxiste Frederic Jameson The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act, défense radicale d’une interprétation politique de la littérature), qui « pourrait tout aussi bien être décrite comme la dimension énergétique du consentement spontané de l’hégémonie. » En effet » Notre pratiques et activités quotidiennes ont été déterminées par l’énergie d’une manière que nous n’avons jamais réellement perçu. » Et donc si comme disait l’autre » tout ce qui est conscient s’altère » les « Energy Humanities » souhaitent » faire la lumière sur l’appareil énergétique de la modernité qui est trop souvent invisible ou souterrain mais qui pompe et s’écoule dans les nappes phréatiques de la politique, de la culture, des institutions et du savoir de bien des façons inattendues. » Notons, en passant, dans cette introduction, et à rajouter dans la liste en constante extension des recettes « révolutionnaires » pour le moins surprenantes qu’on croise dans la littérature universitaire « radicale », cette suggestion des auteurs : « L’énergie nous fournit un vecteur pour imaginer de façon nouvelle des sociétés définies par l’égalité des chances et des capacités – des communautés dans lesquelles pour la première fois dans l’histoire, nous sommes toujours immédiatement sensibles à nos rapports aux systèmes naturels. Ainsi, et si nos libertés politiques étaient désormais accompagnées d’un volet matériel – une quantité de kilocalories ou d’unités d’énergie de base assignée à chaque individu, déterminée en partie par combien de quantité d’énergie la planète serait en mesure de soutenir? » Un certain inconscient technocratique reste lui aussi à analyser…
La première partie du livre » Energy Modernities : Histories and Futures » qui conjugue théorie et littérature classique pour aborder l’histoire du rapport entre la modernité, l’énergie et l’avenir s’ouvre sur le texte de Dipesh Chrakabarty « Le climat de l’histoire : quatre thèses », qui a été traduit dans la Revue internationale des livres et des idées en 2010 ( n°15).
Le texte de Imre Szeman qui lui succède, « System Failure: Oil, Futurity, and the Anticipation of Disaster », s’intéresse aux enjeux de la fin du pétrole particulièrement pour une « gauche », toujours attachée aux modèles pétro-économiques, qu’ils soient sud-américains ou scandinaves ( la Norvège). Szeman définit trois types de récits qui circulent dans cette « gauche » quant à l’attitude à adopter vis à vis de la question du pétrole : le réalisme stratégique, le techno-utopisme et l’éco-apocalypse. » Ce que je dénomme réalisme stratégique c’est un discours relativement courant concernant le pétrole qui découle d’une approche sur le mode « realpolitik » de l’énergie. Ceux qui l’emploient – et ce discours est largement employé par les gouvernements comme les médias- nuancent ou minimisent les inquiétudes concernant le désastre cumulatif représenté par le pétrole ou le fait que les ressources en pétrole sont en train de s’épuiser, et s’intéressent aux potentielles tensions économiques et politiques qui vont inévitablement apparaître alors que les pays recherchent « individuellement » à assurer leur sécurité énergétique dans une ère de pénurie. (..) Le réalisme stratégique est un discours qui fait de l’État-nation l’acteur central du drame de l’imminent désastre pétrolier, un acteur qui s’engage dans des calculs géopolitiques impitoyables pour assurer la stabilité des économies et communautés nationales. Alors que le pétrole est difficilement séparable des opérations de la finance globale, sa valeur politique en tant que marchandise est telle qu’on ne peut visiblement lui permettre de se répandre de façon autonome sur des marchés dont on nous a seriné qu’ils ne se préoccupaient plus des frontières de nos jours : l’État doit être présent afin d’assurer que chaque jour la bonne quantité de pétrole afflue dans la bonne direction. » On présume qu’ici Szeman avait à l’esprit le modèle bolivarien, dont ce qu’il reste, le régime pétro-prétorien de Maduro semble bien peu en mesure de peser sur quoi que ce soit et n’a visiblement comme horizon stratégique qu’un début de dérégulation « post-socialiste » que même une remontée des prix ne viendra probablement pas freiner…
Suit la perspective techno-utopiste » un discours employé par les officiels gouvernementaux, les écologistes et les scientifiques à travers le spectre politique. Sur la question de la fin du pétrole, il propose deux réponses : soit des avancées scientifiques vont permettre d’accéder à des ressources en pétrole jusque là trop chers à exploiter ( les sables bitumeux de l’Alberta, les réserves en haute mer, etc) tout en mettant au point simultanément des solutions pour remédier aux émissions de carbone ( des absorbeurs-neutralisateurs, le piégeage de carbone, etc) ou des innovations technologiques qui vont créer des formes entièrement nouvelles d’énergie comme les piles à combustible à hydrogène. (…) Toutes nos pires inquiétudes concernant le chaos qui va se déployer quand les réserves de pétrole seront épuisées sont dissipées grâce aux innovations scientifiques qui sont parfaitement synchrones avec les opérations de l’économie capitaliste, sans qu’il y ait besoin de ruptures radicales dans la vie politique et social. »
Enfin le discours de l’éco-apocalypse » contrairement aux deux autres discours comprend qu’un changement politique et social est fondamental pour faire face de façon consistante au désastre de la fin du pétrole – un désastre qu’il lie à l’environnement avant l’économie. Néanmoins, puisqu’un tel changement n’est pas à l’horizon ou difficile à imaginer, il conçoit le futur sous l’aspect d’une peinture de Bosch – l’enfer sur une terre obscurcie par un smog étouffant de dioxyde de carbone. (…) Malgré des revendications et des velléités de changer le comportement individuel et la réalité sociale, il y a au coeur des discours éco-apocalyptiques l’idée que rien ne peut arrêter la venue du désastre. De fait, c’est plutôt comme si le désastre était le bienvenu : la fin du pétrole pourrait bien signifier que le capitalisme creuse sa tombe, puisque sans pétrole les configurations actuelles du capital sont impossibles. » L’auteur ne considère certes pas que ces » futurs nationaux, technologiques ou apocalyptiques » aient de l’avenir car » puisque ces discours sont incapables de mobiliser ou de produire une réponse à un désastre dont nous savons qu’il est le résultat direct de la loi du capitalisme – l’accumulation sans limite – il est facile d’imaginer que la nature va finir avant le capitalisme. » On ignorait que ce dernier avait pour intention d’assécher les océans avant de disparaître… Si établir une telle « nomenclature » constitue un effort louable, tant qu’on ne distingue pas un tant soit peu ( mais déjà beaucoup !) les forces sociales que de tels discours signalent ou pourraient prétendre mobiliser, on en reste au niveau des bonnes intentions et du dialogue de sourd avec des catégories qu’on a soi-même créé.
Dans le texte qui suit « The Great White Way », David Nye offre une très riche et pertinente réflexion sur la perception et la représentation ( notamment chez des peintres tels Whistley, Hopper, Stella ) de New-York à l’âge de l’électrification et de ses fameux panneaux publicitaires lumineux, notamment sur la « Great White Way » à Broadway. Suivent ensuite des poèmes de Pablo Neruda , de Stephen Colliset et pour la prose un extrait de « Nombre des villes invisibles » de Italo Calvino ( très sollicité dans cette anthologie) et de « La fille automate » de Paolo Bacigalupi. Le chapitre se clôt sur trois textes : « The Visible Hand of the Sun: Blueprint for a Solar World » de Hermann Scheer qui est un extrait de Le Solaire et l’économie mondiale ( traduit en français chez Actes sud) puis « The Frenzy of Fossil Fuels » tiré de L’effondrement de la civilisation occidentale, (traduit en français aux Éditions les liens qui libèrent) et une reprise de l’article « It’s Not Climate Change—It’s Everything Change » de Margaret Atwood.
La seconde partie « Energy, Power, and Politics » cherche à « examiner comment différentes formes et infrastructures énergétiques permettent différentes configurations de pouvoir politique » car « l’énergie influence aussi la contenu des idées politique, quoique de façon généralement souterraine. En d’autres termes, des modèles d’usage de l’énergie exercent une forme d’effet idéologique, déterminant les termes du discours public et imprégnant la doxa de différentes cultures d’expertise. » Le premier texte étant ,comme on pouvait s’y attendre au vu de cette présentation, un extrait de Carbon Democracy de Thimothy Mitchell ( traduit en français aux Éditions La Découverte).
Suit le texte « Energopower: An Introduction » de Dominic Boyer qui s’appuie notamment sur les intuitions d’une figure peu connue, Leslie White, un anthropologue marxiste hétérodoxe, pour tirer un bilan du rapport de cette discipline aux questions énergétiques : « Si il y a une leçon à tirer de l’histoire du rapport de deux générations d’anthropologues à l’énergie, c’est qu’ils ont accompagné les moments de vulnérabilité ou de transition des régimes dominants d’énergo-pouvoir [ « energopower », terme forgé sur le modèle, quelle surprise !, de biopouvoir, d’où cette alliage disgracieux, Ndt]. Dans le cas de White, sa saisie de l’énergie comme clé pour comprendre toute la culture ( et de fait toute l’existence) humaine a accompagné la révolution de l’énergie nucléaire et ses nouvelles magnitudes de pouvoir créatif et destructeur. Dans le cas de la seconde génération, le contexte était celui des années 70, que Ralph Nader a qualifié de « décennie de l’énergie ». Le choc pétrolier de 1973 signalait la fin d’une certaine phase de contrôle impérialiste occidental sur les énergies fossiles. Une volonté politique passagère d’explorer les sources alternatives d’énergie s’ensuivit, aidant à générer des fissures et secousses energopolitiques qui attirèrent l’attention des anthropologues. L’adhésion politique retrouvée aux énergies nucléaires et carbonées dans le monde industriel des années 80 émoussèrent les aspirations et le sentiment d’urgence à mener des études sur l’énergie en anthropologie comme ailleurs dans les sciences humaines. » Présentant ensuite une rapide généalogie critique de la montée des préoccupations « anti-anthropocentriques » dans les sciences humaines, sans aller toutefois jusqu’à en critiquer les manies ventriloques ( hier « la classe ouvrière », aujourd’hui « la nature »), il propose enfin une définition de son concept ( « Avant tout l’énergopouvoir consiste en une généalogie du pouvoir moderne qui repense celui-ci à l’aune de la double analyse de l’électricité et du combustible ») et une articulation à la notion de biopouvoir, sur le mode circulaire et vaniteux qui domine dans 9/10eme des discours académiques et « radicaux » dès que cette notion entre en jeu.
Lui succède un article de Jean-François Mouhot, « Past Connections and Present Similarities in Slave Ownership and Fossil Fuel Usage« Past Connections and Present Similarities in Slave Ownership and Fossil Fuel Usage », qui est une reprise de ce qu’il a déjà développé dans un livre en français ( Des esclaves énergétiques publié chez Champ Vallon). L’article qui suit, « Imperial Oil: The Anatomy of a Nigerian Oil Insurgency » de Michael Watts, est un des très rares textes de cette anthologie portant sur une réalité concrète. A défaut d’être très original, il rappelle un certain nombre d’éléments de base sur l’imbroglio pétrolier nigérian : sa centralité pour les États-Unis ( 12% de ses importations) et les mesures prises par ceux-ci ( création de l’AFRICOM en 2007, sous prétexte de guerre contre le terrorisme, qui a permis de militariser la protection du secteur), l’ampleur des détournements ( « 85% des revenues du pétrole reviennent à 1% de la population ; prés de 100 milliards sur les 400 milliards de revenus générés depuis 1970 ont tout bonnement disparu ») mais aussi le coût des insurrections locales pour cette industrie ( prés de 400 actes de vandalisme par an, 1 milliard de pertes annuelles en moyenne), etc. Le chapitre se poursuit avec un extrait de la pièce de théâtre « The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil » de John McGrath, l’article « Nuclear Ontologies » de Gabrielle Hecht qui reprend les thèses de son livre ( publié en français aux Éditions Amsterdam ) sur le « rayonnement français » et la manie hexagonale ( qui semble faire consensus jusqu’aux derniers recoins du spectre politique) de se « pousser du col » atomique. Dans « A Dark Art: Field Notes on Carbon Capture and Storage Policy Negotiations at COP17″ Gökçe Günel décrit quant à lui les négociations de la COP 17 à Durban en 2011, notamment le rôle des pays du golfe, leur lobbying et les solutions plus ou moins absurdes qui leur sont suggérés, comme de stocker du dioxyde de carbone dans les champs pétroliers épuisés.
Dans « Gendering Oil: Tracing Western Petrosexual Relations » Sheena Wilson tente une amorce de synthèse un peu périlleuse mais tout de même utile sur le rapport entre pétrole et patriarcat, notamment via une critique de l’imagerie associée à cette source d’énergie : « L’âge du pétrole est rempli d’ironies qui ont résulté à la fois en des avancées féministes en même temps qu’au renforcement de vieilles conceptualisations patriarcales des femmes comme objet et propriété, popularisées via l’omniprésence des images de la féminité telles qu’elles ont été récupérées par les discours capitalistes, consuméristes, néo-libéraux de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. » L’enjeu étant par la consommation et le « spectacle »( dixit Wilson) de subordonner l’émancipation des femmes à la pétroculture à laquelle elle oppose notamment les résistances indiennes à l’exploitation des sables bitumeux au Canada ( le « idle no more movement »). Le texte qui suit « Anthropocenic Ecoauthority: The Winds of Oaxaca » de Cymene Howe est tiré du livre Energopower dont nous traiterons après cette anthologie. Il porte sur la résistance des populations locales à un méga-projet éolien sur l’isthme de Tehuantepec dans l’Etat de Oaxaca au Mexique ( déjà évoqué dans une précédente recension). Ceux-ci s’opposent à la construction du parc car il met en danger leurs activités traditionnelles ( notamment la pèche) et car tout bonnement ce projet rhabille du vieux ( autoritarisme et corruption) avec du neuf et veut leur faire porter le fardeau » des conséquences de la lutte contre le changement climatique et des aspirations du capitalisme vert ». Pour Howe » une tension a émergé entre les perceptions locales des conditions écologiques et la connaissance environnementale qui prétend remédier au changement climatique global. Ces divergences indiquent des façons distinctes d’imaginer et d’articuler ce que j’appelle « l’éco-autorité anthropocénique ». La bonne conscience éco-autoritaire n’en étant effectivement pas à un paradoxe près : » La production d’électricité dans l’Isthme a désormais atteint un gigawatt, soit assez pour fournir de l’électricité à un million de foyers de l’État de Oaxaca. Néanmoins l’électricité n’est spécifiquement pas affectée aux foyers ou municipalités de l’isthme ; elle part plus loin et est achetée par des entreprises comme Coca-Cola, Walmart, Heineken, Bimbo pour réduire leurs coûts manufacturiers et leur impact environnemental. L’électricité est produite mais pas pour les populations locales. »
Le chapitre se clôt de façon assez ubuesque ou du moins excessivement oecuménique sur un extrait de l’encyclique du Pape François sur le changement climatique et l’inégalité.
La troisième partie « Energy in Philosophy: Ethics, Politics, and Being » s’organise autour de la nécessité pour la philosophie de s’emparer de la question énergétique : » Si il y a quelque chose qui lie les différents types d’approches philosophiques de l’énergie représentées ici, c’est que se confronter à l’énergie nous incite à une profondément ré-imaginer beaucoup de nos concepts et interprétations fondamentales. » La partie s’ouvre sur un extrait du livre Bataille’s Peak: Energy, Religion, and Postsustainability de Allan Stoekl qui est une analyse minutieuse de la centralité de la question énergétique dans La part maudite de Georges Bataille dont on peut d’ores et déjà rappeler une des thèses principales : « l’organisme vivant, dans la situation qui déterminent les jeux de l’énergie à la surface du globe, reçoit en principe plus d’énergie qu’il n’est nécessaire au maintien de la vie : l’énergie ( la richesse) excédante peut être utilisée à la croissance d’un système ( par exemple d’un organisme) ; si le système ne peut plus croître, ou si l’excédent ne peut en entier être absorbé dans sa croissance, il faut nécessairement le perdre sans profit, le dépenser, volontiers ou non, glorieusement ou sinon de façon catastrophique. » ( La part maudite p. 49) Selon Stoekl « la théorie de Bataille est profondément éthique : nous devons distinguer entre les versions de l’excès qui sont « à l’échelle de l’univers » dont la reconnaissance et mise en oeuvre garantit la survie de la société ( et la dépense humaine) et d’autres versions qui mène à l’aveuglement quant au rôle de la dépense et de ce fait menace la survie de l’homme et de la planète. » De plus » en considérant l’homme comme un dépensier et non comme un conservateur, Bataille parvient à inverser l’ordre usuel de l’économie : l’impératif catégorique est pour ainsi dire d’augmenter la bonne dépense, ce que nous pourrions perdre de vue si nous mettions l’accent sur un modèle inévitablement égoïste de conservation ou d’utilité. » Néanmoins, Stoekl ne fait pas mine d’ignorer le paradoxe qu’il y a invoquer les mannes de Bataille en cette ère où « le gaspillage de l’énergie semble le principal mal qui menace l’existence de la biosphère de laquelle nous dépendons. » Il souligne d’ailleurs l’influence sur Bataille du scientifique Georges Ambrosino, chez lequel il puise l’idée du surplus inévitable et inépuisable d’énergie et dont l’optimisme témoignerait éventuellement des débuts des applications « pacifiques » de l’énergie nucléaire. De même, « La part maudite nous présenterait donx un étrange amalgame entre la conscience du rôle central que joue l’énergie par rapport à l’économie ( sans parler de la vie en général) et une ignorance volontaire des modes socio-techniques de distribution et d’usage de l’énergie, qui sont beaucoup plus que des détails. On pourrait supposer que l’origine de cette négligence dans la pensée de Bataille se trouve dans la théorie économique et au bout du compte philosophique, à la fois bourgeoise et marxiste de la période moderne, chez qui les ressources en énergie et les matières premières ne rentrent pas pour une bonne partie dans les calculs économiques ( et philosophiques) puisqu’ils sont considérés comme acquis : la terre rend l’activité humaine possible et dans un sens nous donnons un sens à la terre, une dignité en utilisant des ressources qui resteraient autrement inertes, inconnues, insignifiantes. » Néanmoins Stoekl propose un sauvetage de la position de Bataille, et ce, encore une fois, sous l’égide de l’éthique : » L’éthique de Bataille implique le choix entre deux alternatives : la reconnaissance des limites au travers de l’affirmation de la dépense dans une économie générale ou l’ignorance des limites via le déni de la dépense dans une économie fermée ou restreinte. La première suppose l’affirmation du plaisir, de la matière sacrée et de l’énergie, de l’angoisse devant la mort tandis que la seconde suppose l’affirmation égotique de l’utilité et de la croissance sans limites avec tous les dangers que cela suppose.(…) En dépensant nous conservons. L’éthique utopique de Bataille envisage une société qui crée, construit et croît dans et par la perte. Bataille affirme ainsi la continuation d’une collectivité humaine dont l’humanité est inséparable de cette dépense -collective et extatique- générale. Inséparable, en d’autres termes, de la perte de la fixation égoïste sur le savoir, l’autorité et même la rassurante immortalité auquel le terme d’humanité est en général associé. »
Plus déprimant, « Atomic Health, or How the Bomb Altered American Notions of Death » de Joseph Masco interroge les effets de l’ère atomique sur les notions de santé et d’hygiène puisque « Le projet nucléaire américain demandait aux citoyens d’accepter comme normales des conditions sociales qui étaient à la fois pathologiquement insécurisantes et intellectuellement irréconciliables avec la santé. » Ce qu’il illustre notamment par un long parallèle entre le déploiement de la guerre froide et le développement de la consommation d’anti-dépresseurs, tout cela aboutissant selon lui au fait que « Les conséquences sociale de la course aux armements nucléaires ont inversé le concept de santé comme absence de maladie en le remplaçant par une vision de plus en plus naturalisée de la santé comme mort en devenir. » Suit un poème de Laura Watts « The Draukie’s Tale: Origin Myth for Wave Energy » et un texte de Timothy Morton « A Quake in Being » tiré de son livre Hyperobjets. Philosophie et écologie après la fin du monde (paru aux éditions de la Cité du design).
On doit reconnaître au philosophe, qu’on présume « dérridien », Martin McQuillan, d’avoir l’air de ne pas tourner autour du pot de la question du rapport philosophie/énergie dans sa contribution « Notes toward a Post-carbon Philosophy: “It’s the Economy, Stupid” : » La structure spéculative de l’exploitation du pétrole découle et est désormais la base de la la structure de tous les investissements boursiers, immobiliers et des produits fictifs du capital aujourd’hui. Comme dans la philosophie spéculative, elle implique la supposition ou la théorisation d’un événement futur comme pensée du risque ou pensée comme risque qui lie étroitement la philosophie à l’économie fondée sur l’émission de carbone. La question d’une économie post-carbone est donc clairement un enjeu pour la philosophie. (…) Cela veut dire, que tandis que l’idée d’un marché mondial et du « libre échange » de biens a un héritage philosophique provenant du premier humanisme moderne et de la pensée des lumières, notre compréhension présente de l’échange, de la dette et de la foi passe par le pétrole. Parler d’une économie post-carbone pourrait de fait consister à dire quelque chose d’assez radical, compte tenu de notre situation actuelle où notre existence est si intensément dépendante du prix du pétrole. Parler d’une économie industrialisée sans prix du pétrole pourrait signifier d’un côté le passage d’un signifiant transcendental à un autre, comme l’or a été remplacé par le pétrole et comme ce dernier pourrait être remplacé par le commerce de plutonium recyclé. D’un autre côté, il existe ici l’opportunité de comprendre l’économie comme une expérience de la différence et comme une rencontre avec le complétement autre. Cela nécessiterait une autre compréhension de l’économie, qui ne serait pas dédiée à l’utilisation de la richesse. » A ces voeux pieux succède un texte douteux de Roy Scranton « Learning How to Die in the Anthropocene » qui établit un parallèle entre l’expérience de l’auteur comme bidasse dans les troupes d’occupation américaines en Irak et les désordres climatiques en cours et à venir et un texte de Dale Jamieson « Ethics for the Anthropocene » dont l’oeuvre est abondamment commentée en français.
Dans « We Have Always Been Post-Anthropocene: The Anthropocene Counterfactual », Claire Colebrook offre une dense quoique parfois absconse (et en tout cas difficile à résumer) réflexion sur la différence à l’aune du féminisme et de l’anthropocene. Lui succèdent un extrait de l’introduction de Karen Pinkus à son Fuel : A Speculative Dictionary et « Excerpt from Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials » de Reza Negarestani qui est un long parallèle verbeux entre les destins du pétrole et de la religion : « Il semble donc que le processus techno-capitaliste de désertification par la guerre contre le terrorisme et l’éthique du désert du monothéisme radical convergent tous deux autour du pétrole comme objet de production, un pivot de la terreur, un carburant, un lubrifiant politico-économique et une entité dont la vie est directement connectée à la terre. Tandis que pour le techno-capitalisme occidental le désert permet l’essor des machines de guerre et de l’hyperconsommation du capitalisme (…) pour le Jihad le pétrole est un catalyseur pour accélérer l’essor du royaume, le désert. Donc pour le Jihad, le désert se trouve à la fin du pipeline. »
La quatrième partie « The Aesthetics of Petrocultures » part du constat que « La reconnaissance grandissante des voies complexes par lesquelles la culture a été déterminée et marquée par l’énergie a généré certains des travaux les plus saisissants et originaux dans les « Energy Humanities » et promettent de changer à la fois l’analyse culturelle et l’expression culturelle au XXIe siècle. » Sans, certes !, partager ce pronostic triomphaliste, il est vrai que c’est surtout dans ce domaine que les « Energy Humanities » semblent tracer une voie originale et pertinente à rebours des assemblages plutôt confus qui composent les trois précédentes parties. Comme dans ces dernières, il y a ici des poèmes ( « Poems from Endangered Hydrocarbons » de Lesley Battler », « Poems from Shale Play » de Julia Kasdorf, « Excerpt from The Polymers » de Adam Dickinson), des extraits de classique ( Cité de Sel de Abdul Rahman Munif), une nouvelle ( « An Athabasca Story » de Warren Cariou) ainsi qu’un extrait de l’article pionnier de Amitav Ghosh « Petrofiction: The Oil Encounter and the Novel ». On trouve également un certain nombre de réflexions sur le rapport de l’art contemporain à l’énergie. Dans « Petro-Melancholia: The BP Blowout and the Arts of Grief » de Stephanie LeMenager avance que » découpler la mémoire corporelle humaine des infrastructures qui l’ont soutenue pourrait bien être le principal enjeu pour un récit écologique au service de la survie de l’espèce humaine au delà du XXIe siècle ». « This Is Not a Pipeline: Thoughts on the Politico-aesthetics of Oil » est un intéressant dialogue entre l’artiste suisse Ursula Biemann et l’universitaire Andrew Pendakis autour de son oeuvre Black Sea Files ( visionnable sur Vimeo) et de la représentation du pétrole, où Biemann note » Se débarrasser de la perspective anthropocentrique sur le monde dans laquelle tout est transformé en ressource pour les humains est profondément lié à l’acte de représenter comme moyen de déplacer le débat de l’objet pétrole, eau ou or à la signification culturelle que cette chose a pour nous ». Enfin dans « What Does the Culture of Stewardship Look Like ? » Barry Lord, cherche, d’une certaine manière, ce que serait un art de l’ère des « énergies renouvelables » évoquant pour ce faire tant l' »arte povera » que Marina Abramovic.
Le second volet de textes théoriques porte sur la littérature avec notamment la surprenante contribution de Patricia Yaeger « Literature in the Ages of Wood, Tallow, Coal, Whale Oil, Gasoline, Atomic Power, and Other Energy Sources ». Le texte est en quelque sorte un manifeste pour une étude des fictions sous l’angle de l’énergie : « Au lieu de diviser les oeuvres littéraires en intervalles de cent ans ( ou selon des variantes élastiques comme le long XVIIIe ou XXe siècle) ou avec des catégories exploitant l’histoire des idées ( Romantisme, Lumières), qu’arriverait-il si on classait les textes par les sources d’énergie qui les ont rendu possible. Cela voudrait dire aligner les méditations de l’immigrant de Roth sur l’électricité avec les rêveries bourgeoises de Henry Adams sur le « dynamo et la vierge » ou comparer les obsessions carbonifères de David avec celle de Paul, le fils de mineur dans Sons and Lovers de D.H. Lawrence. Nous pourrions juxtaposer les personnages utilisant du suif comme combustible de Dickens avec ceux de Shakespeare ou établir les liens nécessaires entre les combustibles utilisés pour cuisiner et se chauffer dans L’Odyssée et dans Cent ans de solitude. » Cette perspective est poursuivie par Graeme Macdonald dans « The Resources of Fiction » : » La fiction, dans ses différents modes, genres et histoires, offre un réservoir important ( et relativement peu sollicité jusqu’ici) pour les chercheurs s’intéressant à l’énergie pour démontrer comment, à travers les époques successives, des formes particulières d’énergie créent une culture prédominante ( mais aussi parfois alternative) de l’existence, de l’imagination du monde, organisant et permettant un mode prévalent de vie, de pensée, de mouvement, d’habitat et de travail. Dans la modernité industrielle cette culture a été principalement dépendante de l’extraction de combustibles fossiles. La mesure dans laquelle ce régime énergétique a à la fois encouragé et dépendu d’une culture de l’extraction constitue un champ d’investigation prometteur. Pourtant il reste à questionner ce qui doit être effectivement caractérisé comme une production culturelle extractive. Comme je vais le montrer, la conscience fictionnelle offre plus que des histoires sur les types et les systèmes énergétiques. Elle établit un moyen de réflechir sur – et potentiellement de déconstruire- les formidables capacités de représentation du capital énergétique, notamment sa mise en récit de la nécessité naturelle du pétrole pour le fonctionnement du système social. Le système sophistiqué de signifiance du pétrole est ainsi parvenu à maintenir la position de marchandise ur-fétichisée du capitalisme globalisé moderne de celui-ci. »
Comme nous l’avons signalé plus haut, à l’issue de la lecture de cette anthologie, certes divertissante puisqu’on passe en quelque sorte du coq à l’âne et ce d’ailleurs sans que la réalité ne soit beaucoup sollicitée si ce n’est sous la forme de grands concepts méta-historicisés qui autorisent tous les développements incantatoires, on constate c’est surtout du côté de l’analyse esthétique que les « Energy Humanities » semblent en mesure d’apporter du neuf…
Faute de temps et de courage nous ne rendrons finalement pas compte ici du volume Energopolitics : Wind and Power in the Anthropocene (Duke University Press, 2019) où Dominic Boyer présente à la fois une réflexion théorique sur les apports éventuels de l’anthropologie à l’analyse de l’anthropocene et les notions de capital, de biopouvoir et d’energo-pouvoir, et une enquête ethnographique menée sur le fameux isthme de Tehuantepec dans l’État de Oaxaca au Mexique, où l’auteur constate que « pour comprendre la politique éolienne contemporaine dans l’isthme de Tehuantepec, on doit comprendre, parmi d’autres choses, l’histoire contestée de la propriété de la terre, du caciquismo et des mouvements d’opposition des étudiants/professeurs/ paysans/travailleurs/pécheurs spécifiques à la région ; le statut fantasmatique de la souveraineté étatique au sein du fédéralisme mexicain; les réseaux clientélistes et les machinations corporatistes des partis politiques mexicains ; les héritages de la colonisation de peuplement ; un gouvernement fédéral anxieux devant l’épuisement de son pétropouvoir et le changement climatique ; et une entreprise de production d’électricité para-étatique vulnérable tentant d’assurer son avenir dans une ère de « réforme de l’énergie ». Ces forces sont tout aussi importantes dans la politique éolienne du Mexique que les processus et dynamiques que saisissent partiellement des concepts comme le capital ( sic! Ndt), le biopouvoir et l’énergo-pouvoir. Energopolitics est donc une invitation urgente à la théorie politique de l’anthropocene à se reconstruire via une processus de récherche sur le terrain et de réflexion ethnographiques. »
Working for Oil
Working for Oil. Comparative Social Histories of Labor in the Global Oil Industry Édité par Touraj Atabaki, Elisabetta Bini et Kaveh Ehsani, Palgrave Macmilan 2018.
Pouvant paraître, au vu du sommaire, un brin scolastique et roboratif ( plus de 400 pages), Working for Oil constitue au contraire une très sérieuse et très utile introduction à cet aspect central de la « question », trop peu abordé malgré la « révolution copernicienne » proposée par Carbon Democracy de Timothy Mitchell. Plus encore, le recueil offre via la diversité et densité des textes qu’il réunit, un nouveau regard sur plusieurs aspects de l’évolution du capitalisme, des cycles de luttes ouvrières et de restructuration de ces soixante-dix dernières années et ce, sous plusieurs latitudes.
Dans leur introduction les éditeurs, Touraj Atabaki, Elisabetta Bini et Kaveh Ehsani commencent par constater : « Tandis que le rôle des travailleurs du pétrole et des rapports de classe et de travail dans l’industrie pétrolière globale avaient été l’objet d’une grande attention de la part des chercheurs durant la majeure partie du XXe siècle, la période qui s’est ouverte avec les années 80 a été marqué par un déclin profond d’intérêt pour le sujet, au point qu’à présent l’analyse du rôle vital du travail dans tous les aspect du complexe pétrolier global est soit ignorée, soit écartée comme n’ayant que peu d’importance. » Il faut bien sûr y voir, là comme ailleurs, un écho des effets de la restructuration qui est venue répondre aux cycle de luttes des années 60/70 : « Les nouvelles technologies et formes d’organisation du travail ont abouti à l’emploi de moins de travailleurs et à l’embauche de plus d’employés temporaires qui étaient souvent moins syndiqués mais arrivaient avec des qualifications plus spécifiques et cherchaient plus à changer régulièrement de lieux de travail. Cette force de travail plus flexible et plus mobile tendait à être moins intégrée dans les sociétés locales, moins organisée et imprégnée de l’histoire syndicale et des luttes ouvrières. Aujourd’hui l’industrie pétrolière est caractérisée par la prévalence des contractuels et des travailleurs externes à l’entreprise. Beaucoup de travailleurs travaillent pour plusieurs compagnies en même temps, ils sont plus précaires et vulnérables et se retrouvent souvent à travailler dans des conditions dangereuses comme l’a illustré le désastre de Deepwater Horizon. Le relatif (et momentané ?) déclin de l’organisation collective est donc tout autant partie intégrante de l’analyse des rapports sociaux dans le pétrole que le sont les moments de lutte spectaculaires et les victoires dans les négociations avec les employeurs ou les confrontations avec les gouvernements nationaux. »
Présentant plus spécifiquement l’ensemble de textes, les éditeurs précisent : « Dans ce recueil, les rapports de pouvoir ne sont pas seulement traités en termes de dynamique de classe, mais concernent tout autant l’usage des différentiations culturellement imposées de genre, de race et d’ethnicité. Les expériences difficiles des travailleurs migrants, les conditions aliénantes et déracinées auxquelles sont confrontés les experts expatriés dans leurs enclaves isolées, la double discrimination que connaissent les femmes dans divers secteurs du complexe pétrolier et la manipulation par les employeurs des tensions entre les ouvriers et employés de différentes couleurs de peau et/ou origines nationales ou ethniques ont représenté et continuent de représenter une dimension centrale de l’expérience des travailleurs dans le complexe pétrolier. Les essais qui suivent cherchent à aborder les histoires sociales et expériences vécues variées du travail dans l’industrie pétrolière globale depuis ces perspectives diverses et entrecroisées. » On remarquera que comme souvent l' »intersectionnel » tient plus du numéro obligé que du grand méchant loup dont on nous rebat les oreilles…
En tout cas, « Les essais du livres sont organisés autour d’une série de thèmes corrélés et divisés en trois sections : La première partie, « La vie politique du travail » examine les rapports de pouvoir au sein de la force de travail et entre la force de travail et les employeurs et les institutions politiques de l’État. Ce thème englobe les formes variées de représentation collective, comme les syndicats et les associations de même que l’implication du secteur pétrolier et de ses travailleurs et employés dans les changements politiques plus généraux. La seconde partie » La vie productive du travail », s’intéresse aux rapports de travail dans les champs pétroliers, les raffineries, les complexes pétro-chimiques, les ports, les entreprises de construction de pipelines, etc. Ces essais analysent les dynamiques des formes variées de qualifications, de connaissances pratiques et d’expertise et leurs implications pour la vie professionnelle de ceux qui travaillent dans le complexe pétrolier. La troisième partie » La vie urbaine et sociale du travail » se penche sur la reproduction du travail en dehors du lieu de travail. Les textes examinent les dynamiques de vie dans les villes fondées par les compagnies et les communautés urbaines ou autre, les rapports de genre, les dynamiques culturelles et les tensions, les frictions quotidiennes et les négociations entre ceux qui travaillent dans différents secteurs du complexe pétrolier et les sociétés locales, nationales et transnationales. »
C’est dans le premier texte, « Disappearing the Workers: How Labor in the Oil Complex Has Been Made Invisible »de Kaveh Ehsani qu’on trouve une introduction plus « théorique » au recueil. Ehsani reformule tout d’abord plus précisément le constat de cette « disparition des travailleurs du pétrole » : « Il est étonnant, qu’à quelques rares et notables exceptions, ces dernières décennies, l’attention des historiens et des chercheurs en science social qui enquêtent sur l’impact social, spatial , économico-politique et environnemental du pétrole s’est complétement détournée de toute velléité de prendre en compte l’agency et le rôle du travail dans ce secteur. Il en résulte que la majorité du travail académique sur l’impact social du pétrole tend à une formulation du pétrole comme forme de propriété foncière ou valeur détenue par des corporations ou des gouvernements, une source de revenus (ou une rente) discutable, une ressource stratégique ou un enchevêtrement mystérieux d’infrastructures technologiques. » Il réfute ensuite les arguments habituellement avancés pour disqualifier l’étude de la situation et des luttes des travailleurs du pétrole, qu’il s’agisse de l’intensité capitalistique du secteur, toujours plus relative qu’on veut bien le faire croire, de la vieille rengaine de « l’aristocratie ouvrière » qui ne dit bien évidemment rien de la grande variété des statuts et des processus globaux de précarisation ( y compris pour les travailleurs expatriés) ou de cet enclavement, vieux comme l’industrie pétrolière, qui rendrait les travailleurs du secteur étrangers à toute réalité sociale nationale. Soulignant encore le simple mépris plus ou moins ouvertement professé par les « chercheurs radicaux » ( ça alors !) , ici ceux des « Energy Humanities », pour les travailleurs du secteur, Ehsani critique également les bons vieux passe-partout de la rente ( chez les marxistes) ou de la « maladie hollandaise » ( chez les économistes) : « Définir les États comme « rentiers » ou comme des pétro-États, prétendre que le « pétrole » et les revenus qu’il génère sont une malédiction qui mène inévitablement à la corruption politique et à une déformation de la société civile débouchant sur une « pétro-société » est à la fois a-historique et trompeur si on accompagne pas ces qualifications en situant l’économie politique changeante du pétrole dans une analyse rigoureuse des histoires politiques et sociales et en prenant en compte le contexte géopolitique dans lequel les gouvernements nationaux opèrent. (…) Avec de telles interprétations, il n’est plus nécessaire d’analyser les rapports de classe au coeur du complexe pétrolier, puisque le pétrole est présenté en termes purement économiques et financiers et non comme un réseau d’activités industrielles et extractives qui sont basées sur la coordination sociale et des rapports conflictuels de pouvoir. »
Bien sûr cette « disparition » n’est pas simplement le fruit de la paresse intellectuelle qu’elle soit académique ou critique mais c’est bien aussi une « conséquence des politiques et stratégies adoptées par les employeurs et les gouvernements cherchant à maximiser les revenus et à minimiser le potentiel de perturbation représenté par les luttes ouvrières ». Ehsani illustre ce processus en détail avec le cas iranien, notamment la répression qui suit la prise du pouvoir de 1979 puis le démantèlement des zones de socialisation ouvrière articulé avec la guerre Iran-Irak puis la précarisation/ privatisation jusqu’à aujourd’hui : « L’expérience du travail dans l’Iran post-révolutionnaire indique que plutôt que d’être devenus insignifiants, les travailleurs du pétrole ont perdu la possibilité de faire sentir leur présence, car ils sont activement rendus invisibles. Ce développement est le résultat d’un certain nombres de manoeuvres interconnectées qui comprennent la répression des syndicats et des partis politiques indépendants, et les tournants drastiques de l’après-guerre dans la politique étatique passant de la redistribution populiste à la rationalité du marché. Cela a continué avec la réorganisation des lois du travail en faveur des employeurs et la mise en oeuvre de changements structurels au sein du secteur public du pétrole et du gaz qui ont ouvert la voie à une privatisation rampante. » Notons que si l' »‘invisibilisation » tient presque désormais du « lieux commun sociologique », particulièrement en France, on a effectivement dans le cas des travailleurs du pétrole la démonstration d’un de ses effets centraux, c’est à dire de rendre proprement « illisible », en occultant une des dynamiques primordiales de son histoire et de sa structuration, une des industries pivots de l’économie mondiale.
La raison la plus effectivement « objective » de cette invisibilité c’est bien sûr l’organisation géographique de l’extraction du pétrole et le modèle de l’enclave très tôt adopté par cette industrie. Plusieurs contributions au recueil reviennent sur cette histoire dans divers zones du monde et permettent d’en apprécier la complexité. C’est notamment le cas de l’article « The Zero-Sum Game of Early Oil. Extraction Relations in Colombia: Workers, Tropical Oil, and the Police State, 1918–1938 » de Stefano Tijerina qui décrit les aléas successifs de l’importation de ce modèle par les compagnies américaines en Colombie. Comme partout ailleurs, après des débuts « prometteurs » la logique ségrégationniste appliquée au sein même des enclaves finit par déclencher une série de révoltes des travailleurs locaux et l’implication grandissante des populations environnantes, forçant les compagnies et leurs obligés politiques locaux à naviguer à vue entre concessions et répression. Le cycle retracé par Tijerina se caractérisant, comparé à d’autres régions du monde, par une très forte combativité ouvrière à partir de la première révolte d’octobre 1924, qui se répercute en grèves violentes en 1927, 1935, 1938 puis 1948 et enfin, selon l’auteur, jusqu’à aujourd’hui.
Malgré cet enclavement, les travailleurs du pétrole auront au XXe siècle souvent joué un rôle primordial dans les luttes au niveau national et particulièrement au sud les luttes anti-coloniales et anti-impérialistes mais aussi post-coloniales. La participation des travailleurs du pétrole iranien au renversement du régime du Shah constitue un des exemples les plus emblématiques de cette autre histoire. Dans « Fluid History: Oil Workers and the Iranian Revolution », Peyman Jafari revient très en détail sur cet épisode. Comme il le rappelle dans son introduction : » Bien qu’il y ait d’autres exemples historiques d’une mobilisation de masse des travailleurs du pétrole, les grèves du secteur de septembre 1978 à février 1979 en Iran, sont, à ma connaissance, le seul cas où des grèves de ce type ont déterminé l’issue d’une révolution. » Ce qui intéresse plus particulièrement Jafari c’est la situation de « double pouvoir » qui s’installe au début de 1979 et comment l’Ayatollah Khomeini et ses partisans parvinrent à prendre progressivement le « contrôle » des grèves, du moins à les « subsumer », avant, une fois le renversement du Shah accompli, de progressivement réprimer toute velléité d’autonomie des travailleurs. Pour Jafari, « l’histoire du rapport entre pétrole et politique et son rôle dans la révolution iranienne semble être plus contingent ou fluide que ce qu’on pourrait penser. Les forces islamistes autour de Khomeini auraient pu échouer à prendre le complet contrôle des grèves pétrolières si leur discours idéologique et leur organisation politique avaient été concurrencés de façon plus efficace par les discours alternatifs et les organisations qui défendaient l’autonomie des organisations ouvrières. » Il constate pourtant lui-même que les travailleurs échouèrent à réaliser le « saut qualitatif » du développement de cette autonomie en une coordination nationale, ce qui les rabattait inexorablement sous la coupe des organisations « de base » islamistes tandis que les diverses organisations gauchistes, classiques ou islamiques, et le Toudeh stalinien étaient évidemment bien incapables de « s’entendre ». Cet article de Jafari constitue en tout cas une contribution importante aux débats d’hier et aujourd’hui sur ce qui était effectivement possible durant ces quelques mois, ce qui témoigne pour le moins de la portée d’événements qu’on voudrait trop souvent occulter « sous la barbe » de « l’islamisation » ultérieure.
Signe de la diversité des contributions au recueil, l’article qui suit, « Norwegian Oil Workers: From Rebels to Parters in the Tripartite System » de Helge Ryggvik, porte certes sur une toute autre aire géographique et cadre de rapports sociaux. Ayant échappé à la « maladie hollandaise » et aux affres qui accompagnent la rente et de sa « redistribution » ( grâce notamment à son fameux fonds souverain), la Norvège se targue de surcroît du succès du système tripartite qui gouverne le secteur pétrolier : » Quand les politiciens norvégiens vantent les mérites de l’expérience pétrolière du pays, les rapports étroits et sereins entre les travailleurs, les compagnies pétrolières et l’État ( le système tripartite) font partie intégrante de leur récit. Le système tripartite n’est pas propre à la Norvège mais il appartient à ce qu’on appelle le modèle scandinave. » ( Helge Ryggvik). Pourtant comme le rappelle l’article, ce ne fut et n’est certainement pas un long fleuve tranquille. Ryggvik souligne ainsi le lourd tribut payé par les travailleurs du fait des accidents du travail, ainsi lors des catastrophes à répétition sur la plate-forme d’Ekofisk ( fuite massive de pétrole en 1977, retournement de la plate-forme le 27 mars 1980 qui fait 123 morts) et aussi les nombreuses luttes qui ont jalonné les années 70, notamment la série de grèves très dures qui débute en 1978. » Les mouvements parmi les travailleurs pétroliers n’ont pas d’équivalent dans l’histoire du rapport capital/travail de l’après guerre en Norvège. Une étude montre qu’en moyenne entre 1978 et 1985, les travailleurs du pétrole se sont mis en grève 26 fois plus que les autres travailleurs dans le pays. Le niveau de mobilisation était particulièrement élevé entre 1978 et 1981. La plupart des grèves était entièrement contrôlée par la base. Quand une grève éclatait il y avait toujours de gros groupes de travailleurs qui revenaient de leur temps de repos à terre dans les terminaux d’hélicoptères, d’où les travailleurs et l’encadrement étaient embarqués et débarqués. Les plates-formes étaient de fait souvent occupées par les travailleurs. Si des hélicoptères avec des managers ou d’autres membres du staff que les travailleurs ne voulaient pas voir à bord tentaient d’atterrir, de nombreux travailleurs se couchaient sur l’héliport pour bloquer leur atterrissage. Cet engagement complet et de longue durée et le fait que la plupart des grèves finissaient sur une victoire a donné non seulement naissance à de forts collectifs de travailleurs mais aussi à une génération de shop-stewards sur d’eux-mêmes et bien entrainés. » Ryggvik trace le parallèle avec un cycle de lutte précédent de l’histoire du pays : « Les actions des travailleurs du pétrole de la fin des années 70 montraient beaucoup de similitudes avec la rupture radicale dans le mouvement ouvrier norvégien autour de la première guerre mondiale quand des investissements étrangers ont mené à une industrialisation centrée autour des ressources hydroélectriques du pays. Comme pour cette précédente période, le point de départ économique dans la dernière partie du XXe c’était une industrie nouvelle en rapide expansion, franchissant constamment de nouvelles obstacles via l’interaction entre les humains, la nature et la technologie. Une génération de jeunes travailleurs ont marqué cette nouvelle époque par l’action directe, un activisme à la base et une critique de la bureaucratisation des syndicats traditionnels. (…) Tandis que le bouleversement dans le mouvement ouvrier norvégien autour de la première guerre mondiale a posé les bases d’une social-démocratie norvégienne relativement radicale, la rébellion des travailleurs du pétrole dans la dernière partie XXe siècle était par bien des aspects une réaction contre la social-démocratie elle-même. »
Le retour de bâton de la part des compagnies et de l’État prit plusieurs formes. Les travailleurs espagnols, portugais et latino-américains qui avaient été en pointe des luttes furent progressivement chassés du secteur. Une campagne sournoise, accompagnant la décision de « nationaliser » la rente c’est à dire d’en affecter la gestion de la majeure partie à l’État et non de la redistribuer directement, décrivit les travailleurs du pétrole comme des acteurs cupides cherchant à détourner la manne à leur profit au détriment de l’intérêt général ( et ce alors que les compagnies pétrolières faisaient des profits records). Enfin les forces classiques de la bureaucratie syndicale et de la restructuration permirent de remettre progressivement au pas les travailleurs norvégiens dans les années 90. Mais rien n’est jamais complétement acquis comme le prouvent par exemple la grève d’octobre 2020 puis celle évitée de justesse en février de cette année dans la plus grande raffinerie du pays… Et on s’aperçoit en tout cas que « malgré » une « harmonie » qui tient plus du façadisme que de l’éteignoir ou d’ornières spatiales ( les plates-formes pétrolières) moins pétrifiantes qu’il y paraît, il y a apprendre sous toutes les latitudes même celles qu’on pourrait penser les plus vouées à « l’inertie » sociale.
Même si, bien sûr, les deux situations n’ont rien à voir, c’est aussi autour de la positions relativement « privilégiée » des travailleurs du pétrole et de ce qu’ils en font que porte le texte qui suit, « The Role of Labor in Transforming Nigerian Oil Politics » de Andrew Lawrence. Effectivement constate Lawrence : » Bien que l’industrie dans son ensemble emploie une proportion relativement importante de nigérians, les travailleurs du pétrole ne sont pas représentatifs de la société dans laquelle ils vivent et travaillent. Ils ne représentent qu’une petite fraction de la force de travail formelle du pays. Ils tendent à gagner des salaires plus élevés que les travailleurs d’autres secteurs, ils s’agit de façon écrasante d’hommes qui viennent d’autres régions que celles du Delta et bien que ce soient des firmes privées qui emploient la majorité de ces travailleurs du pétrole, leurs conditions d’emploi sont la conséquence directe de l’intervention de l’État. La politique des rapports de production dans l’industrie pétrolière au Nigeria démontre aussi les effets de long terme du fort investissement de l’État et de la tentative de subordination corporatiste des travailleurs au sein des structures étatiques lors de la dictature militaire des années 70. Leur statut privilégié et minoritaire semblerait peu propice à l’engagement dans des cycles de contestation prolongés et de grande ampleur. » Pourtant selon l’auteur c’est » précisément car le pétrole a colonisé un segment majeur de l’économie politique nigériane, qu’à des moments clés les travailleurs du pétrole sont capables d’exercer une pression bien plus importante que ne le laisserait présumer leur nombre. (…) Ils ont assumé un rôle de premier plan dans les luttes pour la démocratie- utilisant paradoxalement la dépendance du pays au pétrole au bénéfice de la société en général. » L’auteur retrace ainsi l’histoire de plusieurs interventions décisives de ces travailleurs et de leurs syndicats dans les processus politiques nationaux et régionaux, ainsi donc dans la transition vers un pouvoir civil en 1999 mais aussi en soutien aux luttes des peuples du Delta par la suite. Il en tire cette conclusion : « En reconnaissant la variété des processus politiques au Nigeria, cet essai cherchait à démentir la simplicité des théories de l’État-rentier. Il montre que les thèses sur l’édification de l’État sont excessivement étatistes et négligent beaucoup trop l’influence relative des syndicats ouvriers dans la constitution de l’arène politique. L’expérience des travailleurs nigérians du pétrole montre qu’avec une mobilisation au bon moment ils pouvaient par leur action collective exercer une grande influence dés lors qu’une opportunité politique se présentait. Théoriser la démocratisation dans des sociétés riches en pétrole suppose de considérer la centralité des acteurs politiques domestiques, et de façon notable les travailleurs du pétrole qui tiennent la clé de l’explication de la longévité (ou de la fragilité) des réformes économiques, des formes de gouvernance et des régimes politiques en général. » On pourrait penser ici, entre autres, aux travailleurs de la Sonatrach en Algérie qui malgré quelques tentatives n’ont pas lors de la première phase du Hirak pu faire changer la donne face au pouvoir…
C’est un encore autre type d’investissement dans la politique nationale ( ou plus exactement ses rendements décroissants) qu’évoque le texte qui suit, « Organized Labor and the Petro-nation During the Neoliberalization of the Oil Industry in Ecuador » de Gabriela Valdivia et Marcela Benavides. En effet les travailleurs du pétrole équatoriens ont largement et depuis longtemps occupé la scène publique en érigeant la défense de leur statut et le refus de la privatisation en une « économie morale collective de défense du pétrole comme patrimoine national ». Mais l’ancien président Rafael Correa, ayant décidé d’en finir avec ceux qu’il rangeait dans la catégorie des » burocracias doradas », s’était, après quelques gesticulations rhétoriques national-gauchistes, rangé à la position d’un privatisation inévitable de certains actifs voire de la totalité de la société nationale, Petroecuador. Après que le syndicat des travailleurs du pétrole, la FETRAPEC, ait dénoncé la manoeuvre, » Correa répondit d’une main de fer, cherchant a casser l’influence de la FETRAPEC parmi les travailleurs du pétrole. Tandis que les leaders du mouvement considéraient qu’ils dénonçaient le « néo-libéralisme caché » de Correa, ce dernier les requalifiait en « mafia du pétrole » entravant le progrès. Prenant appui sur des changements dans les lois sur le travail qui limitaient l’engagement politique dans l’entreprise, des mesures visèrent particulièrement les leaders du syndicat lors de la rationalisation de Petroecuador. » Le tout accompagné de vastes campagnes de propagande matinée d’écologie au succès probable vu la piètre estime dans laquelle sont tenus ces syndicats, particulièrement dans le secteur de l’énergie, dans les populations latino-américaines ( expérience personnelle, à plusieurs reprises et dans plusieurs pays de l’auteur de cette « recension » !). Malgré les déboires ultérieurs de Correa, la FETRAPEC ne s’est jamais remise de cette période et comme le conclut, à leur manière, les auteurs : « Le travail organisé [au sens syndical] avait les caractéristiques d’une aristocratie ouvrière mais combinait cela avec une pétro-éthique sophistiquée de la citoyenneté qui alimentait sa capacité de résistance mais le rendait aussi vulnérable aux changements structurels dans l’industrie pétrolière. L’essor et le déclin de la FETRAPEC témoigne de la nature organique des mouvements sociaux et de comment leurs contextes changeants importent pour la continuité de leur pertinence. »
Après ces premières évocations de travailleurs du pétrole, qui, malgré les conditions spécifiques au secteur, s’avèrent finalement pleinement impliqués dans leur « cadre national », le texte de Touraj Atabak « Indian Migrant Workers in the Iranian Oil Industry 1908–1951 » constitue une étrange exception. Il est en effet le seul du recueil à traiter des travailleurs migrants ou expatriés non occidentaux, qui constituent pourtant une part importante de la force de travail mondiale dans le secteur et ce de surcroît pour une période certes peu connue mais trop ancienne pour qu’elle soit très pertinente pour comprendre cet aspect des choses, même sur le temps long. Certes il y a une certaine ironie a évoquer la trajectoire de ces travailleurs du sous-continent dans l’industrie pétrolière iranienne avant qu’on leur substitue des travailleurs locaux quand on sait que ce sont les travailleurs sud-asiatiques qui ont progressivement remplacé à partir des années 70 les travailleurs locaux et régionaux dans les pays du golfe. Atabak retrace en tout cas en détail les mécanismes de recrutement mis en place par les autorités coloniales, le système de ségrégation à trois étages dans les exploitations ( européens/ indiens/ perses), les quelques luttes menées dans les années 20 par ces travailleurs expatriés et surtout la montée en puissance du prolétariat pétrolier iranien et ses luttes (notamment la sanglante grève de juillet 1946) qui aboutirent à la nationalisation du pétrole en 1951 et au départ des derniers travailleurs indiens. Au moment ou la réforme de la fameuse Kafala est en train d’effectivement se concrétiser dans des pays du golfe tentés de renationaliser autant que possible l’emploi, y compris dans pétrole et alors que même les plus qualifiés des travailleurs expatriés semblent ne pas devoir être épargnés par les restructurations en cours et à venir du secteur, il est effectivement regrettable que cette, par ailleurs très instructive, collection de textes n’ait pas traité le sujet plus en profondeur….
Les deux textes qui suivent, « Cat Crackers and Picket Lines: Organized Labor in US Gulf Coast Oil Refining » de Tyler Priest et « White-Collar Wildcatters and Wildcat Strikes: Oil Experts, Global Contracts, and the Transformation of Labor in Postwar Houston » de Betsy A. Beasley, permettent par contre d’avoir un intéressant aperçu de la trajectoire des travailleurs du pétrole états-uniens. Priest rappelle que si le sud des États-unis a toujours été considéré comme « une terre de mission » pour les syndicats américains, les raffineries de la côte américaine du golfe du Mexique ont été des bastions du syndicat OWIU, affilié au CIO. Priest donne notamment cette explication : « Réussir la syndicalisation dans le secteur pétrolier américain n’était réellement possible que dans le secteur du raffinage. Les travailleurs des champs pétroliers (…) étaient largement dispersés à travers les régions de production. Ils se déplaçaient de communautés en communautés, de champs en champs et de puits en puits, ne restant jamais dans un endroit assez longtemps, ou assez nombreux pour mener une lutte collective contre les patrons. Les raffineries par contre étaient des installations fixes et permanentes qui rassemblaient un grand nombre de travailleurs au même endroit. Elles étaient aussi le goulet d’étranglement des flux de pétrole allant des puits au consommateur. Si les travailleurs bloquaient une série de puits ou même un champ entier, la production pouvait toujours être maintenue ailleurs. Les grandes raffineries au contraire transformaient le pétrole brut venant de différents champ et régions. La cessation des opérations dans une seule d’entre elles pouvait sévèrement perturber les marchés du pétrole et réduire les profits de l’entreprise. A partir des années 30 la région de la cote du golfe était celle qui comptait les plus grosses raffineries, ce qui en faisait une cible prioritaire pour l’action syndicale. » Ombre au tableau de cette implantation réussie : même au zénith de sa puissance dans les années 50 et malgré ses proclamations officielles le syndicat ne parvint jamais à mobiliser ses militants et a fortiori les travailleurs pour abolir la barrière de couleur et le système de ségrégation dans l’emploi pourtant de plus en plus contesté par les travailleurs noirs et mexicains.
Le paradoxe étant, comme toujours, que cette division, certes savamment entretenue par les entreprises et diverses boutiques politiques et « syndicales » ne constitua au bout du compte pour ces ouvriers blancs qu’un bien maigre lot de « compensation hiérarchique » puisqu’après des années fastes dans la confrontation avec le patronat du secteur, l’orée des années 60 marque le début d’un abrupt déclin. Comme le retrace longuement Priest c’est la grève de 1962-1963 dans les raffineries Shell qui constitua » un tournant décisif pour le travail syndiqué dans les raffineries américaines. La OWIU et la OCAW [son équivalent dans l’industrie pétro-chimique] étaient sorties victorieuses des années 40 et avaient affirmé leur influence croissante sur la détermination des salaires et les conditions de travail dans les années 50. L’épreuve de force avec Shell révéla néanmoins crument les limites de ce pouvoir syndical. L’OCAW perdit son plus efficace argument de négociation : la grève. Avec l’automation naissante, la menace de fermer les sites grâce à une grève s’avéra vite être une formule creuse et les syndicats entrèrent dans une ère de déclin progressif. Dans le même temps le personnel technique et d’encadrement appris durant cette grève à opérer les raffineries en l’absence de travailleurs ce qui limita le pouvoir de négociation de ces derniers sur tous les sujets. » Et la boucle fut progressivement bouclée, comme le conclut l’auteur : « Bien qu’à son apogée l’OWIU-OCAW se soit accommodée de la suprématie blanche, le déclin du syndicat fut compensé par certains acquis que les minorités finirent par arracher grâce à leurs luttes pour l’égalité sur le lieu de travail. A la fin des années 60, les décrets présidentiels interdisant les discriminations dans les organismes fédéraux forcèrent le management des raffineries à démanteler ce qui restait du système de travail à « deux vitesses ». Quand les minorités et les femmes gagnèrent finalement l’accès plein et entier aux emplois dans les raffineries, ces emplois n’offraient toutefois plus les avantages économiques et la sécurité dont avaient bénéficié les travailleurs blancs dans les raffineries syndicalisées une génération auparavant. Comme dans beaucoup d’industries américaines, la réduction de l’emploi dans les raffineries depuis les années 70 a sapé l’efficacité des mesures anti discriminatoires. Avec moins de jobs disponibles, la polarisation raciale s’est accrue et beaucoup de travailleurs blancs ont commencé à considérer que les syndicats faisaient partie de l' »establishment libéral » dont les programmes d' »affirmative action » donnent aux minorités des avantages injustes. » On a en quelque sorte ici un résumé expresse du « cycle américain » et de ses particularités, avec la centralité de la question « raciale » qui joue sur la précocité du repli des luttes et de la combativité ( pour le monde ouvrier le retournement a d’une certaine manière lieu dés 1965 et les émeutes de Watts), la longue agonie de la vieille coalition syndicalo-politique « progressiste » ( le « Hard Hat riot« , les émeutes contre le « busing » , etc) et une restructuration là aussi entamée plus tôt qu’ailleurs et peut-être plus immédiatement radicale ( dans l’automation comme dans les délocalisations). Même si au bout du compte l’ombre portée de ce délitement et de la restructuration produit les mêmes effets qu’ailleurs…
Le second texte de Betsy A. Beasley qui porte plus spécifiquement sur la capitale texane du pétrole, Houston, constitue un bon complément au texte de Priest. Son intérêt est notamment de se concentrer sur la trajectoire plus spécifique de cette ville dans les évolutions de l’industrie pétrolière dés lors que le pacte fordien est rompu. Pour Beasley » le passage de Houston d’une ville à prédominance ouvrière à celle d’une ville de cols-blancs ne fut pas un accident de l’histoire : il s’agissait au contraire d’une stratégie délibérée poursuivie par les dirigeants des compagnies pétrolières qui cherchaient à faire rentrer dans le rang des travailleurs indisciplinés. » Cela fut facilité par l’internationalisation qui permit à la ville de prendre un nouveau rôle de pole logistique et financier de gestion d’une production plus que jamais transnationale. Comme une forme de prologue à ce nouvel âge, Beasley évoque également le tournant décisif de la grève de 1962-1963 chez Shell, car elle y voit une sorte de victoire des cols-blancs sur les cols-bleus : « Ces évolutions de l’industrie- l’investissement dans la lutte anti-syndicale, la priorité donnée aux cols-blancs et la relocalisation ailleurs des emplois cols-bleus d’extraction et de raffinage- culminèrent lors de la grève à Shell en 1962. (…) Pour Shell, la grève fut une « opportunité pour essayer de nouvelles manières d’opérer » Les agents de maitrise, les ingénieurs, les employés de bureau, les comptables, les secrétaires et les sténos prirent en charge l’usine, travaillent par garde de 12 heures sept jours par semaine. Le vice président de Shell chargé du personnel et des ressources humaines, John Quility, expliquait ainsi que l’enthousiasme de cols-blancs : » Les contremaitres, les ingénieurs ils veulent mettre leur main sur ces unités depuis des années. Ils ont voulu montrer à ces opérateurs qu’ils pouvaient les faire tourner. » On a là effectivement une forme pour le moins littérale de « tertiarisation » !
Dans le texte qui suit, « Heroic “Black Gold”? Working for Oil and Gas in the Western Siberian Oil and Gas Complex of the 1960–1970s », Dunja Krempin propose « une étude de cas du travail et des relations de travail dans le complexe pétrolier et gazier de l’ouest de la Sibérie dans les années 60 et 70. » Décrivant les modalités de recrutement puis d’installation et de travail sur place, elle détaille comment la propagande de l’ère brejnévienne, vantant plus un socialisme » de welfare » que de « sacrifice », participe de la construction de la Sibérie comme nouvelle » Frontière », ce qui n’empêchera pas cet énième mirage de bonheur par la planification d’être une fois plus dissipé par l’inertie des uns ( les différents échelons de la bureaucratie) et la mauvaise volonté combative des autres ( les travailleurs).
La troisième partie du livre « The Social and Urban Life of Oil » propose de se pencher sur la vie quotidienne des travailleurs du pétrole dans plusieurs contextes. Ainsi « Building an Oil Empire: Labor and Gender Relations in American Company Towns in Libya, 1950s–1970s » de Elisabetta Bini cherche à analyser les rapports qui se développent entre expatriés et autochtones dans les exploitations pétrolières américaines en Libye. S’inscrivant dans la foulée de Robert Vitalis, Bini rappelle que » les firmes américaines exportaient en Amérique Latine, en Indonésie et en Arabie Saoudite un modèle qui prenait ses racines dans les lois Jim Crow [ de ségrégation raciale aux USA] avec ses principes » de suprématie blanche, ses normes de discrimination et de ségrégation et à la marge, de réformisme paternaliste et raciste ». Un tel système s’inspirait et reproduisait les formes de ségrégation qui avaient caractérisé les industries minières de la « Frontière »(…). » Pour Bini les femmes blanches des travailleurs expatriés, enfermées toute la journée dans le camp et avec qui tout contact était interdit aux travailleurs libyens, étaient pourtant « érigées en symbole et en agents de la mission civilisatrice des corporations américaines. » Ne pouvant s’appuyer principalement que sur les souvenirs, futiles ou biaisés, de ces expatriés, Bini parvient néanmoins à faire ressentir l’étrange ambiance de cette ségrégation en plein désert et présente de surcroît une très synthétique histoire du secteur pétrolier libyen.
« Tapline, Welfare Capitalism, and Mass Mobilization in Lebanon, 1950–1964 » de Zachary Davis Cuyler est moins une analyse de la vie quotidienne qu’une (passionante) histoire des luttes ouvrières au sein de la société Tapline ( Trans-Arabian Pipeline) au Liban : « De 1950 jusque dans les années 60, Tapline fut un canal primordial pour les flots d’énergie et de capital allant de l’Arabie Saoudite via le Liban vers l’Europe et les États-Unis. A l’image du pipe-line, la compagnie Tapline bricola un système de management paternaliste qui garantissait le bien-être des travailleurs, répondait à certaines de leurs revendications et traitait les libanais comme égaux vis à vis de leurs employeurs américains tout en maintenant des disparités de pouvoir et de salaires. Pendant la première décennie d’opération de Tapline, cette stratégie empêcha avec succès la syndicalisation. » L’intérêt du texte c’est de mettre en lumière ni l’amont ni l’aval du pétrole mais les travailleurs employés dans le secteur intermédiaire de l’acheminement, ce qui ne les privait pas en l’occurrence d’efficaces moyens de pression comme s’en apercevra la direction de Tapline lors de la grève de 1964, initiée par les premiers militants syndicaux de l’entreprise : « Les vulnérabilités spécifiques de Tapline et du système de distribution d’énergie du Liban furent centraux dans le pouvoir des travailleurs libanais du pétrole. Bien que Timothy Mitchell soutient dans Carbon Democracy qu’à une échelle globale le pétrole tend à être distribué dans des réseaux flexibles, redondants, à l’échelle de l’État-nation libanais la distribution de pétrole ressemblait aux « reseaux denditriques » vulnérables et peu souples dont Mitchell considère qu’ils sont propres au charbon » avec des branches à chaque bout mais un canal principal, créant ainsi des goulets d’étranglement à plusieurs jonctions ». Ce sont ces vulnérabilités tant de la société libanaise, que de l’exportateur et du consommateur en dernier ressort, qui permirent aux travailleurs de Tapline d’obtenir, en menaçant de couper le flux, et ce en plusieurs occasions et à différents points, la pleine satisfaction de leurs revendications sans qu’ils aillent toutefois jusqu’à réellement secouer « l’emprise paternaliste » (Cuyler) de l’entreprise.
Les deux derniers textes du recueil correspondent mieux au principe du chapitre puisque “Oil Is Our Wet Nurse”: Oil Production and Munayshilar (Oil Workers) in Soviet Kazakhstan » de Saulesh Yessenova retrace l’histoire soviétique et post-soviétique de l’exploitation du pétrole au Kazakhstan et le rapport ambigüe entretenu à son égard par les populations locales qui y étaient employées et « Doubly Invisible: Women’s Labor in the US Gulf of Mexico Offshore Oil and Gas Industry » de Diane E. Austin résulte d’une série d’entretiens avec des travailleuses des plates-formes offshores du golfe du Mexique.
A l’issue de la lecture de Working for Oil, dont on espère qu’il sera plus un ouvrage pionner qu’un feu de paille, on est tenté de revisiter certaines questions ouvertes par Timothy Mitchell dans son désormais classique, Carbon Democracy. Tout d’abord l’ouvrage démontre que malgré les conditions objectives ( différence dans l’acheminement, dans les circuits de commercialisation, dans le processus du travail, etc…) qui, chez Mitchell, faisaient que le charbon donnait aux exploités du secteur une force de frappe bien supérieure à celles des exploités du pétrole, et expliquait la substitution de l’un à l’autre, le secteur pétrolier n’en a pas moins été animé de nombreuses luttes partout dans le monde qui en ont profondément infléchi la trajectoire. Quant au rapport à la politique « nationale » ou internationale, là encore Working for Oil, montre que le choses ont été plus compliquées et il est probablement trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur ce point même si les exemples récents, le long de ce qu’on pourrait, un peu hâtivement, qualifier d’arc de crise pétro-prétorien ( Venezuela, Soudan, Algérie, Birmanie, etc) ne vont certes pas dans le sens d’un démenti de la thèse de Mitchell. Et plus généralement encore, la question du pétrole ne peut décidément plus se résoudre en sollicitant les vieux lieux communs ( pipe-line, cheiks, impérialisme, pétro-dollars, etc) puisque le renversement de son rôle, de grand fluidifiant ( de l’exploitation et de la consommation de masse puis de la financiarisation et de la globalisation) en cause de tous les maux et caillots sociaux ( pollution, crise de la suburbia, etc..), en ont fait « la corde dans la maison du pendu » des rapports de production et de reproduction au nord comme au sud.
A propos de virus (I) : Dessine moi une crise d’époque…
La « superstructure wallersteinienne » ( au sens de feu Immanuel Wallerstein) de la théorie de Jason W. Moore fait que ce qu’on appelle communément la « crise du XIVe siècle » constitue une référence historique incontournable et le modèle de ce qu’il nomme une « crise d’époque ». Rappelons que pour Wallerstein la crise du XIVe siècle, « conjonction d’une crise cyclique, séculaire et climatique (..) permet la naissance de l’économie-monde capitaliste. » Cette « crise générale de la féodalité » a été l’objet de très nombreux débats dans les années 60 et 70, dont la qualité et la diversité des contributions rend très difficile une quelconque synthèse. Ce qui suit n’est donc qu’une « mise en forme » nécessaire mais nécessairement insuffisante.
Tout l’enjeu des analyses de cette crise du XIVe siècle pour l’Europe c’est de parvenir à articuler les vagues cumulatives et dans une large mesure réciproquement impliquées, de « calamités », et, bien sûr, de conjuguer temps long et événement. Ce qui donnerait pour faire au plus simple : l’arrêt progressif des défrichements dés la seconde moité du XIIIe siècle, alors même que l’expansion démographique engagée depuis trois siècles continue et que le système agraire de l’époque s’avère incapable ( socialement s’entend) de générer un saut qualitatif technique, se couple à une première vague de froid annonciatrice du petit âge glaciaire ( dont on considère en général qu’il court de 1350 à 1850) et les premières des inondations spectaculaires qui rythmeront le siècle pour provoquer la grande famine qui ravage le continent de 1315 à 1321, celle-ci se doublant bientôt d’une peste bovine dévastatrice en Angleterre de 1318 à 1350 et préparant surtout le « terrain immunitaire » à la Peste Noire de 1347-1351 acheminée via les routes de la soie, peste qui ne cessera dés lors de faire des réapparitions régulières pendant plus de trois siècles. Les phénomènes de persécutions tendant déjà à devenir « endémiques » depuis la fin du XIIIe siècle atteignent alors leur acmé, le massacre des juifs lors de la Peste Noire restant la plus grande persécution de masse qui se soit produite en Europe jusqu’au XXe siècle, tandis que se déroule en « arrière plan » la première phase de la guerre de cent ans entre la France et l’Angleterre (1337-1386). Les nécessités fiscales liées à cette guerre et l’épuisement des rapports de subordination féodaux provoquant par la suite, et sur fond de pénurie de main d’oeuvre due au bilan de la peste et de tentatives d’y remédier, de massives révoltes paysannes qui menacent parfois de renverser le pouvoir en place comme la Grande Jacquerie de 1358 en France et la révolte paysanne anglaise de 1381. On pourrait éventuellement rajouter à cette belle totalité catastrophique, une profonde crise de la chrétienté, où la papauté en Avignon de 1309 à 1378 prépare le « Grand Schisme d’Occident » tandis qu’aux croisades des pastoureaux succèdent les processions de flagellants…
Point la peine de préciser que cette conjonction entre événements climatiques, épidémie, démographie et crise sociales, économiques, etc à répétition n’est pas sans évoquer, certes toutes proportions gardées !, la situation actuelle… Une relecture détaillée des débats de l’époque, dont Jason Moore a donné une des meilleures synthèse/dépassement dans son article « Nature and the Transition from Feudalism to Capitalism« , serait probablement très utile ( qu’on pense à la notion d' »unification microbienne du monde » développée par Emmanuel Le Roy Ladurie, notamment dans son fameux article « L’histoire immobile » et qui a fait l’objet d’une « mise a jour » primordiale par Bruce M. S. Campbell dans The Great Transition. Climate, Disease and Society in the Late-Medieval World ou encore aux contributions toujours précieuses de Robert Brenner ou Rodney Hilton, notamment celles réunis dans The Brenner Debate. Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe). Mais, bien qu’il ne soit jamais bon de laisser quoi que ce soit aux « spécialistes », il y a probablement assez à faire dans le « bal des causes et des effets » actuel pour vouloir s’inviter dans celui d’il y a sept siècles. Constatons néanmoins que, même dans ces débats sur la crise du XIVe, l’agencement, plus ou moins hiérarchisé selon les auteurs, entre facteurs « exogènes » (climatiques, épidémiologiques, démographiques ou techniques) et « endogènes » ( les rapports sociaux féodaux ) ne semble jamais donner les résultats voulus… Que les uns ( Guy Bois, Le Roy Ladurie) donnent la primauté à la question démographique, au point d’être qualifiés de néo-malthusiens, tandis que d’autres ( M.M. Postan et ceux qu’on a qualifié de « ricardiens » ) insistent sur l’inertie technique rendue inévitable par la structure économique et sociale féodale ou qu’enfin les marxistes ( Brenner et Hilton) établissent la centralité de la lutte des classes ( quoi qu’en n’étant pas nécessairement d’accord sur sa périodisation), ils se retrouvent toujours à un moment ou à un autre à mitiger plus ou moins sévèrement la centralité de la dynamique qu’ils ont mis en avant, ce qui donne même lieu à des « réconciliations » plus ou moins enthousiastes ( entre Bois et Brenner ou entre Brenner et Postan) . L’inextricabilité de cette crise désarmant les meilleures « machines de guerre » explicatives, les débats des années 60-70 semblent, en partie, déboucher sur une impasse.
Or, si certes d’Atlantide en île de Pâques, les facteurs environnementaux sont traditionnellement sollicités sur l’air de l’engloutissement final, ils auront rarement semblé joué un rôle aussi massif dans l’évolution de sociétés humaines « modernes » qu’à cette époque puisqu’il s’agissait tout autant de déforestation que d’épuisement des sols, de changement climatique et de ses catastrophes afférentes que d’épizootie et d’épidémie. L’histoire environnementale s’est d’ailleurs emparée du sujet comme le retrace Bruce M. Campbell dans son article » Nature as Historical Protagonist: Environment and Society in Pre-industrial England ». Il note ainsi que « Les preuves commencent à s’accumuler qu’un événement environnemental global majeur et transitoire – presque certainement pas d’origine volcanique ( puisqu’il n’y a pas de traces d’un pic de sulfate au Groenland comme dans les carottes de glace de l’Antarctique) – a été responsable des mauvaises récoltes sévères et prolongées qui ont précipité le désastre humain. La même dislocation écologique massive fut probablement responsable d’une façon encore obscure du développement de la peste bovine qui a largement aggravé et prolongé la crise agraire. Brown [ dans son livre History and Climate Change Ndt] a appelé cet épisode environnemental « l’anomalie de Dante » (puisqu’il a fini l’année de la mort de Dante Aligheri, 1321). Bien que sa cause environnementale précise et les interconnexions entre ses éléments attendent d’être étudiés plus en détail, son ampleur et sa sévérité pour les humains et les plantes et animaux domestiqués dont ceux-ci dépendaient ne fait aucun doute. »
La question qui ne manque pas de suivre est bien sûr celle du rapport entre ces premiers événements et la Peste Noire qui arriva vingt ans plus tard. Le même Campbell fait le bilan des hypothèses à ce sujet dans l’introduction à son livre The Great Transition : « Les microbiologistes et les généticiens supposent que quelque part après 1268 [ les études qu’évoquent Campbell datent des années 1260-70 le début du changement climatique qui va affecter le monde], Yersinia pestis, agent pathogène qui provoque la peste bubonique, est entré dans une phase plus active au sein des régions arides d’Asie Centrale qui lui servent de réservoir. Le passage soudain de la peste d’un stade enzootique à un stade épizootique semble avoir été marqué par la prolifération de nouvelles branches ou polytomies dans ce qui a été décrit comme un « big bang » biologique. Les biologistes pensent que ces développements ont eu lieu sur le plateau tibétain semi-aride de Qinghai dans l’ouest de la Chine où la peste a longtemps persisté comme infection enzootique dans les terriers de Gerbilles et chez les marmottes. Serait en partie responsable une cascade trophique déclenchée par le stimuli donné par les incursions d’un courant d’air humide venant de l’ouest au développement des végétaux, des rongeurs et de tous leurs parasites et leurs charges d’agents pathogènes. Une fois atteint un certain volume, le trafic de caravane le long des routes marchandes qui traversait cette région réservoir pourrait avoir transmis le pathogène et son vecteur insecte à des communautés de rongeurs encore plus à l’ouest le long des routes de la soie, jusqu’à ce qu’il parvienne à Issyk-Kul dans le Kirghiztan actuel, à l’extrémité orientale d’une steppe qui s’étendait à l’ouest jusqu’à la grande plaine hongroise. Là, voire avant, le pathogène semble avoir franchir la barrière des espèces et causé des pertes humaines significatives. »
La suite du voyage du fléau est connu, mais on peut tout de même reproduire le résumé que donne Campbell de son arrivée à « point nommé » : « Durant les années 1340, les séries de crises environnementales et humaines qui menaçaient finirent par se matérialiser : la réorganisation climatique globale s’accéléra et entra dans une phase hautement instable, la guerre s’intensifia et entraîna une récession plus grande encore du commerce et de l’économie et la peste atteignit les rives de la Mer Noire et en moins de sept ans s’était répandue à travers le système commercial européen. Ce trio de crises s’assembla en une violente tempête dont chaque composant aggravait et amplifiait l’action des autres. (…) Bien que chaque élément était animé par une puissante dynamique qui lui était propre, la surprenante synchronicité entre les développements environnementaux et humains suppose l’existence de puissantes synergies entre eux. » C’était probablement le défaut majeur, mais bien compréhensible, des débats évoqués plus haut que d’avoir négligé ou insuffisamment développé cet aspect des choses, reconnaître l’aspect absolument exogène de certains phénomènes ( climatiques notamment) n’empêchant pas, bien au contraire, de se pencher de plus près sur les interactions, tout aussi décisives dans la catastrophe, entre nature et société. C’est en partie ce que fait Moore dans son article « Nature and the Transition from Feudalism to Capitalism » dont la démarche est bien résumée par cette leçon : « L’environnement compte, mais là où beaucoup pourraient chercher une réponse déterministe, nous ferions mieux de regarder comment les classes font l’histoire ( et la géographie) mais pas dans des conditions éco-géographiques de leur choix. Nous avons à faire ici à une détermination environnementale pas à un déterminisme. »
Et ce qui nous semble justement intéressant dans ce précédent de « crise écologique totale », comme interaction entre climat, nature, maladie et société, c’est qu’elle éclaire d’un jour nouveau ce qui est dorénavant un lieux commun de notre époque, à savoir que la détermination environnementale se retrouve elle-même désormais presque entièrement déterminée par l’activité humaine. C’est que pourraient, notamment, quoique marginalement, illustrer quelques phénomènes liés à la crise du Covid-19…
PS : on trouvera un résumé bien plus détaillé des nouveaux apports de « la perspective écologique » dans l’analyse de la crise du XIVe siècle dans l’article « De la « grande crise » à la « grande transition » : une nouvelle perspective ? » de Jean-Philippe Genet ( 2019).
Materialism and the Critique of Energy
Materialism and the Critique of Energy Édité par Brent Ryan Bellamy et Jeff Diamanti, Chicago, MCM’ Publishing, 2018. ( Librement téléchargeable sur internet)
Encore un ouvrage très volumineux ( 700 pages) et varié ( 27 contributions) mais cette fois-ci sur un versant bien plus théorique comme en témoigne l’introduction Brent Ryan Bellamy et Jeff Diamanti : » Que ce soit pour répondre aux besoins de la croissance économique cumulée ou au développement de nouveaux horizons de valorisation, le capitalisme a été historiquement et logiquement lié à la production de quantités toujours croissantes d’énergie. La contradiction centrale du système économique actuel est et a toujours été liée à son rapport à l’énergie. Une perspective critique sur les conditions des possibles politiques, économiques et écologiques requiert une nouvelle analyse du rapport de l’énergie à la production, la distribution et l’accumulation de valeur. Materialism and the Critique of Energy développe cette perspective, tout d’abord en revisitant les histoires conceptuelles et matérielles enchevêtrées du capital et de l’énergie qui se trouvent au fondement du matérialisme et ensuite en clarifiant les enjeux de la critique de l’énergie pour la théorie critique contemporaine. Sa thèse principale c’est que si les conditions du changement climatique actuel ont provoqué un vaste intérêt pour les régimes énergétiques et les systèmes environnementaux, seule la critique de l’énergie qui se trouve au coeur du marxisme peut expliquer pourquoi le capitalisme est un système énergétique et de là offrir une perspective plus claire de sortie de son inertie fossile. » Dans la suite de leur introduction, Bellamy et Diamanti, insistent particulièrement, à la suite d’Anson Rabinbach notamment (on y reviendra), sur la production mutuelle du matérialisme moderne et du nouveau régime énergétique capitaliste qui trouve bien sûr son plus haut point critique avec Marx. Par contre les développements qui suivent sur l’éternel retour, comme métaphore de l’énergie, chez Nietzsche ou Blanqui et sa reprise critique par Walter Benjamin auraient pu faire l’objet d’une contribution intéressante mais, dans une introduction à un si épais volume, ils égarent un peu le lecteur tout de même inquiet de savoir ce qui l’attend….
Inquiétude qui ne dissipe certes pas à la lecture du numéro de marxologie qui ouvre le recueil, « Marxism, Materialism, and the Critique of Energy » puisque son auteur Allan Stoekl fait comme si la critique développée par Jason W. Moore n’existait pas ( il se positionne pourtant vis à vis de John Bellamy Foster) comme en témoigne ce passage où il résume son argumentation : » il y a une contradiction importante entre la critique marxiste du capitalisme et la critique du capitalisme portée par les économistes écologistes et « énergicistes ». Dans le premier cas, dans la perspective marxiste classique, la crise finale du capitalisme sera essentiellement économique : la chute du taux de profit rendra l’économie capitaliste dans son ensemble incapable de se reproduire et ouvrira la voie à une révolution prolétarienne. Dans le second modèle, la vulnérabilité du capitalisme est due avant tout à la faillibilité de son modèle de croissance lui-même- le principe que l’économie mondiale peut faire « croître » indéfiniment son offre monétaire et ses profits sur la base d’un monde fondamentalement fini en terme de ressources énergétiques et minérales. Le premier modèle – celui de Marx- se concentre sur le travail, la baisse du profit et l’illusion d’une expansion infinie du capitalisme par la recherche de profit; le seconde – celui, entres autres, de Frederick Soddy, M. King Hubbert et Richard Heinberg, que j’appellerai la thèse énergétique- souligne la base matérielle de l’impossibilité à moyen terme du capitalisme : la finitude de la terre et de ses ressources. Ce sont, pourrait-on dire, deux positions très différentes. Néanmoins, j’avancerais, qu’à la fin, chaque théorie fournit quelque chose dont l’autre manque et que, de surcroît, il y a même une certain rapport complémentaire entre les deux. Et j’avancerais, enfin, que les modèles marxistes et énergicistes ne sont pas seulement connectés mais que les modèles futurs de valeur [ sic !] devront aller au-delà de leur dyade apparemment inévitable. » Bref mieux vaut lire Le Capitalisme dans la toile de la vie qui ne tourne certes pas autour du pot sur ce point !
Le texte qui suit, “Water, water, every where, Nor any drop to drink”: Accumulation and the Power over Hydro » de Peter Hitchcock est probablement trop « surplombant » vu l’ampleur de son sujet mais a le mérite de présenter un relatif panorama de la réflexion marxiste sur cette « marchandise non-coopérative » (Karen Bakker) qui « semble constamment échapper aux processus de marchandisation qui lui sont infligés » et si « Il n’y a pas de baguette magique pour saisir la Weltanschauung de l’eau, les luttes qui l’entourent mettent toujours en jeu les termes fondateurs de l’économie politique. » Reprenant le fil d’une tradition « récente » de réflexion sur la question de l’accumulation primitive ( Perelman, De Angelis, Federici, Harvey) et constatant tout à la fois sa validité et son incapacité relative à se saisir de la question, en bien des points spécifique, de l’eau, Hitchcock invite donc à repenser le concept à l’aune des enjeux multiples qui l’environnent aujourd’hui et au crible de la reproduction sociale, telle que théorisée sur ce point par Adrienne Roberts. Ainsi selon lui « l’eau n’est pas un élément connexe de la globalisation comme système-monde mais plutôt une réalité heuristique centrale pour en comprendre la maturité, les limites et les contradictions. » La lutte autour de l’eau étant finalement une lutte pour « décider de ce qui sera « originel » » (entendu ici au sens d’accumulation originelle) dans le cycle d’accumulation à venir.
Daniel Cunha, dont nous avons également évoqué un texte dans les jalons bibliographiques sur l’écologie monde, livre dans sa contribution « The Anthropocene as Fetishism » une critique qui paraît certes moins originale trois ans plus tard mais éventuellement toujours utile de la notion d’anthropocène qu’il relit au crible de la théorie du fétichisme de la marchandise de qui vous savez : » Un système qui devient quasi automatique, dépassant la contrôle conscient de ceux qui y sont impliqués et qui est animé par la compulsion de l’accumulation infinie comme fin en soi, a nécessairement comme conséquence le bouleversement des cycles matériels de la terre. Appeler cela l’Anthropocène, est néanmoins imprécis, d’un côté puisqu’il s’agit du résultat d’une forme spécifique de métabolisme avec la nature et non d’un être générique ( anthropo) et de l’autre car le capitalisme constitue une « domination sans sujet », c’est à dire dans lequel le sujet n’est pas l’homme ( et pas même la classe dominante), mais le capital. » De même » le dérèglement des cycles écologiques globaux est présenté comme anthropocène c’est à dire comme un processus naturel. Que l’homme soit présenté comme une force géologique aveugle, à l’image des éruptions volcaniques ou des variations de la radiation solaire, c’est une expression de la forme naturalisée ou fétichisée des rapports sociaux qui prédomine sous le capitalisme. » Notons toutefois que l’auteur qui comprend donc le bouleversement global de la nature comme « l’externalisation du travail aliéné, sa conclusion matérielle logique » n’en finit pas moins son texte sur une « ouverture » aberrante : « Libérée de la forme valeur et de la raison instrumentale qui réduit la nature a un « substrat de domination », la géo-ingéniérie et la technologie avancée en général pourront être utilisées non seulement pour résoudre le changement climatique mais, comme l’écrivait Theodor Adorno pour « aider la nature à ouvrir les yeux », etc Après Hitchock ( voir plus haut) qui imaginait une société libérée du capital mais pas de la loi de la valeur, le volume semble de nouveau témoigner d’une confusion « post-capitaliste » certaine dans la nouvelle génération de marxistes…
Malgré un titre inquiétant, « Mapping the Atomic Unconscious: Postcolonial Capital in Nuclear Glow » de Katherine Lawless présente à la fois une introduction intéressante, pour le/la néophyte, aux Memory Studies, et une réflexion foisonnante sur l’instrumentalisation nucléocrate de la mémoire des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. La critique qu’elle et d’autres auteurs donnent de la nouvelle muséographie commémorante est sans appel : » malgré le mandat donné d’éduquer, la fonction des musées de la mémoire et de médias mémoriels similaires est d’apaiser et de désarmer tout en dans le même temps marchandisant et incorporant les restes sociaux et matériels d’étapes précédentes de l’accumulation. (…) N’étant plus de simples espaces de sédimentation de la mémoire historique, ils sont devenus les véhicules par lesquels la mémoire collective comme ressource culturelle est à la fois produite et transmise. » On comprend quels sont les enjeux par rapport à l’histoire de l’énergie nucléaire : » Accompagnant le discours sensationnialiste sur l’atrocité nucléaire, la banalisation de l’énergie nucléaire sert à éluder la sourde violence de tels régimes énergétiques (…) dans la production de la mémoire nucléaire, la violence latente des régimes énergétiques globaux ( qui inclut tout autant le changement climatique que les nouvelles enclosures globales) est éclipsée par le spectacle de l’atrocité nucléaire et re-présentée comme préservation de la mémoire nucléaire. » Argument pas particulièrement original mais qui permet à Lawless » de remonter la piste des différentes expressions de l’inconscient énergétique [ expression forgée à l’origine par Patricia Yaeger], ce qui suppose dans le cas de l’inconscient atomique, non seulement les invisibilités énergétiques qui accompagne la transition à la nucléarité mais aussi la matérialité oubliée de la mémoire nucléaire elle-même. Sans une telle perspective matérialiste, nous en sommes réduits à la fausse lueur de la révolution morale dont les défenseurs se trouvent du côté des gagnants de l’histoire nucléaire et dont les discours servent les intérêts du capital post-colonial. »
Après cette première série relativement disparate de textes, on ne boude certes pas son plaisir à retrouver le « vétéran » George Caffentzis qui livre ici, sous le titre « Work or Energy or Work/Energy? On the Limits to Capitalist Accumulation », une critique claire et incisive d’un certain « anti-capitalisme des limites objectives ». Ce qui fait d’ailleurs regretter qu’il n’ait pas pris le temps de recenser le livre de Jason Moore, qui ne se résume certes pas à ça mais … L’objet de la critique de Caffentzis c’est principalement Saral Sarkar, universitaire et activiste éco-socialiste dont on peut trouver un certain nombre de textes en français en ligne. Sarkar est emblématique de la variante actuelle de la vieille antienne des « limites à la croissance » et d’un certain » fétichisme de l’énergie qui considère que la valeur n’est pas créée par le travail humain. » Comme le résume Caffentzis, « Pour Sarkar, puisque le capitalisme dépend d’un surplus écologique, pour assurer ses profits et son accumulation, les trois sources de celui-ci nomment d’ores et déjà les limites à la croissance : 1) l’épuisement des ressources naturelles d’énergie, particulièrement le pétrole et le gaz 2) la « toxification » croissante sous la forme de l’appauvrissement des sols, le smog, etc quand les « éviers » naturels commencent à ne plus fonctionner et enfin au niveau de l’énergie 3) nous avons atteint une limite entropique et aucune innovation scientifique et technologique ne pourra permettre de surmonter la perte de la base de ressources en énergies fossiles. » Cette dernière thèse s’appuyant elle-même grandement sur les travaux de Nicholas Georgescu-Roegen. La réfutation de Caffentzis est certes aisément prévisible mais selon nous, toujours nécessaire : » Les limites à la croissance de Sarkar passent à côté d’un élément crucial de toute analyse d’une fin potentielle du capitalisme, puisque son rejet de l’importance du travail dans la reproduction et l’accumulation du capital passe à côté également de l’importance de son refus pour la dés-accumulation et l’éventuelle abolition du capital. Je saisis bien la frustration qu’évoquent beaucoup d’écrits anti-capitalistes quand ils se penchent sur les luttes ouvrières avec leurs divisions, leurs reculs et leurs fréquents accommodements racistes, sexistes et anti-écologiques avec le capital. Mais ce sont les luttes des travailleurs contre l’exploitation et non l’épuisement des stocks de pétrole, qui constituent la seule limite logique définitive à l’accumulation capitaliste, toutes subjectives qu’elles puissent paraître. »
Comme il le rappelle à Sarkar, qui, précisons à sa décharge, si comme tant d’autres il ne veut pas de la lutte de classe à au moins le mérite de ne pas se réclamer du marxisme : » La valeur n’est pas un objet matériel, ni même un rapport entre des choses. C’est bien plutôt une forme sociale qui peut être incarnée- contrairement à quelque chose comme la richesse naturelle qui constitue plus une condition de possibilité qu’une quantité échangeable- et a besoin d’un équivalent temps socialement déterminé pour circuler comme valeur. Donc bien que plus de pluies puissent affecter le montant de travail socialement nécessaire pour la production d’un kilo de blé, la pluie ne crée pas la valeur de ce kilo de blé. En d’autres termes, le capitalisme est extrêmement « humaniste » dans le sens où sa préoccupation majeure est d’étendre autant que possible son contrôle de la vie humaine afin de transformer cette vie en travail exploitable. » De même un peu plus loin : » Si le travail n’est pas central dans la création de la plus-value, alors le capital se préoccuperait surtout de réduire tout autant la quantité et la qualité de travailleurs mais ce n’est pas ce qui se produit au XXIe siècle. Au contraire, des milliards d’êtres humains intègrent la classe ouvrière et ce a de nombreux niveaux de qualification. Les capitalistes semblent plus inquiets de localiser des réserves de travailleurs « à faible entropie » qu’à trouver des dépôts de pétrole et de gaz. » Enfin, s’appuyant sur les travaux de Timothy Mitchell, dont le livre Carbon Democracy constitue évidemment une référence incontournable pour toute critique sociale de l’énergie, Caffentzis rappelle également à quel point les choix énergétiques sont déterminés par les luttes réelles et non des « limites objectives », dont le caractère parfois indéniable n’en justifie certes pas pour autant qu’on les érige en alpha et oméga, à moins bien sûr qu’il s’agisse de laisser libre au cours, sous prétexte d’anti-capitalisme, aux pulsions autoritaires et ur-étatistes de certaines fractions de classe…
Cette première partie du livre, intitulée « Theories », s’achève sur le très long texte « Crisis, Energy, and the Value Form of Gender: Towards a Gender-Sensitive Materialist Understanding of Society-Nature Relations » de Elmar Flatschart, dont les premières pages constituent un tel numéro de logomachie marxologique tendance »Wert-kritik », que nous n’avons pas eu le courage de poursuivre la lecture …
Après un telle caricature d’un « marxisme » réduit à faire les cent pas dans la chambre capitonnée de ses abstractions, la lecture du texte de l’omniprésent « écololéniniste » Andreas Malm, « Long Waves of Fossil Development: Periodizing Energy and Capital » est relativement revigorante, car lui au moins ne fait pas comme si l’histoire voire la réalité n’existaient pas. La question de départ de Malm est simple : « Comment précisément la croissance capitaliste a t-elle été liée à la consommation d’énergies fossiles dans le cours de son histoire ? » Après avoir rappelé qu’il ne s’agit certes pas d’un processus linéaire et harmonieux mais bien plutôt que ce sont « les contradictions et les convulsions [ du mode de production capitaliste] qui participent le plus à la production et la reproduction à une plus grande échelle de l’économie fondée sur les énergies fossiles » Malm invoque les mannes de Kondratieff et de ses « vagues longues de la conjoncture », avant devant leur déterminisme chronologique par trop littéral de se tourner vers la reprise critique qui en a été faite par Trotsky, Eric Hobsbawm et Ernest Mandel. C’est surtout ce dernier, dirigeant trotskyste et théoricien marxiste, qui a tenté de rétablir une « dynamique non-équilibrée » du développement du système capitaliste, en réconciliant tout à la fois ce qu’il considérait être la dynamique interne du mode de production et l’ensemble des « contingences » sociales, historiques et culturelles qui viendraient influer sur le cours systématique des choses. Comme le résume Malm : » Les lois du mouvement capitaliste s’affirment à travers l’interaction entre des forces intra-économiques et extra-économiques, et c’est là, dans la dialectique concrète des facteurs subjectifs et objectifs que se produit une onde longue [ de développement capitaliste], celle-ci étant essentiellement la fusion d’innombrables variables dotées une solidité temporaire et bientôt fissurées par de nouvelles contradictions. (…) Quelle que soit la nature exacte de ces contradictions, elles vont orienter à la baisse le taux de profit. Qu’il s’agisse de machines couteuses, d’épuisement de marchés, de luttes ouvrières, de renchérissement de l’énergie ou d’un quelconque autre fléau, les capitalistes vont le vivre comme une pression à la baisse du taux de profit. Et c’est là « l’index synthétique du système », « le sismographe de l’histoire », enregistrant et exprimant « tous les changements auquel est en permanence assujetti le capital » : le point unique où converge les facteurs endogènes et exogènes. »
Tout cela a certes un peu vieilli même si il faut reconnaître avec Malm que Mandel, évitait autant que possible les ornières du déterminisme mécaniste au point d’ailleurs d’ajouter variables sur variables et de se rendre parfois incompréhensible. Quant à la reconnaissance de la primauté en dernière instance de la lutte de classe, à laquelle le dirigeant de la IVe internationale se raccrochait toujours in fine, il ne faut pas oublier non plus qu’elle était considérée au prisme du développement des divers sectes et groupuscules trotskystes de par le monde… Pour revenir à la question de départ, l’énergie jouait, selon Mandel, un rôle primordial pour permettre la transition d’une onde à une autre, en éliminant les barrières à la hausse et à la diffusion des profits et en impulsant une nouvelle accumulation, l’énergie étant « le point d’arrivée matérialiste de la tentative de Mandel de fusionner les lois endogènes et les chocs exogènes, Kondratieff et Trosky, l’accumulation et la politique ». Poursuivant donc sur cette voie et après avoir donné une description relativement succincte de la restructuration/mondialisation capitaliste qui a débuté dans les années 70 et du rôle central joué par les nouvelles technologies dans le processus, Malm se demande dans la dernière partie de son texte si la transition vers le tout renouvelable pourra ouvrir la voie à une nouvelle phase d’expansion après la cinquième crise structurelle dans laquelle, selon lui, nous nous trouvons : « Comment les investissements dans les énergies renouvelables peuvent-ils non seulement dégager des profits mais soutenir une forte hausse du taux de profit moyen nécessaire pour que la capital amorce un véritable rebond ? Dans quel sens pourront-ils constituer la solution aux contradictions de la cinquième crise structurelle ? Pourront-t-ils servir de bulldozer au capital pour abattre les obstacles qui se multiplient partout? » Sans répondre définitivement, il avance tout de même : « Pour reprendre les termes de Mandel, le keynésianisme climatique semble avoir besoin de l’intervention d’un facteur subjectif, une forme de force sociale plus externe et hostile qu’interne et acceptable au capital. Cette force doit encore apparaître. » Remarquons pour finir que Malm n’évoque pas dans ce texte, Mandel ne se serait pourtant pas retourné dans sa tombe !, les sinistres remèdes de cheval bolchéviques dont il fait commerce partout ailleurs. A l’heure où la vieille séparation/articulation entre facteurs endogènes et exogènes prend l’eau toute part, il semblerait que le démenti de la méthode n’empêche pas certains de vouloir confirmer coute que coute la conclusion.
Le texte qui suit, « Nuclear Power and Oil Capital in the Long Twentieth Century » de Adam Broinowski, se présente tout d’abord comme un exposé particulièrement concis de la géopolitique du pétrole, du gaz et du nucléaire au XXe et début du XXIe siècles sous un angle classiquement anti-impérialiste. Mais dés que l’auteur se met à aborder les événements les plus récents, on voit fleurir toutes sortes de thèses douteuses voire loufoques : les « révolutions de couleur » en Europe de l’Est et en Asie Centrale étant de pures et simples machinations occidentales trouvant leur apothéose dans le « putsch » de la révolte de Maidan, les bombardements chimiques de Bachar el Assad étant en fait le fruit d’un complot américano-turco-quatarien pour venir en aide aux rebelles modérés ( p. 258) et l’axe plouto-autoritaire russo-chinois constituant via ses divers programmes et manoeuvres de vassalisation des États dépendants une véritable alternative à l’héganomalie américaine, ou dixit Broinowski : » La possibilité d’un monde multipolaire représenté par l’infrastructure énergétique, financière, politique et militaire eurasienne pour soutenir les souverainetés au milieu des tentatives actuelles de déstabilisation pourrait représenter une alternative majeure au contrôle largement maritime de la distribution des ressources et aux soixante-dix dernières années de bipolarité type guerre froide et d’unipolarité néo-libérale post chute du mur. Cela représenterait une étape positive au vu de l’intensification de la militarisation, de l’érosion du droit international, de l’affaiblissement des institutions multilatérales, de la déstabilisation des souverainetés étatiques et de l’accélération des désordres environnementaux dans cette période de transition. » Il suffit en lisant cela de penser à la politique russe de la décennie écoulée et du tournant chinois de ces dernières années pour apprécier à sa juste valeur ce bel exemple de « conscience renversée » campiste ( l’auteur enseigne dans une université australienne).
Le texte qui suit de David Thomas, « Keeping the Lights On: Oil Shocks, Coal Strikes, and the Rise of Electroculture » présente par contre une analyse par bien de points exemplaire de la transition/ restructuration au tout électrique à partir des années 70 et son implication réciproque avec les grandes luttes des mineurs britanniques jusqu’à leur emblématique défaite au milieu des années 80. Comme il est difficile de résumer ce texte dense et rythmé, nous traduisons ici l’introduction.
« Écrivant au moment où la belle époque [ Thomas évoque ici le fordisme] arrivait à son acrimonieuse conclusion sous une grêle de piquets de grève et de coups de matraques, Raymond Williams s’en prenait au modèle d’analyse sociale « étapiste » qui est resté jusqu’à aujourd’hui une composante tenace de l’écriture historiographique. Williams se plaignait que la préoccupation académique pour les formations sociales « faisant époque » empêchait souvent de reconnaître les mouvements et tendances historiques qui étaient également actifs » au sein et au delà » du régime dominant. Cherchant à les débarrasser de ces oeillères, il incitait les sociologues de la culture à se concentrer intentionnellement sur les effets des forces « résiduelles » et « émergentes », et donc d’essayer par là de saisir les processus historiques et culturels dans tout leur dynamisme contingent et leurs déterminations mutuelles. Dans ce texte, j’applique la conceptualisation triadique des processus sociaux proposée par Williams – c’est à dire en étant attentif aux effets des forces résiduelles, dominantes et émergentes- pour étudier les systèmes énergétiques et leurs « cultures énergétiques » afférentes. J’essaie ici de dégager les implications politiques des différentes compositions technologiques et sociales de ces systèmes imbriqués. Redéfinissant le terme d' »électro-culture », j’avance qu’un ensemble distinctif de formations sociales et de rapports de production a émergé dans la foulée de la crise énergétique des années 70, lorsque les décideurs politiques ont commencé à faire de l’électricité l’énergie symbole – et le médium matériel- d’une restructuration cybernétique radicale du système énergétique global. Mais, en accord avec les dynamiques que Williams considérait comme caractéristiques du processus historique, l’hégémonie de ces nouvelles technologies ne changea pas seulement les pratiques structurelles de la pétro-culture dominante mais elle a servi également à réactiver des modes résiduels de lutte de classe qui s’étaient d’abord développés à l’apogée de la vapeur. Alors que les mineurs britanniques tentaient de défendre leurs intérêts dans le contexte d’un changement de système énergétique ils utilisèrent des versions modifiées de leurs vieilles tactiques datant de l’ère de la vapeur pour forcer le gouvernement britannique à une embarassante série de capitulations politiques. Le succès à court-terme de leur lutte découlait de cette ironie historique : l’électricité britannique – l’élément vital du tournant cybernétique- était en grande partie le produit du charbon extrait domestiquement.
En analysant les « cultures énergétiques » de cette façon assez lâche et extensive, je définis la « culture » au sens le plus large possible et je suis de nouveau Williams en considérant qu’elle contient l’expérience partagée « d’institutions, de moeurs, d’habitudes de pensée et d’intentions » qui pris ensemble constituent un mode de vie. Mais en me concentrant sur l’énergie je reprends également l’argument de Imre Szeman et Dominic Boyer selon lequel » on ne peut plus comprendre effectivement les développements dans les champs de la culture, du social, de la politique et de l’économie sans prêter attention au rôle joué par l’énergie dans chacun de ces domaines. » Je m’appuie sur cette thèse en tentant de décrire les formes distinctes de vie et de modes de lutte qui émergent à la travers la production socio-écologique de différents – mais se superposant – systèmes énergétiques qui opèrent simultanément à un temps et un endroit donné. Car les systèmes énergétiques ne font pas simplement « tourner » la vie de façon invisible ou souterraine. Ils sont au contraire vécus d’une façon si complète que nous pouvons commencer à identifier les « institutions, moeurs, habitudes de pensée et intentions » propres à chacun. Malgré le caractère évident d’une telle thèse, il a fallu énormément de temps à l’analyse historique pour reconnaître pleinement comme les questions d’énergie ont déterminé le déroulement des luttes politiques et du développement technologique. De fait quand je revisite les analyses matérialistes les plus importantes de la grande grève des mineurs et du tournant cybernétique, il est évident – à l’exception notable de George Caffentzis- que les commentateurs de l’époque avaient tendance à négliger la signification centrale de l’énergie. Donc en même temps que ce texte essaie de reprendre certaines des catégories centrales de la théorie historiographique de Williams, il cherche aussi à aborder cette lacune « énergétique » qui réside au coeur des récits de ce cycle de lutte. »
Dans « Peak Oil after Hydrofracking » Gerry Canavan utilise « l’exemple du pic pétrolier comme prophétie démentie pour démontrer le besoin pressant d’une critique marxiste écologiste qui ne se fonde pas sur une logique de la catastrophe imminente « . Le tableau qu’il donne dans la suite de son texte des diverses prédictions apocalyptiques qui ont entouré le pic pétrolier, avant l’essor de la fracturation hydraulique, est en effet assez ravageur. Et le retournement d’humeur qui a accompagné le boom du « fracking », avec son optimisme délirant malgré ses multiples dévastations immédiatement constatables qu’il détaille longuement, n’a fait qu’illustrer un peu mieux l’absurdité des discours de la « chute imminente » précédents, en tout cas du point de la critique sociale. Car, comme il le rappelle en conclusion et à la suite de David Harvey, le capitalisme est indissociable d’une forme de dynamique de l’obstacle, qu’il s’agisse d’ailleurs de la nature, de populations entières, de savoir-faire ou de résistance à l’exploitation ou l’expropriation.
Le texte qui suit de Daniel Worden, « Oil and Corporate Personhood: Ida Tarbell’s The History of the Standard Oil Company and John D. Rockefeller » critique les représentations courantes de l’histoire du secteur pétrolier notamment la personnalisation « héroïque » de ses grands barons, ici en l’occurrence Rockfeller, qui permet d’empêcher de saisir le capitalisme comme système ou structure et d’invisibiliser l’exploitation, les déprédations et dévastations qui l’accompagnent. On remarquera pour aller dans le sens de l’auteur, et comme l’avait déjà souligné George Caffentzis, l’absence flagrante dans la quasi totalité des grands récits sur l’énergie, qu’ils soient apologitiques, critiques ou géopolitiques, de la vie et des luttes des travailleurs du secteur…. Vide que certaines publications de ces dernières années ont commencé à combler voir par exemple America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier de Robert Vitalis ou Working for Oil. Comparative Social Histories of Labor in the Global Oil Industry paru sous la direction de Touraj Atabaki, Elisabetta Bini et Kaveh Ehsani ( nous y reviendrons dans une prochaine note de lecture).
Texte qui clôt la partie « Histories », The Belly of the Revolution: Agriculture, Energy, and the Future of Communism » de Jasper Bernes est clairement l’un des plus incisifs et courageux du recueil ( et certes l’un des plus proches du point de vue du « recenseur »). Bernes se livre au début de son texte à une critique, un peu convenue mais toujours salutaire, des thèses, moins démodées qu’on le croit ( voir le texte de Daniel Cunha plus haut), de la révolution « libératrice des forces productives » : « L’hypothèse de base parmi les marxistes et beaucoup d’autres c’est que, malgré ses excrétions toxiques, plus la technologie se développe, plus il sera facile de produire [« produce »] le communisme. Et si en fait ces technologies rendaient les choses plus compliquées ? Et si elles agissaient aussi comme des entraves, faisant obstacle à l’abolition de la société de classe ? » Là où il s’avère selon nous « courageux » c’est que ne s’arrêtant pas à des points de doctrine, il entreprend de se coltiner à la question de l’abolition concrète et communiste des rapports sociaux : » Dans les pages qui suivent, je m’appuie sur mes travaux précédents et considère les obstacles, infrastructurels et technologiques que va rencontrer la révolution au XXIe siècle. Je prends comme principal objet de recherche l’agriculture et la chaine d’approvisionnement en nourriture, le ventre de la révolution comme je l’appelle, non seulement parce que les révolutions devront parvenir à assurer leur approvisionnement ou elles mourront, mais parce que l’agriculture et les ressources alimentaires dépendent de tous les autres systèmes techniques du capitalisme industriel : l’approvisionnement en énergie, l’industrie et la logistique. » Précisons que (pour ce texte comme pour les autres) puisqu’il s’agit ici de proposer une introduction/incitation à la lecture de ce recueil, nous passons bien sûr sur les longs et riches développement de Bernes sur la question agricole, la séparation ville-campagne, etc et qui lui permettent d’aboutir sur une articulation entre ces problématiques et le déroulement d’une révolution possible.
Dans la dernière partie de son texte, retraçant la dynamique des échecs russes et espagnols du XXe siècle et critiquant, un peu trop gentiment, les dangereuses « utopies » d’un Urstaat écologiste ( Malm), Bernes constate : » Une authentique révolution au XXIe siècle, rompant avec le capitalisme et la société de classe, devra dans le même temps être une révolution agraire (…) Elle devra transformer radicalement la façon dont la nourriture est produite et distribuée, non seulement parce que le système alimentaire actuel est gaspilleur, toxique pour les humains et destructeur environnementalement et pas seulement parce que le changement climatique va changer radicalement ce qui peut être cultivé et où et comment, mais aussi, de façon encore plus importante, car l’organisation capitaliste de la nature comme agriculture, si on s’appuie sur elle, invalide complétement la possibilité de telles révolutions, garantissant la restauration de la société de classe. » De là, après avoir donc sollicité les mannes de Jason Moore, il se tourne assez naturellement vers une des rares courants théoriques ayant essayé de penser la révolution « comme activité », le courant dit de la communisation ( le site des nouvelles du front constitue une excellente porte d’entrée à cette galaxie théorique et à ses débats) : » Je prends comme base de ma réflexion le point de vue selon lequel l’horizon de la révolution à notre époque suppose la « communisation » de toutes les ressources et rapports : c’est à dire, l’abolition immédiate de l’argent et du salariat, du pouvoir d’État et de la centralisation administrative, et l’organisation de l’activité sociale sans ces médiations sur la base des rapports sociaux personnels, directs ou immédiats. » Bernes conclut son texte sur ce résumé de son argumentation : « Si les prolétaires du XXIème siècle communisent l’approvisionnement en nourriture, dépassent la séparation ville/ campagne, ils ne le feront pas parce que cela s’accorde à leurs idéaux mais parce que ces mesures communistes vont émerger comme la meilleure, et de fait la seule voie, pour répondre à leurs besoins dans la conjoncture révolutionnaire, et ce compte tenu de la trajectoire de dépendance aux ressources productives qu’ils hériteront du capitalisme. »
La partie « Cultures » s’ouvre sur le texte Sheena Wilson, « Energy Imaginaries: Feminist and Decolonial Futures », qui est principalement constitué d’une critique acerbe du livre, et certes visiblement caricature du « tout ira très bien madame la marquise dans le meilleur des mondes stato-marchand », de Jonathon Porritt The World We Made: Alex McKay’s Story from 2050. Wilson résume son approche dans son introduction : » Via une lecture intersectionnelle féministe [du livre de Porritt], j’illustre les limites des imaginaires dominants aujourd’hui et j’avance qu’abandonner le pétrole comme principale source d’énergie pourrait fournir des opportunités pour développer des façons plus justes de vivre qui mettent en avant les préoccupations des plus exploités – les femmes, les personnes de couleur et le 99% global- au coeur des politiques de transition énergétique. Pour parvenir à cela, il nous faut une transition énergétique qui se confronte et mette fin aux violences systémiques de l’ère du pétrole qui reposent sur les logiques du capitalisme pétro-suprématiste-blanc-cis-hétéropatriarcal-néolibéral-colonial- déployées au nom du développement, de la croissance économique, de la sécurité énergétique et toute une autre série d’expressions sensément inoffensives, qui font abstraction du pillage en cours des ressources naturelles et de l’exploitation des corps marqués par la race, la classe, le genre à travers le monde. L’antidote à ces façons de penser et d’être au monde, c’est de réintroduire d’Autres systèmes de savoir et de conceptions du monde, y compris mais pas seulement féministe et indigène, qui peuvent ,nous aider à imaginer collaborativement et avancer collectivement vers des futures énergétiques socialement justes – décolonisés et féministes. » Précisons que cette profession de foi un peu convenue ne rend pas réellement justice à certaines qualités du texte de Wilson…
Dans « Petrofiction and Political Economy in the Age of Late Fossil Capital », Amy Riddle propose dans la foulée du type de lecture initiée par Amitav Ghosh, une analyse comparative de deux livres de « pétro-fiction » : Villes de sel de Abdelrahman Munif, un classique sur les débuts de l’exploitation pétrolière au Moyen-Orient et les luttes qui l’entourèrent et Du pétrole sur l’eau de Helon Habila qui se situe dans les zones pétrolifères les plus reculées et chaotiques du Nigeria actuel. Comme elle le constate dés l’abord de son texte : « Tandis que Villes de sel dépeint la transition d’une formation sociale traditionnelle à un mode de vie colonial-capitaliste, Du pétrole sur l’eau nous montre le résultat final de cette forme sociale. Le premier livre souligne une possibilité perdue, tandis que le second décrit l’épuisement qui traverse autant les paysages physiques que sociaux embarqués dans la pétro-économie émergente. » Toutefois pour l’auteur, l’analyse des « pétrofictions » ne s’arrêtent pas certes pas là : » Les qualités supra-objectives du pétrole à la fois comme carburant et comme plastique, terre et air, sujet et système, le distingue des marchandises qui l’ont précédé en littérature, comme le café, les épices ou le sucre. Ce qui revient à dire que la présence physique ou l’absence du pétrole dans ces romans est aussi connectée aux différentes formes que prend la richesse pétrolière et ce qu’elle rend possible : la richesse sous la forme de la valeur, comme abstraction, n’est peut-être pas représentable directement en littérature – ce n’est après tout pas une chose mesurable mais un ensemble spécifique de rapports sociaux- mais les façons dont la forme valeur agit sur les rapports sociaux dans la littérature qui évoque le pétrole nous donne un moyen d’arbitrer [« mediate »] entre ces fictions elles-mêmes. » C’est donc autant autour de la perception du pétrole par les personnages, que celui-ci soit considéré comme richesse matérielle et possible ou comme valeur et malédiction, mais aussi à l’aune de la distinction « lukàcsienne » entre naturalisme et réalisme et enfin de l’articulation effectivement dynamique ou non entre nature et société ( « Quand les processus sociaux ne sont pas décrits comme se développant en rapport avec les processus écologiques mais sont plutôt entièrement subsumés dans les processus écologiques, alors le temps historique semble fusionner avec le temps naturalisé, non-humain ») que Riddle déploie sa lecture de ces deux oeuvres.
Dans « The Political Energies of the Archaeomodern Tool », Amanda Boetzkes sollicite les mannes de Marx, Frederic Jameson, Bruno Latour, le collectif Endnotes, Jacques Rancière, Walter Benjamin, etc pour commenter des oeuvres exposées à l’arsenal lors de l’exposition « All the World Futures » durant la biennale de Venise de 2015.
« Antiphysis/Antipraxis: Universal Exhaustion and the Tragedy of Materiality » d’Alberto Toscano offre une réflexion intéressante sur la trajectoire du concept d’épuisement dans la critique sociale européenne, ou comme il le décrit lui même : « une histoire courte et pour le moins impressionniste de l’épuisement. Les inquiétudes du XIXe siècle vis à vis de l’appauvrissement irrémédiable de la nature, riches en leçons matérielles, étaient aussi accompagnées d’efforts spéculatifs, cosmo-politiques, dans lesquels l’humanité était pensée dans les termes à la fois de ses fins et de sa fin. L’attention portée au contrastes et recoupements entre épuisement, dégradation et entropie comme idéologies naturalo-historiques pourrait peut-être nous servir d’antidote face à la tentation d’ériger trop rapidement l’anthropocène comme mot-clé de notre époque. Elle peut également nous fournir une appréciation plus nuancée du contexte d’émergence de la théorie matérialiste historique des rapports entre l’économie politique et la nature. » Le texte offre ensuite une réflexion sur les apports respectifs des livres et thèses de Moore et de Malm et tente de proposer, en passant par Sartre, un dépassement des clivages que ces deux auteurs incarnent : « La nature ne constitue une limite historique pour la société et le capital, uniquement dans la mesure où la société s’y est externalisée. C’est dans ce sens dialectique que nous pouvons commencer à penser le rapport entre les limites du capital et les limites de la nature d’une façon qui ne soit ni endogène, ni exogène, dualiste ou holiste ; en d’autres termes que nous pouvons commencer à penser l’anthropocène, ou plutôt le capitalocène, comme une figure géologique et historique de l’agency aliénée » où la nature » comme l’écrit Sartre » devient la négation de l’homme précisément dans la mesure où l’homme est rendu antiphysis » anti-nature. » [citation de Sartre non vérifiée].
La quatrième et dernière partie, « Politics », s’ouvre sur le texte du très prolifique théoricien marxiste de l’énergie Matthew Hubber ( voir par exemple ses nombreuses contributions dans la revue Jacobin), « Fossilized Liberation: Energy, Freedom, and the “Development of the Productive Forces”. Il faut reconnaître le mérite à Hubber de ne pas tourner autour du pot : « J’avance qu’historiciser l’énergie devrait nous amener à ré-évaluer la critique écologiste de l’insistance mise par Marx sur le développement de forces productives. Tandis que certains pourraient penser que du fait que les énergies fossiles – et par conséquence le changement climatique- sont associés aux développement industriel des forces productives nous devrions abandonner tout espoir quant à cette perspective marxienne, je pense au contraire que nous devons continuer à considérer la production basée sur les énergies fossiles comme la base matérielle pour le développement d’une société meilleure au-delà du capital. Mon argumentation procède en trois étapes. D’abord en concevant dans une perspective large l’énergie et les forces productives, je suggère qu’une sensibilité matérialiste historique doit saisir les machines comme libérant le travail de l’exploitation de l’énergie musculaire qui définissait toutes les formations sociales pré-capitalistes. Ensuite, en me plaçant au-delà du capitalisme, je re-analyse les idées de Marx sur « le temps disponible » et le « royaume de la liberté » à travers une interprétation de l’énergie requise dans le « royaume de la nécessité ». Puis, je rappelle que même si le socialisme du XXe siècle a eu un bilan environnemental atroce, les socialistes doivent réaffirmer leur engagement en faveur du développement des forces productives – mais comme le défend David Schwartzman dans son appel à un communisme solaire dans la direction du solaire et des autres énergies renouvelables et ce dans des rapports de production différents. Cette affirmation maintient la possibilité de créer la liberté à partir du temps disponible comme Marx l’avait prédit. Enfin, je rend compte de la façon dont une grande partie de la critique de gauche des questions énergétiques prédit en général deux types de futur : 1) l’effondrement dû au pic pétrolier ou la pénurie énergétique 2) la transition vers une société à faible consommation d’énergie basée sur une agriculture localisée. J’avance qu’aucun de ces futurs ne se conforme à ce à quoi Marx avait à l’esprit quant il évoquait une société au-delà du capital. Je ne cherche pas à dire qu’aucune de ces hypothèses ne soit historiquement possible – elles le sont- mais aucune des deux ne découle d’une critique de classe de l’énergie nécessaire pour construire des luttes se basant sur la possibilité d’un type différent de futur que celui lié aux conditions matérielles des énergies fossiles. » Comme le laisse présumer cette introduction, la suite du texte donne lieu à des développements plutôt prévisibles et aux habituelles « ventriloquies » marxiennes et autres échafaudages de citations décidemment bien vains. D’ailleurs si il tient tant à sauver le développement des forces productives chez le barbu pourquoi Hubber ne rappelle-t-il pas aussi son très éclairant avertissement : « le plus grand pouvoir productif, c’est la classe révolutionnaire elle-même » ? Mais c’est probablement trop en demander à l’auteur de perles comme » Bernie Is the Best Chance We Have on Climate »….
Dans « Technologies for an Ecological Transition: A Faustian Bargain? », Tomislav Medak souhaite « analyser le rôle des technologies dans deux scénarios de transition écologique opposés. Tout d’abord je vais analyser les limites caractérisant les stratégies d’innovation et de croissance vertes qui fournissent les bases de la plus grande partie de la politique internationale sur le changement climatique et que je saisis comme s’inscrivant dans la longue lignée de la doxa techno-dévelopmentaliste dominante. Dans la suite de cette doxa, ces stratégies placent des espoirs démesurés dans les processus d’innovation pour nous sortir de la situation planétaire actuelle. Ensuite je vais indiquer quelles sont les options pour un scénario de décroissance tout en prévenant contre la tentation de « picorer » [Cherry-picking] des technologies à sa guise ou de se concentrer exclusivement sur celles considérées comme conviviales ou de petite échelle. Je finis en proposant quelques éléments de stratégies qu’il pourrait être au bout du compte raisonnable d’adopter dans une transition décroissante, quand cette transition est comprise comme un processus potentiellement turbulent et révolutionnaire de changement de mode de production, d’organisation sociale et d’une relation métabolique entre l’humanité et l’environnement qui ne serait plus fondée sur la croissance économique qui soutient à la fois l’auto-expansion du capital et pousse à l’extraction accrue des ressources naturelles de la terre. » Là comme ailleurs tout le versant « prescripteur » et autres catalogues de stratégies sonnent évidemment un peu creux…
Dans « Anarchism and Unconventional Oil », Johnathan Parsons souhaite illustrer comment les résistances à la ‘fracturation hydraulique » mais aussi à l’exploitation des sables bitumeux un peu partout dans le monde (il en donne un rapide panorama) sont un exemple « d’anarchisme en action ». En effet » les nombreuses mobilisations contre les installations d’extraction de pétrole non conventionnel ne s’identifient pas nécessairement comme anarchistes et ne s’appuient pas explicitement sur les théories anarchistes dans la façon dont elles s’organisent ou opèrent. Néanmoins, comme la résistance à ces nouvelles exploitations de pétrole s’organise à la base, de façon décentralisée et dispersée et puisqu’elle se développe en dehors des structures organisationnelles souvent associées avec la politique contestataire comme les syndicats, les ONG et les partis politiques, elle reflète en général l’anarchisme en action. » De même : » La résistance à l’exploitation des pétroles non conventionnels est essentiellement anarchiste puisqu’elle agit sans leadership défini et sans structure politique avec laquelle on puisse négocier d’une quelconque manière. Néanmoins si le mouvement n’a pas de centre de coordination, il a une sorte d’intelligence de l’action, attaquant les faiblesses du système de production et de distribution de façon créative et souvent inattendue. » Si on retrouve évidemment là les idées d’un Murray Bookchin, » le mouvement dans son ensemble ressemble à cette association lâche de communautés autonomes de résistance qu’on peut voir comme les graines d’une future fédération de communes anarchistes », Parsons n’en signale pas moins la présence et les critiques de deux autres courants de l’anarchisme, l’éco-anarchisme qui vise principalement au démantèlement au plus vite de la civilisation dans sa totalité et l’anarchisme insurrectionnel, qu’il réduit maladroitement à la prose apocalyptique qui enrobe les velléités d’intégration par le haut de certaines fractions radicalisées de la petite bourgeoisie culturelle française. Notons par ailleurs qu’il est étonnant que Parsons ne semble voir ce « néo-anarchisme » de masse à l’oeuvre que dans la lutte contre les « gaz de schiste », etc., alors qu’on pourrait l’identifier un peu partout dans les luttes et le monde comme l’avait par exemple théorisé Paolo Gerbaudeau dans The Mask and the Flag. Populism, Citizenism and Global Protest….
Le recueil se clôt sur deux très intéressants textes portant sur les travailleurs du pétrole, et assimilé ( sables bitumeux notamment) au Canada. « Oil Drums: Indigenous Labour and Visions of Compensation in the Tar Sands Zone » de Warren Carriou, auteur d’un documentaire (Land of Oil and Water) sur le sujet, s’appuie sur l’expérience personnelle de l’auteur et de sa famille pour évoquer la situation des indiens qui travaille dans le secteur pétrolier et toute la propagande qui entoure cette « heureuse conclusion » : » La description des opportunités d’emploi [souvent assez bien payés comparé à la moyenne] comme étant un moyen « de partager la richesse » avec les peuple indigènes constitue un lieu commun du discours gouvernemental et entrepreunarial sur le développement des sables bitumeux. Ce qu’on n’évoque pas en général c’est pourquoi les propriétaires putatifs de cette richesse voudraient cette fois-ci la partager avec les peuples indigènes- contrairement à toute l’histoire coloniale précédente- et quelles conditions sont attachées à ce partage supposément magnanime. Le fait que ces ressources pétrolière se trouvent » dans de nombreux cas sur des terres tribales » soulève une question intéressante pour les peuples indigènes : qui doit partager avec qui ? Quoique cette stratégie d’emploi soit présentée comme un acte généreux de réconciliation néo-libérale, il est possible que les compagnies aient plus besoin des indigènes que vice-versa. »
« The Oil Bodies: Workers of Fort McMurray » de Dominique Perron (traduit du français par Wafa Gaiech) débute sur un mode « éthnographique » plutôt laborieux si ce n’est douteux ( description du voyage en avion de l’auteur en compagnie de travailleurs de l’industrie pétrolière) mais s’avère une description incisive des multiples paradoxes qui entourent l’existence de cette « aristocratie ouvrière » constamment sur la sellette que sont les travailleurs du pétrole, etc de l’Alberta. Et comme le souligne un glaçant postscriptum, après l’incendie de mai 2016 qui a détruit la plus grande partie de Fort Mc Murray, ce que Perron qualifie a juste titre d’étonnant « cercle autophagique » ( l’exploitation du pétrole, etc provoque le changement climatique qui provoque les incendies) semble se refermer sur ces travailleurs pris au piège de la logique hyper-individualiste et mercenariale du secteur….
A l’issue de ce laborieux mais selon nous nécessaire, « panorama », on n’étonnera pas le lecteur éventuellement égaré ici, en concluant que ce recueil Materalism and the Critique of Energy a certes les défauts de ses qualités (et réciproquement), témoigne d’une tendance lourde à la sur-théorisation au détriment d’analyses concrètes de situations concrètes qui seraient parfois plus éclairantes ou manifeste quelques oublis surprenants ( pas de critique féministe par exemple alors pourtant que la critique des systèmes énergétiques est indissociable de celles des rapports de reproduction). Mais il n’en constitue pas moins un jalon et une lecture indispensables pour saisir les enjeux d’une critique radicale de l’énergie.
Crise d’époque ou transition ?
« Nous pouvons considérer ici deux grandes formes de crise écologique mondiale. Il ne s’agit pas de crises « écologiques » au sens cartésien du terme, mais de crises qui signifient des tournants plus ou moins fondamentaux – entre ou au sein de certains modes de (re)production de la richesse, de la nature et du pouvoir. La première forme est constituée par les crises d’époque. Ces crises sont si graves qu’un mode de production de la richesse, de la nature et du pouvoir cède la place à un autre. La crise du féodalisme du « long » XIVe siècle (vers 1290-1450) est l’une de ces crises d’époque. La seconde est constituée par les crises de développement. Ces crises transforment qualitativement les rapports de pouvoir, de richesse et de nature au sein d’un mode de production donné. La « révolution féodale », autour de 1000 après J.C., en est un bon exemple. Dans l’histoire du capitalisme, les crises de développement scandent la transition d’une phase du capitalisme à l’autre. C’est l’histoire des révolutions écologiques mondiales – saisies dans les historiographies sur les « révolutions » agricoles, industrielles, commerciales, scientifiques et autres – depuis le XVIe siècle. À travers les crises de développement, de nouvelles façons de marchandiser et de configurer l’oikeios prennent forme. »
Jason Moore Le capitalisme dans la toile de la vie p. 178.
Sans prétendre, bien sûr !, trancher une telle question, cette rubrique cherchera tout de même, humblement, à la densifier en l’illustrant par quelques dynamiques actuelles dans un certain nombre de domaines…
Sparking a Worldwide Energy Revolution: Social Struggles in the Transition to a Post-petrol World
Sparking a Worldwide Energy Revolution: Social Struggles in the Transition to a Post-petrol World, Édité par Kolya Abramsky, AK Press 2010.
Pas facile de s’y retrouver dans ces près de 700 pages où on compte 59 textes différents d’auteurs d’horizons très variés. Mais si, à première vue, l’ensemble paraît nécessairement, au rythme où vont les choses !, un petit peu daté et surtout trop hétéroclite ( le recueil mélange textes d’universitaires, de militants, d’ONG et même d’un homme d’État (!) et autant de l’information, que de la théorie, de la protestation que des considérations de circonstance), l’éditeur, Kolya Abramsky parvient finalement à bien dégager les lignes de force qui lui tiennent à coeur. On tachera au fil du sommaire d’en donner ici un aperçu…
Dans son introduction, » Racing to Save the Economy or the Planet. Capitalist or Post-capitalist Transition to a Post-petrol World » il précise d’emblée l’espoir qu’il met dans les luttes et initiatives entourant partout sur la planète la « transition énergétique » : » Le processus de construction d’un nouveau système énergétique, basé sur un usage grandement élargi des énergies renouvelables, peut potentiellement être une contribution importante à la construction de nouveaux rapports de production, d’échange et de reproduction qui soient basés sur la solidarité, la diversité et l’autonomie et soient substantiellement plus démocratiques et égalitaires que les rapports actuels. De surcroît, la construction de tels rapports sera probablement nécessaire pour éviter les « solutions désastreuses » qu’annoncent les multiples et interagissantes crises politiques, financières et économiques. » Pourtant, comme il le reconnait peu après : » La production et la distribution de l’énergie jouent un rôle central dans la détermination des rapports humains. Chaque forme d’énergie suppose une organisation particulière du travail et de la division du travail (et ce, en général et dans le secteur de l’énergie en particulier). Les plus importantes transformations sociales, économiques, culturelles, politiques et technologiques dans l’histoire ont été associées à des tournants dans la production de l’énergie : de la chasse et la cueillette à l’agriculture, de l’énergie humaine et animale pour le transport et la production au vent et à la machine à vapeur, du charbon au pétrole et à la fission nucléaire comme moteurs de l’industrie et de la guerre. Toutes ces transformations ont mené à un accroissement de la concentration du pouvoir et de la richesse. Et il existe la possibilité bien réelle que les transformations à venir dans le système énergétique mondiale résultent en de similaires évolutions des rapports de pouvoir. » L’issue lui paraît pourtant nettement ouverte, et ce tout d’abord parce que dans ce domaine, comme dans d’autres, l’inexorable et l’unilatéral ne sont que des faux-semblants : » L’énergie a deux fonctions jumelles et contradictoires. D’un côté, l’énergie est une marchandise hautement profitable pour la production et l’échange sur le marché mondial et une matière première essentielle dans la production et la circulation des autres marchandises. Et d’un autre côté, elle est fondamentale à la vie et à la subsistance humaine. De ce fait, l’énergie est un lieu important de conflits et de luttes continus, l’un des aspects centraux de ces luttes étant la tension perpétuelle entre l’énergie comme marchandise à vendre et l’énergie comme moyen de subsistance. Les luttes pour le contrôle de l’énergie (…) ont eu un impact crucial sur le développement historique du capitalisme comme ensemble global de rapports sociaux. »
Donc pour Abramsky : « Nous connaissons actuellement les premières étapes de ce qui sera certainement une lutte longue et complexe pour déterminer si le capital parviendra avec succès à forcer le travail ( c’est à dire les gens à travers le monde de même que l’environnement lui-même que le capitalisme vert prétend vouloir sauver) à supporter le coût de la construction du nouveau régime énergétique ou si le travail ( c’est à dire les luttes sociales et écologiques de par le monde) sera en mesure de forcer le capital à en faire les frais. Cette lutte est d’ores et déjà devenue centrale dans la détermination des rapports sociaux et va probablement le devenir d’autant plus dans les années à venir. » Les mésaventures françaises récentes de la taxe carbone peuvent sembler effectivement lui donner raison…. En tout cas dans la veine de Caffentzis et, comme l’illustre bien le recueil, il y a, selon lui, la possibilité d’une convergence mondiale autour de ces luttes sur l’énergie autant entre les travailleurs du secteur, tous ceux affectés par ses restructurations dans les pays riches comme pauvres que les communautés tribales ou paysannes victimes des diverses déprédations extractivistes. Voeu pieux ? Peut-être, mais certes plus stimulant que les unions sacrées, méta-solutions technocratiques, plans quinquennaux, communismes de guerre etc, etc qui tiennent en général le crachoir sur le sujet. D’ailleurs Abramsky donne une précision utile à la fin de son introduction : « l’expérience des régimes énergétiques renouvelables capitalistes du passé viennent nous rappeler que les rapports de production, basés sur les enclosures et l’exploitation, ne sont pas exclusivement associés aux énergies fossiles ou nucléaires. Il n’y a rien d’automatiquement émancipateur dans les énergies renouvelables. »
La section intermédiaire qui succède à l’introduction, le recueil reproduisant deux textes de George Caffentzis que nous avons évoqué dans le post consacré à ses écrits sur l’énergie, nous n’y revenons pas. La première section intitulée « Up against the Limits: Energy, Work, Nature, and Social Struggles » s’ouvre sur cette présentation : » Cette section explore le rôle de l’énergie dans le maintien et la reproduction des rapports de classe et de genre, les rapports de production et de reproduction. L’énergie est un substitut au et un amplificateur du travail humain. Cela signifie que l’énergie et les rapports humains sont intimement entremêlés, l’énergie jouant un rôle central dans la division capitaliste du travail en général. Néanmoins, le secteur de l’énergie a lui même sa propre division spécifique du travail. Par conséquent, le système énergétique est loin d’être homogène. Il est parcouru par des hiérarchies, des inégalités et des luttes. Il existe en particulier des luttes majeures concernant la propriété, les conditions de travail, l’accès à l’énergie et la fixation du prix et des conflits écologiques et sur l’appropriation des terres ainsi qu’en terme de détermination des rapports de genre. (…) Un des aspects majeurs de la restructuration en cours du secteur ce sont les luttes contre la privatisation qui cherchent à développer différentes formes de propriété commune, collective, coopérative ou publique des ressources et infrastructures énergétiques. Ces luttes sont aussi fréquemment liées aux luttes concernant l’accès et le prix de l’énergie. (…) Il s’agit d’une lutte mondiale portant sur la marchandisation des ressources énergétiques en tant que telles et le degré de leur marchandisation. » Précisons que le « courant » fondé par Caffentzis, Federici, Linebaugh, etc et dont Abramsky provient, parle des « nouvelles enclosures » et des « communs » depuis la fin des années 80 c’est à dire bien avant que le terme soit mis à toutes les sauces par les diverses branches de la gauche hexagonale….
Dans le premier texte de cette première section, « Machinery and Motive Power: Energy as a Substitute for and Enhancer of Human Labor », Tom Keefer donne sa version de la crise : » L’introduction et la mise en oeuvre du machinisme est fondamentalement liée à la lutte de classe et à l’extraction de survaleur. Sous le capitalisme, la technologie n’est pas une force neutre se développant spontanément selon ses propres règles mais un moyen par lequel les capitaux individuels peuvent surpasser leurs rivaux et un outil grâce auquel le capital dans son ensemble peut maintenir son contrôle sur la classe ouvrière. Certaines innovations technologiques peuvent résulter en la disparition de secteurs entiers d’industrie ( comme cela se produisait déjà à l’époque de Marx), mais le processus global reste celui de l’intégration de toujours plus de travailleurs dans le rapport salarial alors même que la technologie de la production capitaliste avance implacablement. Ce processus a toutefois un talon d’Achille, c’est à dire la quantité limitée d’énergie fossile disponible sur la planète et les limites thermodynamiques affectant toutes les formes d’appropriations d’énergie nécessaires pour faire fonctionner les machines. » Le texte suivant de Abramsky encore, « Energy, Work, and Social Reproduction in the World-economy », est plus précis. Après avoir rappelé qu’une fois l’énergie marchandisée, son prix joue un rôle central dans la reproduction sociale, il note : » Le XXe siècle, particulièrement après la seconde guerre mondiale, a vu le « travail cher » et « l’énergie bon marché » marcher main dans la main. Cela a été un facteur essentiel dans la prévention et l’endiguement de la lutte de classe de par le monde, particulièrement aux États-Unis, où cela constituait un élément central de l’hégémonie américaine. Désormais qu’un tournant majeur global dans l’énergie va se produire, la question n’est plus si tournant il y aura mais de quel type il sera, basé sur quelles technologies ? Comment les changements dans le secteur de l’énergie vont affecter le rapport entre le capital et le travail et entre les formes de travail payé et non payé ? Alors que les sources d’énergie deviennent plus couteuses ( en termes monétaires, sociaux, politiques et écologiques) il y aura probablement un effort correspondant de la part du capital pour faire baisser le cout du travail ( pas seulement en terme de réduction des salaires mais aussi concernant les autres couts du travail et particulièrement faire porter le fardeau de la reproduction de la force de travail mondiale au travail non payé, principalement féminin). (…) Les conflits seront probablement particulièrement aigües aux USA, où la hausse du cout du travail a pu être partiellement empêchée grâce à l’énergie bon marché. La stratégie jumelle soulignée plus haut a converti de larges secteurs de la classe ouvrière à la sur-consommation d’énergie. De ce fait, les travailleurs américains sont incroyablement vulnérables aux changements massifs qui sont en train de se produire dans le système énergétique mondial. »
Peter Podder dans « A Shortage of Oil to Save Our Climate? On the Permanent Oil Crisis, Peak Oil and the Interaction Between the Two » souligne également une autre interaction spécifiquement américaine, c’est l’interdépendance du système monétaire avec le marché du pétrole puisque le pétrole a en quelque sorte remplacé l’étalon-or, » le pétrole étant échangé en dollar, il y a eu besoin continu et croissant de dollars. Cela a permis à la réserve fédérale de continuer à faire tourner la machine à billets et donc à l’État américain de continuer à dépenser. » Podder souligne également le lien étroit et inverse qu’il y a dans la société américaine entre les prix de l’énergie et le taux d’endettement des ménages. Notons aussi que cet auteur décrit aussi plutôt habilement une des interactions entre changement climatique et hausse des coûts de l’énergie, avec les gazoducs russes rendus inutilisables par la disparition du permafrost, les ravages à répétition des ouragans sur les plates-formes off-shore et les effets dévastateur des inondations et glissement de terrain sur les mines de charbon en Chine et ailleurs… On trouve sinon dans le reste de cette première section des pronostics assez vains sur le Peak Oil et d’ailleurs le « Peak d’à peu près tout » ( Peak Everything ), quelques panoramas régionaux convenus mais aussi un bon compte-rendu, certes un peu daté désormais, des luttes contre la privatisation de l’électricité dans le monde, deux textes intéressants sur une nouvelle forme de « bargaining anti-extractiviste » au Nigeria comme en Équateur c’est à dire l’appel à laisser les hydrocarbures dans le sol en échange de compensations de la communauté internationale et enfin un très éclairant récit des luttes contre la privatisation de l’électricité en Afrique du Sud, « Community Resistance to Energy Privatization in South Africa » de Patrick Bond et Trevor Ngwane. Les deux auteurs rappellent tout d’abord que l’électricité fut un enjeu central des luttes anti-apartheid, avec certes des sabotages de pylônes dés les années 60 par l’ANC mais surtout la lutte constante pour obtenir le raccordement au réseau des communautés noires puis le boycott du paiement des factures dans les Townships dans les années 80. La fin de l’apartheid et le tournant néo-libéral de l’ANC n’a en rien émoussé la combativité des populations autour de cet enjeu, avec notamment la formation en 2000 du SECC ( Soweto Electricity Crisis Committee) qui en menant l’opération Khanysia ( allumer la lumière) a permis de contourner la vague de coupures initiée par la compagnie nationale Eskom, en rétablissant, grâce à des électriciens informels formés par ses soins, le courant à plus de trois mille personnes tout en allant effectuer quelques coupures sauvages chez les pontes et politiciens impliqués. Lorsque la police a voulu effectuer des interpellations, ce sont plus de 500 personnes qui se sont rendues au commissariat pour se constituer prisonnier. Eskom abandonna alors ses velléités de coupures.
La seconde section de livre, « From Petrol to Renewable Energies: Socially Progressive Efforts at Transition Within the Context of Existing Global Political and Economic Relations », veut illustrer comment « certaines expériences autour des énergies renouvelables ont débouché simultanément sur un haut niveau de production d’énergie et une plus grande autonomie communautaire et souveraineté énergétique, du moins au niveau local. » Pour l’éditeur du recueil : » il est crucial de comprendre ces « success stories », dans le contexte où elles ont émergé, afin de défendre leurs acquis ( de plus en plus menacés) et s’assurer que l’expérience gagnée soit exploitée avec succès par un projet de transition émancipateur plutôt qu’elle finisse écrasée avant même de pouvoir être partagée et qu’elle soit co-optée pour d’autres objectifs. » Louable intention qu’illustre de façon moins convaincante les récits successifs de « success stories » qu’on a l’impression d’avoir déjà lu cent fois sur le financement coopératif de l’éolien au Danemark ou en Allemagne, les miracles énergétiques accomplis par le « socialisme de pénurie » cubain ou les expérimentations avec la technologie du biogaz en Inde…
La troisième section, « Struggles Over the Choice of Future Energy Sources and Technologies », « explore la question controversée des choix appropriés concernant les sources d’énergie et les technologies et les luttes qui l’entourent. » C’est à dire les tentatives du secteur des énergies fossiles de se perpétuer au détriment d’un secteur des renouvelables encore trop « timoré » selon Abramsky. Si effectivement on ne voit pas pourquoi, encore aujourd’hui, malgré le quasi consensus capitalo-étatiste mondial sur la transition énergétique, les majors, leurs actionnaires et les diverses pétro/nucléaro/carbono/-craties du monde (et leurs employés et obligés !) accepteraient de se rendre sans combattre par tous les moyens à leur disposition, il est toutefois peu probable que le triomphe des uns sur les autres soit porteur d’autre chose que du même, mais en plus durable. Cette section présente néanmoins d’intéressantes études de cas sur les sables bitumeux au Canada (« The Smell of Money: Alberta’s Tar Sands »), la tortueuse politique nucléaire, civile mais aussi, on le sait moins, militaire, japonaise (« Japan as a Plutonium Superpower »), le charbon en Chine ( « Bone and Blood: the Price of Coal in China » par le China Labour Bulletin), les agro-carburants au Brésil (« Brazil as an Emergent Power Giant: the “Ethanol Alliance ») et au niveau global (« Global Fuel Crops as Dispossession » de Les Levidow et Helena Paul qui souhaite relier « deux perspectives théoriques : le marché des agro-carburants comme réseau intégré globalement et l’ accumulation par dépossession. En liant ces deux perspectives, les marchés peuvent être saisis comme intégrant les États dans le réseau du capital global, ce qui réduit leurs capacités et volontés de protéger les modes de vie et environnements locaux, particulièrement dans le sud global. Les élites politiques et économiques satisfont aux demandes des forces globales pour déposséder les communautés de leurs ressources. »), sans oublier quelques « peaks » pour la route ( uranium et charbon cette fois-ci… on ne sait plus qui épuise qui à seriner ainsi l’épuisement !)…
La quatrième section « Possible Futures: The Emerging Struggle for Control of the Globally Expanding Renewable Energy Sector and the Roads Ahead » s’ouvre sur cette présentation : » La production et la consommation d’énergie sont sur le point de devenir absolument centraux dans les dynamiques politiques, économiques et financières globales. Les changements dans le secteur de l’énergie seront indissociables des voies choisies pour sortir de la crise économico-financière globale, et ce processus devient de plus en plus conflictuel. Le conflit existe. Il ne peut être annulé comme par enchantement. Ce n’est pas le moment de rester neutre car il faut construire collectivement un réalignement des forces. (…) Il est certain que le secteur des énergies renouvelables en général, et l’éolien en particulier, vont connaître une croissance globale massive et rapide dans les années qui viennent. Une lutte mondiale sur la façon dont cette croissance va se dérouler, et où et comment ses fruits seront distribués est en train de s’intensifier. Les questions de la propriété et du contrôle deviennent centrales, comme les sont les conflits du travail sur les lieux de production des infrastructures et des matières premières. Les conflits territoriaux dans les zones rurales riches en énergie renouvelables seront aussi cruciaux. Un conflit politique s’ouvre pour savoir qui détiendra les savoir et qui recevra la formation pour utiliser les énergies renouvelables et selon quels termes et pour quel but. Le résultat de ces luttes déterminera quel type de transition va se dérouler, sa profondeur et son rythme. Alors que le capitalisme vert semble ouvrir la voie à un nouveau cycle d’accumulation globale, les technologies vertes vont devenir un lieu important de lutte de classe et seront au coeur de la tentative d’imposer un nouveau compromis global aux travailleurs, payés ou non payés, à travers le monde. »
L’inconvénient c’est que les textes de cette section ont bien du mal à donner chair à cette hypothèse. Ainsi « Denmark: Politically Induced Paralysis in Wind Power’s Homeland and Industrial Hub » de Preben Maegaard qui décrit le très prévisible démantèlement de l’éolien coopératif dés lors que le secteur fut libéralisé en 1998, avec une frénésie d’OPA, une course au gigantisme et finalement le retournement de la société danoise contre cette énergie. Par de surprise non plus avec « The Situation of Employees in the Wind Power Sector in German » écrit par un syndicaliste d’IG Metall qui nous apprend que les employés du secteur connaisse une situation en tout point équivalente à celle des divers précariats. Cette section reproduit d’ailleurs de nombreux textes syndicalistes, politiques ( l’incontournable Evo Morales du temps où tous les chemins menaient à La Paz) ou d’ONG sans grand intérêt, même documentaire. Citons tout de même « Fighting the enclosure of Wind: Indigenous Resistance to the Privatization of the Wind Resource in Southern Mexico » de Sergio Oceransky qui raconte une lutte dans l’État de Oaxaca : « Les communautés indigènes de la côte pacifique de l’isthme de Tehuantepec sont en première ligne d’un champ de bataille global émergent qui va déterminer, dans une large mesure, les conséquences sociales et écologiques de la transition vers les énergies vertes. Cette région généreuse et rebelle offre la possibilité de comprendre la nature et les caractéristiques d’une situation qui va probablement devenir de plus en plus courante dans les décennies à venir : le conflit entre des firmes essayant d’obtenir l’accès exclusif à des territoires riches en énergies renouvelable et des communautés affirmant leur contrôle sur leur terre et défendant leurs ressources et modes de vie. Le conflit à Tehuantepec résulte du fait que cette région est doté de parmi les meilleurs ressources éoliennes au monde. Grace à cet excellent vent, il est moins cher pour les entreprises de générer directement de l’énergie éolienne que de l’acheter au réseau. Cela a provoqué une « ruée sur le vent »dans laquelle plusieurs consortiums formés par des entreprises mexicaines et étrangères ont tenté de s’assurer des droits exclusifs sur la région. » Le même auteur signe également » The Yansa Group: Renewable Energy as a Common Resource », qui décrit un projet international visant à permettre aux communautés rurales de par le monde de générer et contrôler elles-mêmes leur énergie. Texte que précédait un autre sur l’installation d’éoliennes dans les zones « sous contrôle zapatiste » au Mexique toujours. Étrangement placé au milieu de ce tableau convenu de luttes et d’alternatives « From World Economic Crisis to Green Capitalism »de Tadzio Mueller and Alexis Passadakis considère que « la biocrise ( ?) est une opportunité qui pourrait permettre au capital et aux gouvernments de pouvoir faire face au moins temporairement à leurs crises d’accumulation et de légitimation. Comment ? En internalisant l’antagonisme qui se trouve au coeur de la biocrise- celui entre vie humaine et capital- pour déployer un nouveau round d’une accumulation supposément verte et comme instrument de légitimation pour étendre l’autorité de l’État dans les moindres recoins de la vie quotidienne. »
Dans sa longue conclusion, « Sparking an Energy Revolution: Building New Relations of Production, Exchange and Livelihood », Kolya Abramsky rappelle le fondement de cet ambitieux projet : » Ce livre a cherché à montrer que le processus de construction d’un nouveau système énergétique, basé sur une large part, voire même 100%, d’énergie renouvelable n’est une question technique mais profondément politique et sociale. Une transition accélérée ne va pas se produire inévitablement mais via des choix et des activités collectifs et délibérés des humains. Les nombreux chapitres de ce livre, écrits par un large spectre d’acteurs du secteur énergétique global, ont posé cette question cruciale : qui va amener cette transition et ccomment ? De façon importante, une transition ne suppose pas simplement la victoire des bonnes idées sur les mauvaises, mais plutôt un nombre massif de personnes s’engageant activement et prenant le contrôle sur la production et la consommation d’énergie en général et des renouvelables en particulier. » Toutefois, si cette anthologie permet certes de se faire un idée de l’enjeu et évite bien des écueils et platitudes « écologiques classiques », elle laisse le lecteur sur sa faim tant sur le plan de l’alternative que de la critique ( les besoins en énergie ne sont ainsi jamais interrogés)…