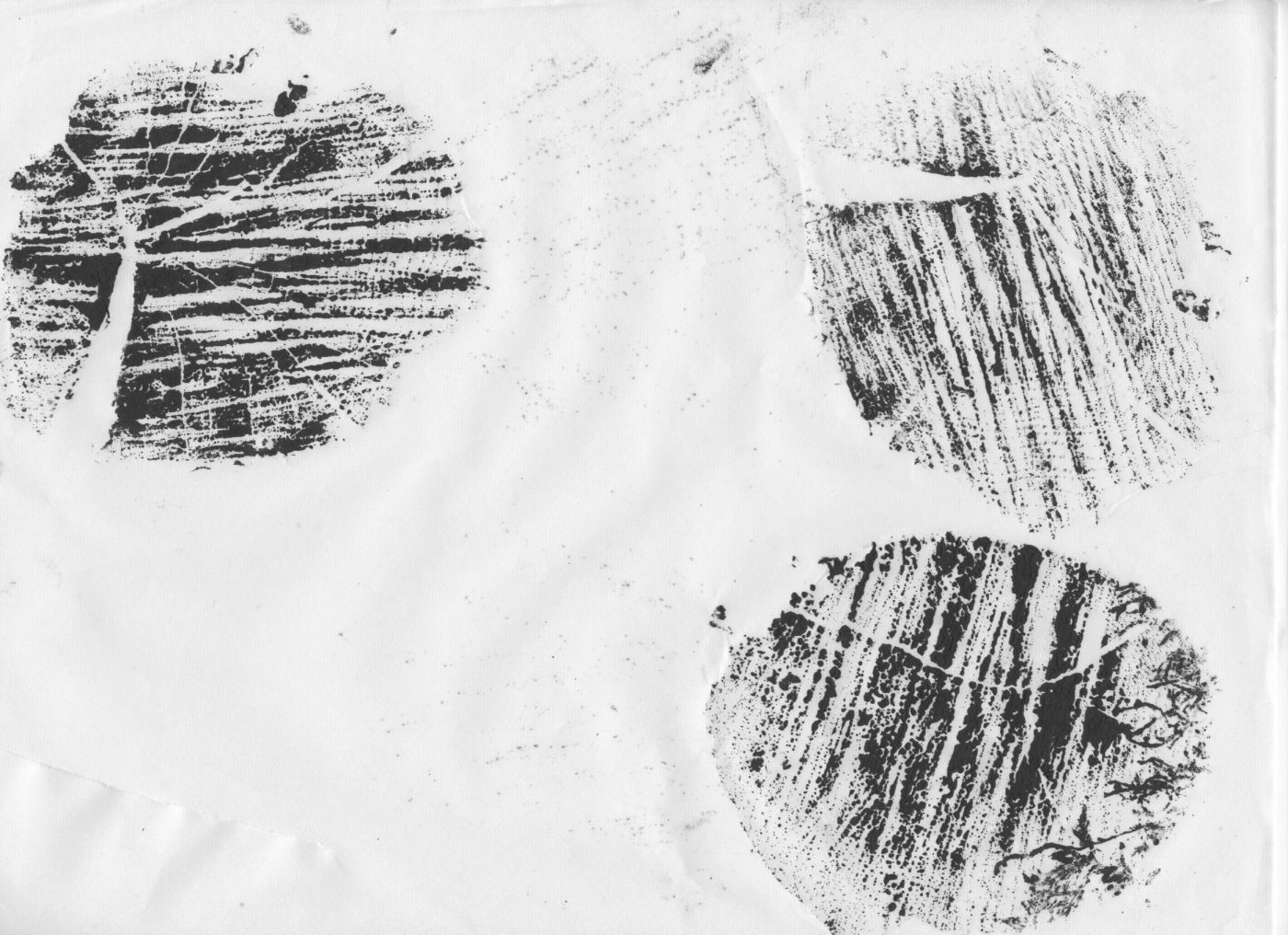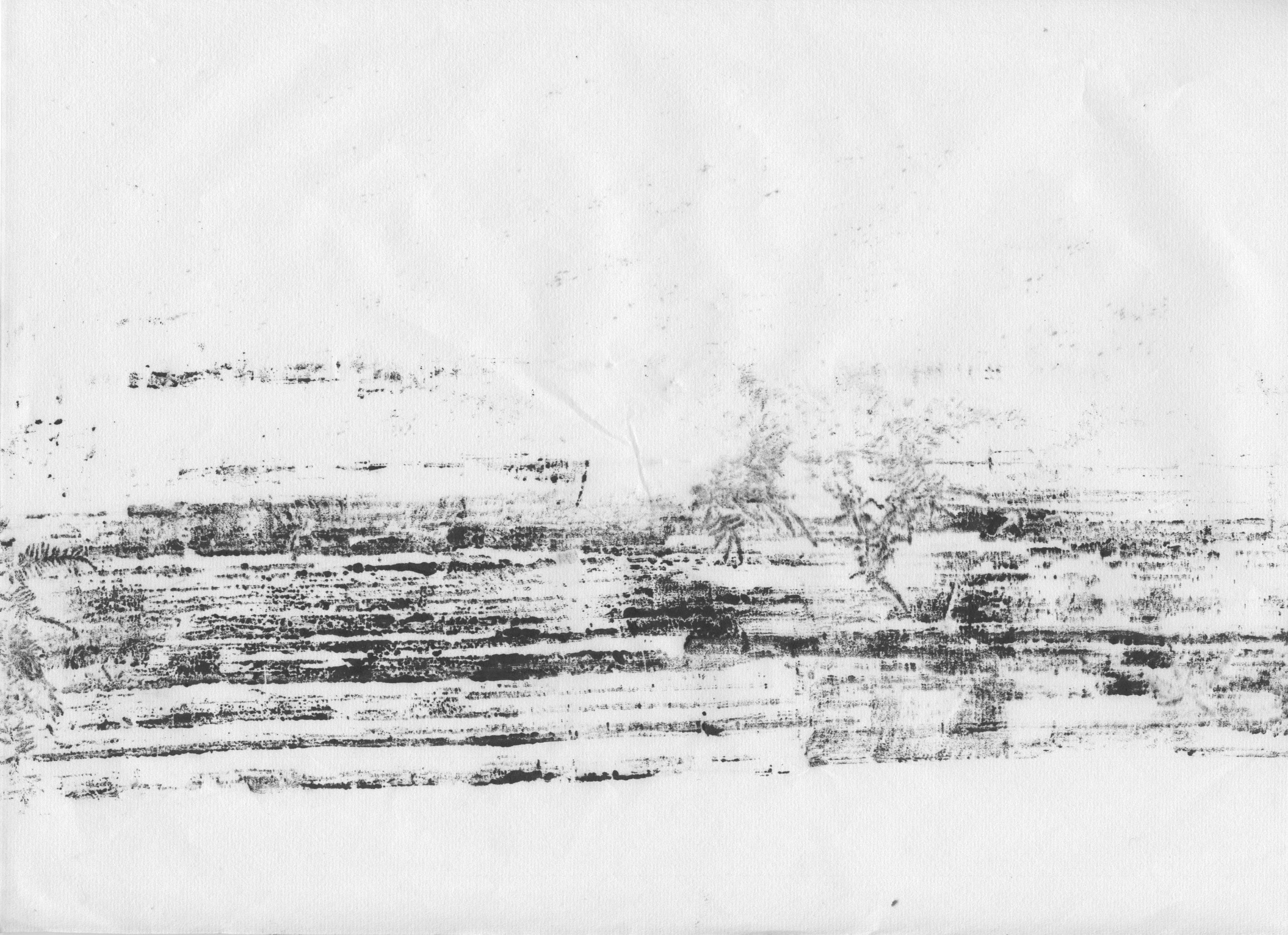David E. Nye, Consuming Power. A Social History of American Energies, Cambridge (Massachusetts)/ Londres, The MIT Press, 1998.
Voilà un livre déjà ancien, mais dont la très relative ancienneté ne nuit finalement pas. C’est notamment que l’approche de Nye n’est pas sans rappeler celle de Lewis Mumford, ses qualités et défauts et indéniablement son gout tant du détail que de la synthèse. D’ailleurs Nye attend, étrangement, la conclusion de son livre pour admettre que son projet consistait « de différentes manières à re-conceptualiser le classique de Mumford Technique et civilisation (1934). Tandis que Mumford examinait toute la civilisation occidentale, je me suis concentré plus spécifiquement sur le États-Unis. Tandis que Mumford discernait trois époques couvrant plus d’un millénaire, j’ai décrit six époques correspondant à moins de 400 ans. » Plus encore, il se distingue de ce qu’il qualifie de « déterminisme » progressif de Mumford, où un pessimisme croissant sur « l’autonomisation de la technique » vient couronner la conviction plus ancienne que « les innovations [techniques] provoquent automatiquement le changement ». Nye prétend partir » de présupposés différents concernant le rapport entre les hommes et les machines. Je ne parle pas » de techniques centrées sur le pouvoir » qui prennent les commandes mais de choix- de comment les gens déterminent les techniques. Je souligne l' »agency » humaine et la différence culturelle. » Si le « dernier » Mumford ( et principalement celui du second tome du Mythe de la Machine – au fait : le premier tome a été retraduit/republié en 2019 par l’Encyclopédie des Nuisances) ressemble effectivement à ce que décrit Nye, on a toutefois plus l’impression que c’est le chrétien Ellul et sa déclinaison modernisée du « péché originel » ( cf La technique ou l’enjeu du siècle), qu’il vise au bout du compte …
Quoi qu’il en soit, la question qui anime ce « bilan fin de siècle » est simple : » Comment les États-Unis sont-ils devenus le plus grand consommateur mondial d’énergie ? » Et ses « présupposés de départ » semblent l’être tout autant : » [Consuming Power] ne part pas du principe que plus d’énergie constitue un progrès, que plus d’énergie correspond à plus de civilisation ou que la technologie détermine inexorablement l’histoire. Il suppose plutôt qu’alors que les américains incorporaient de nouvelles machines et procédés dans leur vie, il se trouvèrent pris au piège dans des systèmes énergétiques qui ne pouvaient être aisément changés. Le marché régulait souvent ce processus d’incorporation mais il n’a pas dicté quelles seraient les technologies adoptées. Dans leur quotidien, les américains en sont venus à dépendre de plus de chaleur, de lumière et d’énergie qu’aucun autre peuple, y compris ceux au même niveau de développement. Le capitalisme et l’industrialisation n’expliquent pas à eux seuls ce développement rapide ou cette différence nationale. Seule la culture le peut. » On comprend aisément le lecteur qui aurait d’ores et déjà envie de tourner casaque, surtout vis à vis d’une culte de l’exceptionnalisme américain tenant plus que jamais lieu d’auto-intoxication, particulièrement dans ce domaine. Si sa notion de « culture » est pour le moins extensive et qu’il se méfie d’un marxisme qu’il réduit à ses versions les plus téléologiques, Nye n’en est pas moins conscient de la centralité des dynamiques sociales et donc effectivement de « l’agency » de ses acteurs que tant de littérature sur le sujet occulte ou ignore soigneusement.
Ainsi il précise dans la suite de son introduction : « Tout autant les fermiers que les ouvriers contrôlaient littéralement la première source majeure d’énergie : l’énergie musculaire. L’énergie musculaire humaine a creusé les premières mines, érigé les premiers buildings et créé la plupart des produits vendus sur le marché. L’eau et la « vapeur » n’ont que partiellement remplacé l’énergie musculaire durant le dix-neuvième siècle. Cette substitution a réduit les efforts physiques demandés aux travailleurs, mais elle a aussi permis aux managers d’utiliser l’énergie mécanique pour gagner un pouvoir de surveillance et de contrôle sur le lieu de travail. En contrôlant l’énergie hydraulique dans les usines textiles de Lowell, les managers étaient capables de dicter le rythme du travail. L’énergie thermique (et plus tard l’électrification) ont été utilisées pour gagner encore plus de contrôle à travers l’introduction de nouvelles machines et systèmes qui remplaçaient certaines tâches exercées par des travailleurs qualifiés. En réponse les ouvriers trouvèrent de nouveaux moyens de maintenir leur autonomie dans l’atelier et pour résister aux tentatives d’organiser et de diriger leur travail. Les travailleurs étaient souvent inventifs, améliorant collectivement les procédures de travail pour accroître la production et la qualité. Ils étaient, de façon bien compréhensible, bien moins dévoués à l’amélioration du système manufacturier qu’à la défense de leur gagne-pain, et cela supposait souvent de poser des limites volontaires à la production. La lutte continuelle du travail est inséparable des systèmes énergétiques et des nouvelles machines qui lui sont liées. »
Le livre se décompose en trois grande parties : « Expansion », « Concentration », « Dispersion ». Dans la première partie, il revient tout d’abord sur les débuts de la société américaine via son « invention » à la suite de ses « illustres » prédécesseurs européens, d’une « terra nullius » qui justifiait le plein déploiement de l' »énergie de conquête », au détriment bien évidemment des « natifs » : » Tandis que les amérindiens considéraient leur rapport avec la terre sous l’angle de la réciprocité, les colons utilisaient les ressources naturelles; ils tendaient à » transformer la nature en des faisceaux distincts de marchandises » et « à intégrer le monde naturel dans l’économie monétaire ». Un des exemples les plus évidents de ce processus c’est la façon dont les colons européens se sont approprié les forêts. (…) Les amérindiens coupaient des arbres au même rythme que ceux-ci repoussaient mais les colons européens eux dépouillaient le continent de ses forêts. En agissant ainsi ils reproduisaient le processus de déforestation qu’avaient connu de grandes parties de la France et l’Angleterre au milieu du XVIIe siècle et les avaient forcé à devenir des importateurs de bois, d’adopter le charbon et de subir la pollution de l’air dans leurs villes pré-industrielles. » La production métallurgique et les moulins à eau vinrent compléter cette redéfinition fondatrice de « la nature comme ressource » ainsi, bien sûr, que les expropriations et massacres successifs des amérindiens. Si tout cela est certes déjà bien connu, Nye a le mérite de rappeler que les nouveaux colons étaient loin de correspondre au mythe classique du fermier « auto-suffisant » car, en l’occurrence : » Les colons européens avaient amené avec eux une division extensive du travail. En plus de ne pas couper eux-mêmes leurs planches, la plupart ne tissaient pas leurs habits, ne pouvaient pas moudre eux-mêmes leurs grains ou faire du cidre à partir de leurs pommes. Cette spécialisation stimulait l’expansion. » Bref, cette première « révolution » agricole, énergétique, etc s’appuyant encore principalement sur l’énergie musculaire ouvrait la voie à une phase nouvelle qui allait progressivement se centrer sur l’énergie hydraulique.
Si on a souvent tendance à célébrer les vertus de l’énergie hydraulique quand on l’oppose au charbon centralisateur, polluant, non renouvelable et ignorant les saisons, elle n’en remplissait et n’en remplit pas moins dans des rapports sociaux donnés une mission donnée. Ainsi dans cette seconde phase de développement de la société américaine qu’est la subordination de l’énergie musculaire à l’énergie hydraulique, la construction de grands barrages, notamment sur la fleuve Merrimack pour alimenter en énergie les grandes concentrations d’industries textiles du Massachusetts, constitue un tournant important : « Un tel barrage [ Nye évoque ici celui de Lawrence sur le Merrimack] éliminait les fermes en contre-bas, empêchait les saumons et autres poissons de migrer et forçait tous les bateaux empruntant le fleuve à passer à travers des écluses. Le barrage proclamait visiblement l’existence d’un contrôle centralisé, non seulement sur les forces naturelles mais aussi sur la force musculaire. Les fabriques rassemblaient les énergies irrégulièrement distribuées des eaux et des travailleurs en un flot uniforme. Ceux qui naviguaient sur les eaux à l’extérieur des fabriques se retrouvaient « gouvernés » par les écluses, comme Henry David Thoreau l’avait constaté lors de son voyage sur le Merrimack. Ceux qui travaillaient à l’intérieur de ces fabriques étaient assujettis aux vrombissements et grondements des machines et ils sentaient une pression immuable s’exercer pour qu’ils se conforment au rythme général. » Voilà un parallèle que Jason Moore ne renierait certes pas…
Pour Nye, cette essor de l’énergie hydraulique joue également un rôle central dans la divergence de trajectoire du nord et du sud et donc la montée progressive vers le conflit malgré l’illusion temporaire d’une complémentarité relative ( produits manufacturés du nord contre matières premières du sud) : » Le sud avait choisi une forme de développement industriel moins intensif en énergie, basé sur l’énergie musculaire et les moulins locaux pour moudre le grain et couper le bois. Le nord était mieux placé pour utiliser l’énergie hydraulique » Si cela s’explique, bien entendu, par la géographie, « les facteurs culturels [sic] étaient aussi importants – notamment la dépendance au travail esclave, la faiblesse locale des marchés de capitaux et l’accent mis sur la plantation auto-suffisante plutôt que sur la manufacture urbaine. » On voit ici que la notion de culture a tout de même bon dos, d’autant que si Nye reconnait que cette différence de régime énergétique recoupe deux économies, deux types dominants d’exploitation ( travail libre/esclavage) elle lui paraît « un rappel éclatant de la centralité de la culture dans la détermination des choix de technologies et de comment elles seront utilisées. » Quoiqu’il en soit la formation d’un marché national avec le réseau d’infrastructures, les spécialisations régionales et surtout la montée en gamme industrielle afférents appelait une accélération que seules la guerre civile et la vapeur allaient pouvoir permettre.
Si il se penche assez peu sur les effets « bénéfiques » en termes techniques et énergétiques de la guerre civile, qu’on imagine éminents comme pour tous les conflits armés modernes, Nye n’en souligne pas moins que celle-ci a « accru le prestige du modèle militaire d’organisation », participé à la formation d’un nouvelle classe de l’encadrement et mis au fin à la pluralité des modes d’exploitation (il en compte 4 en 1800 : l’esclavage, le salariat, la servitude sous contrat et l’apprentissage) au seul bénéfice du travail libre même si, « alors que les hommes gagnaient plus de contrôle sur leur force musculaire, ils se trouvaient défiés par d’autres formes d’énergie. Les travailleurs devinrent des agents libres sur un marché dominé par des léviathans industriels qui avaient accru l’accès au charbon, au gaz et au pétrole. » La seconde partie du livre, « Concentration », porte, assez classiquement, sur cette révolution carbonifère et ses effets. La victoire du charbon et de la vapeur sur l’eau comme sources d’énergie est principalement envisagée sous l’angle de la flexibilité que les premiers offraient, notamment pour la localisation des structures de production et le recrutement de la main d’oeuvre, comme le résume bien une comparaison entre les deux énergies parue en 1849 dans la revue Scientific American ( cité par Nye p. 72) : » Un moulin à eau est nécessairement localisé dans la campagne loin des villes, des marchés et des réserves de travail, dont il dépend… Un homme peut poser sa machine à vapeur où cela lui plait – c’est à dire, là où c’est son intérêt bien compris de l’implanter, au beau milieu des autres industries et du marché, à la fois pour fournir et se fournir auprès de la grande ville. Là où il est sûr de trouver des travailleurs sans avoir perdre du temps à les chercher, où il peut acheter ses matières premières et vendre ses produits, sans se rajouter les coûts d’un double transport. »
Les deux infrastructures emblématiques de ce nouveau régime énergétique ce sont le chemin de fer et le télégraphe. Le premier, particulièrement et précocement développé aux États-unis ( pour partie un legs de la guerre civile d’ailleurs), harmonise le pays en termes de régulation, de rythme, d’organisation du travail et de mode de vie et permet, en acheminant le charbon, le développement de régions jusqu’alors désavantagées du fait de leurs ressources hydriques ainsi que le boom des grandes concentrations urbaines. Le télégraphe remplit en accélérant les flux d’informations la même mission : » Plus le réseau télégraphique s’étendait, plus il unifiait des économies autrefois isolées. Il en résulta une nouvelle économie de marché qui avait moins à faire avec le climat et le sol d’une localité donnée qu’avec les prix et les flux d’informations de l’économie dans son ensemble. » Autre innovation moins centrale, quoique ( et objet de bien des vitupérations radicales semble-t-il), les boîtes de conserve : « L’usage intensif d’énergie pour conserver et expédier la nourriture stimula le développement agricole, réduisit le déchets et diversifia le régime alimentaire national, qui n’était plus dépendant du rythme des saisons et des moissons. Non seulement plus de personnes pouvaient vivre loin de la terre mais elles pouvaient être assurées d’un régime alimentaire varié et régulier. Dans le même temps, la vie dans des immeubles chauffés réduisait le montant d’apport calorifique nécessaire pour garder le corps à la bonne température et la moindre importance du travail physique réduisait également la taille des portions. Après 1900, il y eut un passage rapide vers un le régime plus léger de fruits et de légumes que la mise en boîte de conserve avait permis. »
Tous ces « bonds de géants » supposaient évidemment la naissance de mastodontes industriels qui étaient inséparables de l’intensification énergétique dans bien des secteurs et qui bénéficièrent des nouvelles lois dite d’incorporation ( c’est à dire de constitution en une société unique) votées à l’occasion de la guerre civile. Ces nouvelles corporations bénéficièrent comme le rappelle Nye de l’éclatement du mouvement ouvrier sur des lignes ethniques, religieuses et bien sûr raciales, que la création de l’American Federation of Labor ne compensa que très relativement, après la disparition des Knights of Labor, puisqu’elle n’organisait que les fractions les plus qualifiées de la classe ouvrière. Autre évolution effectivement culturelle cette fois : le développement, en échange du spectre élargie de consommation que permettent les nouvelles énergies, d’un assentiment général dans la société à bien des effets en retour de cette nouvelle ère : accidents spectaculaires et meurtriers, pollution, etc que Nye compare à l’acceptation du tout automobile une ou deux générations ensuite. Acceptation qui se reflétait dans les discours dominants : » Alors que la machine à vapeur était incorporée dans la société, elle entra aussi dans le langage de tous les jours. L’énergie n’avait pas toujours été une catégorie centrale dans la conceptualisation de la société, de la personnalité individuelle ou du travail. » Elle en vint bientôt pourtant à déloger ( en partie) la « force », ses connotations immédiates et animales, de son piédestal séculaire comme idéal, concept général et source inépuisable de métaphores pour la société.
Une autre évolution « culturelle »permet à Nye d’effectuer la transition vers son analyse de l’essor du taylorisme et du fordisme : » Vers 1900, les américains en étaient venus à penser les machines en termes de système. Comme il se doit, l’idée de système semble avoir été introduite par les compagnies de chemin de fer, qui promouvaient non des machines individuelles ou des composants mais le système ferroviaire dans son ensemble. L’idée s’étendit ensuite à de nombreux entreprises des service et d’infrastructures publiques, de façon la plus évidente pour le système téléphonique et celui d’éclairage public mais aussi le système d’évacuation des eaux, les tramways, les trains Pullman, etc. L’adoption massive de la métaphore exprime non seulement une nouvelle interdépendance mais aussi une fierté dans l’ingéniosité et l’efficacité de ces ensembles technologiques. Le plus haut point de l’achèvement personnel ce n’était plus d’inventer un outil utile mais de créer un système efficace dont les bénéfices pourraient se répandre dans toute la société. De ces systèmes aucun n’étaient plus connus et mal compris que l’organisation scientifique du travail de Taylor et la chaîne de production de Ford. »
Ces deux « systèmes » ne sortaient en tout cas pas que de la tête de leurs inventeurs, puisque : « entre 1880 et 1920, alors que la population américaine doublait, sa consommation d’énergie quadrupla. Ce n’était pas simplement un accroissement quantitatif; l’électricité devint disponible commercialement pour la première fois dans les années 1880, et dans les décennies qui suivirent les entreprises trouvèrent des modes d’utilisation de cette énergie qui permirent d’accomplir de remarquables gains de productivité, particulièrement après 1910. De nouvelles formations à la fois de capital et de travail participèrent de cette nouvelle concentration intensive d’énergie. Là où le travail avait été une activité physique contrôlée par le travailleur, la substitution à l’énergie musculaire de l’énergie mécanique en multipliant l’énergie, rendit possible de la monopolisation de son contrôle. Les travailleurs étaient de plus en plus séparés des moyens de production. » Malgré ce constat, l’objet principal du cinquième chapitre du livre, « Industrial Systems », est de dissiper les « mythes » concernant le triomphe, ou du moins l’hégémonie, de l’OST taylorienne et du « fordisme » : « Le modèle de développement historique proposé par les néo-marxistes est pris pour argent comptant dans la plupart de la littérature sur le sujet. Mais quoiqu’ils aient été importants, il n’est pas souhaitable d’utiliser les noms de Taylor et de Ford pour désigner des étapes de développement historique. Gramsci qui inaugura cette pratique, n’avait jamais été aux États-Unis. Contrairement à ce qu’il avançait, l’Amérique n’avait pas, et ne développait pas, un système industriel monolithique qui fonctionnerait selon un ensemble unique de principes. Il y avait au contraire un spectre considérable de pratiques de management et de production que ni Taylor ni Ford ne représentaient. La plupart des entreprises n’adoptèrent jamais l’OST, de nombreuses considérèrent que la ligne d’assemblage ne correspondait pas à leurs besoins et choisirent d’autres systèmes de production. (..) L’industrie américaine n’était pas monolithique ni en termes de mode d’organisation capitalistique ni en termes d’organisation du travail, et elle n’est pas passée collectivement par une étape appelée fordisme. »
Nye a probablement trop le nez dans le guidon des spécificités des modes d’organisation de l’exploitation pour admettre l’utilité de la notion de fordisme ( certes à relativiser après certains « excès » régulationistes ou marxistes) . Il n’en rappelle pas néanmoins quelques vérités importantes. Il cite ainsi l’étude de Hugh Aitken sur les travailleurs de l’arsenal de Watertown qui démontrait que l’introduction de l’OST avait échoué devant la résistance, l’habileté tactique des travailleurs, et le simple constat de son inefficience dans un cadre donné. De même, il mentionne l’interdiction, suite à une commission d’enquête dépêchée pour répondre aux nombreux conflits ouvriers contre l’introduction de la méthode Taylor, pendant trente ans de la même OST dans toutes les entreprises sous contrôle de l’État fédéral. Plus généralement « Au niveau de l’atelier, le taylorisme s’avéra souvent moins important que la myriade de changements amenés par l’électrification qui aidèrent les entreprises américaines à doubler leur productivité entre 1900 et 1930. » Or justement » Taylor travaillait essentiellement dans le cadre conceptuel de l’âge de la vapeur et considérait les machines comme des extensions du pouvoir musculaire humain. Ford au contraire était un homme de cette ère électrique où « les machines commencèrent à réaliser ce qu’aucuns hommes quel que soit leur nombre ne pouvaient réaliser, devenant non seulement des extensions des muscles les plus fins, mais de l’oeil, de l’oreille et même du cerveau lui-même » (Wyn Wachhorst). Mais là encore » la ligne d’assemblage n’était pas le seul système de production moderne, elle n’était pas nécessairement la méthode la plus efficiente pour chaque usine, ni ne représentait toujours le système le plus profitable et elle n’a même pas éradiqué le « putting-out system« . Les entreprises détenues « à titre personnel » comme celle de Henry Ford n’était pas inéluctables pas plus que ne l’étaient les méthodes de production de Ford. De fait la compagnie Ford est passée par deux périodes bien distinctes : une phase « welfare » qui dura moins d’une décennie et une période d’intimidation et de confrontation. »
A défaut donc d’être hégémonique dans l’industrie, le taylorisme n’en fut pas moins sollicité dans de nombreux domaines de la vie sociale. Nye rappelle en effet que les premières théoriciennes et théoriciens de « l’économie domestique » voulaient appliquer, en les couplant à l’électrification de tout, ces méthodes à la gestion du foyer, notamment en réorganisant les cuisines selon les principes des études d’optimisation des temps et mouvements. Mais cette restructuration et la vaste gamme de nouveaux équipements ne tinrent pas leurs promesses puisque toutes les études menées dans les années 50 démontraient que le temps de travail domestique n’avait pas diminué, au contraire : » Quoique la rhétorique provenait de Taylor, sa réalité ce n’était pas l’efficience industrielle mais un travail plus intensif. La cuisine émergea comme l’homologue domestique d’un atelier d’usinage animé par un travailleur unique. La nouvelle domesticité accordait une grande valeur à la production de mets luxueux et à la propreté immaculée des sols. Elle transformait le travail non-payé des femmes en une sorte de performance publicitaire. »
La troisième et dernière partie du livre, intitulé « Dispersion », se penche tout d’abord sur les effets de l’essor de la consommation de masse et plus particulièrement l’automobile et ses conséquences, notamment le développement de la « suburbia ». Nye refuse toutefois d’établir un simple rapport de cause à effet : » Il ne faut pas confondre dynamisme technologique et déterminisme. Les automobiles ne sont pas des objets isolés; elles ne constituent que la partie la plus saillante d’un système complexe de consommation d’énergie qui inclut des lignes de production, des routes, des parkings, des puits de pétrole, des pipelines, des stations services et la restructuration des espaces urbains pour s’adapter aux besoins des conducteurs. Entre 1910 et 1930, des systèmes alternatifs à l’habitat suburbain existaient et dans la plus grande partie de l’Europe des villes bien plus densément peuplées que les villes américaines bénéficiaient d’un système de transport public. Les voitures n’étaient pas en soi un facteur de transformation, elles donnèrent simplement aux américains un nouveau médium puissant pour exprimer des préférences culturelles pré-existantes. » Les effets en retour étaient pourtant aisément discernables : » Ces nouvelles possessions à la fois incarnaient et utilisaient l’énergie. L’idéal de l' »American way of life » en 1925 incluait une voiture familiale, une maison dans les « suburbs » avec une large spectre d’appareils, un téléphone, un phonographe, une radio et du temps libre pour s’adonner à des loisirs à haute teneur énergétique à l’extérieur de la maison. Le succès et le bonheur supposaient implicitement le contrôle de très grandes quantités d’énergie, et les quantités demandées augmentaient chaque année. La lumière électrique, le téléphone et l’automobile- des articles de luxe réservés aux riches en 1890- étaient devenus indispensables à tous en 1930. » Nye décrit longuement les différentes facette de cette société à très haute intensité énergétique et ses utopies : » Le régime à haute intensité énergétique concernait tous les aspects de la vie. Il promettait un future fait de textiles miracles, de nourriture peu onéreuse, de plus grandes maisons suburbaines, de voyages plus rapides, d’essence moins chère, de contrôle du climat et de croissance sans limites. «
L’arrivée de la crise énergétique dans les années 70 n’en fut que plus « brutale » et l’affolement comme le déni, encore plus important. La description que donne Nye n’est pas sans rappeler la situation actuelle: « Le discours politique américain affichait un style paranoïaque qui rappelait les sermons du XVIIe siècle. On trouvait autant des avertissements apocalyptiques sur la fin du monde une fois que les ressources énergétiques seraient épuisées, des jérémiades sur le viol des ressources et la consommation excessive, des dénonciations de complot internationaux dirigés contre les USA et des refus d’admettre la réalité de la crise. » C’est ce dernier point de vue incarné par Reagan, dont la « contre-révolution » dans ce domaine, tant les propos que les actes, a connu une réplique avec Trump, qui prit finalement le dessus : » L’élection de Reagan était en partie une déclaration publique de foi dans l’ordre ancien, dans lequel la forte consommation d’énergie allait de pair avec les rêves de réussite personnelle, et le progrès se mesurait à des centres commerciaux toujours plus gigantesques, des maisons toujours plus chers et équipées, des grandes voitures, etc. Et donc dans les années 80, la plupart des américains continuèrent à consommer comme si la crise n’avait jamais eu lieue. Les fours à micro-ondes et l’air conditionné devinrent la norme. » Et pourtant, le nouveau régime énergétique et productif qui émergeait dans cette dernière partie du XXe siècle, « le régime énergétique électronique » étaient déjà en train de miner « la structure de classe » et les rapports de production et distribution de la phase précédente, ouvrant la voie à la précarisation à outrance et le maintien de la consommation par l’endettement.
Nye revient enfin dans sa conclusion sur cette dépendance, désormais inscrite dans l’espace, » les américains ont construit leur dépendance à l’énergie via leur zonage et leur architecture. », et qui semble si profondément intégrée qu’on ne voit pas très bien comment pourra s’imposer un changement de cap : » A la fin du XXe siècle, la consommation d’énergie est devenue à la fois une question technique, un dilemme écologique, une enjeu politique et un problème personnel de la plus haute importance. » Si Consuming Power offre donc un utile panorama historique et même si on est pas obligé d’être convaincu par son torticolis « culturel » celui-ci a toutefois le mérite de souligner les profonds ressorts de la question dans la société américaine. Et l’énergie, qu’il associe principalement au culte, pour lui très américain, de l’autonomie individuelle ( mais qu’en était-il effectivement hier et d’autant plus aujourd’hui ?), pourrait ainsi permettre de mieux analyser symboliquement certes mais concrètement aussi, certaines recompositions sociales et politiques « transitoires » tel ce plouto-populisme dopé au backlash patriarcal et racial qu’a réussi à incarner Trump. Comme cela a été noté lors de son élection, aux États-Unis la pollution au carbone suit des lignes partisanes (et inversement) puisque les États républicains produisent plus de carbone et leur habitants consomment plus d’énergie. De là, on peut bien évidemment crier au carbo-fascisme, ou appeler à l’union sacrée entre anti-fascistes et écologistes ( comme le promeut l’inépuisable Malm !) qu’on ignorait fâchés ( un conflit de livrée ou de bonnes intentions ? ) mais il semblerait que l’énergie comme rapport social appelle une critique certes plus subtile et certainement plus radicale.