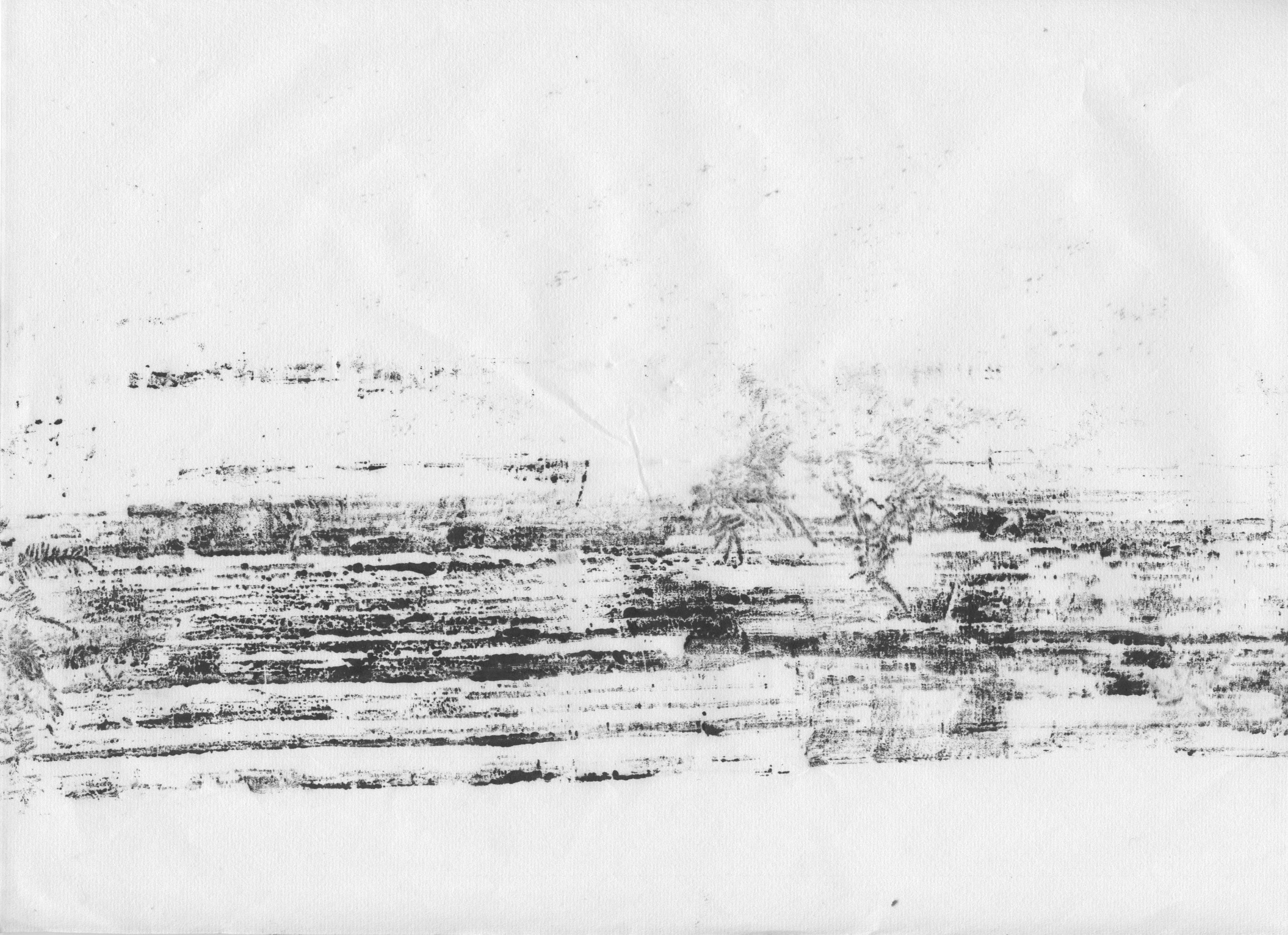Si malgré sa « dialectique » parfois tortueuse, le livre de Jason W. Moore fait l’objet au bout du compte de résumés plutôt succincts ( le meilleur exemple étant donné par la recension de Sara Nelson dans la revue Antipode), il est regrettable que presque aucun lecteur n’ait souligné l’absence légèrement surprenante de tout travail éditorial sur le texte, si ce n’est paradoxalement le « recenseur » le plus hagiographique de Mr Moore, Christopher Cox dans sa note de lecture pour le site de la revue Historical Materialism :
« C’est une des critiques majeures que l’on peut faire au livre, s’il en est, il y a trop à ingérer pour un seul lecteur. Moore a arraché un trop gros os à ronger (« one serious chunk to gnaw on »). Beaucoup de concepts dans ce livre méritent d’être lus et relus. (…) Certains pourraient suggérer que c’est une faiblesse du travail de Moore – que le lecteur doit déployer beaucoup d’énergie intellectuelle pour pouvoir s’en saisir réellement- mais j’avancerai que demander de la simplicité méthodologique quand il s’agit de se confronter à des questions qui sont peut-être les plus complexes que l’humanité ait jamais affronté semble au mieux naïf. Nous sommes dans un moment historique pénible, désastreux écologiquement, globalement et réciproquement impliqué et cela appelle des réseaux de connaissance qui transcendent toutes les limitations des cadres d’analyse du colonialisme occidental, du patriarcat à l’identité individuelle. Bref, même si ce n’est pas l’approche la plus populaire aujourd’hui, nous devons apprendre a penser à travers et malgré les systèmes. Une approche dialectique est, à mon avis, la plus adaptée et cela souligne d’autant l’importance de la contribution de Moore. »
Le critique le plus sévère, à ce jour, du livre, Alf Hornborg dans son article pour le blog de la même revue, « Dialectical Confusion: On Jason Moore’s Posthumanist Marxism », a tout de même beau jeu de souligner que les incohérences de ce genre de pirouette « dialectique » :
» Dans une recension de 50 pages sur le site de Historical Materialism, Christopher Cox fait le panégyrique de l’effort de Jason Moore pour « ressusciter la dialectique » en reformulant » le capitalisme historique comme un régime permanent de production de l’environnement ». Quoiqu’il concède que Le capitalisme dans la toile de la vie serait difficile à « absorber » pour l’étudiant américain moyen, Cox défend les réflexions verbeuses de Moore en avançant que « penser dialectiquement suppose d’accepter de ne pas savoir ». Cela semble effectivement la principale excuse de Cox pour promouvoir candidement un traité si conceptuellement confus que Cox admet lui-même être incapable de le digérer, rempli qu’il est de concepts ( Oikeios, Faisceaux et Travail-énergie) qui sont, selon les propres mots de Cox » insuffisamment précisés ». Il ne semble pas venir à l’esprit de Cox que les difficultés qu’il a rencontré pour comprendre le livre de Moore reflète dans une large mesure la confusion analytique de l’auteur. »
Cox souligne toutefois à juste titre un des grands intérêts du livre pas nécessairement saisissable au premier abord qui est l’intégration finalement relativement centrale des théories féministes dans la synthèse que propose Moore :
» Les implications de cette « théorie de la valeur historiquement fondée » sont vastes. Nous savons depuis Marx que le capitalisme dépend de la constante reproduction du capital, qu’il envisageait comme « valeur en mouvement » mais ça ne s’arrête pas là. A condition de lire très profondément Marx – j’entends ici Marx et pas le marxisme- on s’en aperçoit mais dans ce livre [ Le capitalisme dans la toile de la vie] il devient clair comme le jour que la société capitaliste ne valorise que « la force de travail dans le circuit du capital ». Ce n’est pas une surprise mais ce que cela signifie pour la dialectique de l’histoire est considérable. Moore le présente ainsi : « Un très grande quantité de travail – la majeure partie du travail qui s’opère dans l’orbite du capitalisme- n’est pas considérée comme ayant de la valeur. Le travail par les humains, particulièrement les femmes mais aussi « le travail » des natures extra-humaines » Quand la composition de la valeur dans le temps et l’espace est envisagée au prisme du travail-énergie non rémunéré ou au moins sous-évalué ( socio-économiquement) des humains et du reste de la nature, nous commençons à percevoir deux moments importants : tout d’abord l’aptitude du capital à organiser toute la nature ( humaine et non humaine) au service de sa propre accumulation. Ensuite, l’ontologie féministe implicite du projet de l’écologie-monde, tel qu’envisagé par Moore. Cela débute part la présupposition que le travail « socialement nécessaire » de reproduction du travailleur ( un aspect largement ignoré des écrits de Marx et Engels ) est en général non rémunéré et sous-évalué, tout cela découlant directement de l’éco-féminisme, de même que des études féministes sur la science et la technologie et des théories du « standpoint ». »
Sara Nelson dans sa recension d’Antipode fait le même constat :
» Moore n’est pas le seul à faire le lien entre les critiques Marxistes-féministes et écologistes du capitalisme, mais ses efforts pour intégrer ces compréhensions de la reproduction socio-écologique dans une théorie historique de la crise capitaliste constitue une contribution considérable dans tous les domaines de l’économie politique et du rapport nature-société. Son approche offre également une puissante réponse aux appels naissants à porter une plus grande attention à la valeur dans les critiques de la nature néo-libérale ( Dempsey J and Robertson M M (2012) Ecosystem services: Tensions, impurities, and points of engagement within neoliberalism. Progress in Human Geography ) suggérant qu’une analyse de la valeur implique un examen élargie de comment les nouvelles formes de connaissance et de discours environnementaux travaillent de concert avec les innovations politiques, non seulement pour étendre la sphère de la marchandisation mais aussi pour rendre appropriables de nouvelles natures. »
Ce point est également développé dans la recension du livre par Ben Debney, Historical Nature versus Nature in General: Capitalism in the Web of Life, parue dans la revue Capitalism Nature Socialism : » La force de cette approche de Moore est immédiatement évidente : en établissant un parallèle entre le travail non payé des femmes et la travail non payé de la nature (…) le concept de nature bon marché de Moore unifie les critiques historiques du capitalisme – englobant des siècles d’accumulation primitive telle que celle-ci s’est manifestée dans le mouvement des enclosures, l’exploitation et l’appropriation des matières premières et des esclaves aux Amériques, en Asie et en Afrique et l’imposition du patriarcat via cette opération d’ingniérie sociale que furent les chasses aux sorcières- avec les critiques éco-féministes de l’intersectionnalité des appropriations, aidant ainsi à lier les deux dans une critique élargie de l’empire du capital. Le commentaire de Moore sur la signification de l’appropriation capitaliste du travail non payé, en plus de démontrer les insuffisances de la fixation operaïste sur la seule théorie de la valeur travail comme unique moyen d’exploitation et de profit, constitue un seuil entièrement nouveau de la théorie, apte à saisir les fonctions respectives du travail payé et non payé dans la reproduction sociale du capital. »
Sara Nelson souligne toutefois plusieurs absences « fâcheuses » dans les références que sollicite Moore, notamment celle de plusieurs penseurs marxistes de la question écologique :
» Malgré la grande proximité de l’approche de Moore avec la recherche critique dans la géographie du rapport nature-société ( un terme que Moore rejette pour son évidente invocation du pernicieux « rapport binaire cartésien »), beaucoup de la littérature géographique avec laquelle son travail résonne reste remarquablement absente du livre. Moore fait grand cas de la notion de sous-production chez Marx – se référant à la pénurie en matières premières due à l’incapacité du capital à investir dans leur reproduction- qui selon lui serait restée sous-théorisée en « conséquence des habitudes dualistes de pensée » et ce, sans mentionner le travail déterminant sur le sujet de James O’ Connor ( dans son article « Capitalism, Nature, Socialism : A Theoretical Introduction » 1988). Cette absence est surprenante compte tenu de la proximité de l’analyse que donne O’Connor de la « seconde contradiction » avec la propre argumentation de Moore ( et ce d’autant plus qu’il cite d’autres travaux de O’Connor ailleurs dans le texte). De même l’analyse que donne Moore du capitalisme comme projet historique, dans lequel la production de la nature comme « extérieure » est essentielle pour rendre les natures appropriables à moindre coût, ne se confronte jamais avec celle, fondatrice, de Neil Smith sur le sujet. Moore critique implicitement Smith pour son analyse de la production de la nature comme processus unilatéral, soulignant au contraire la « co-production » au coeur des écologies capitalistes. Plutôt que de se confronter directement à ces théoriciens, Moore transforme sa critique du dualisme cartésien en excuse général pour écarter la majorité de la recherche sur le rapport nature-société, réinventant dans la foulée ,en quelque sorte, la roue de la critique éco-marxiste . Il en résulte une opportunité perdue pour le renforcement des fondations théoriques de l’écologie-monde. »
Autre absent de marque, toujours selon Sara Nelson, Spinoza :
« Le projet de Moore est caractérisé avant tout par la volonté de traquer et d’extirper ce dualisme nature-société dans la pensée écologiste. Mais le même anti-cartésianisme véhément qui donne sa force motrice au livre illustre aussi ses plus flagrantes omissions. La plus saillante c’est celle de l’anti-cartésien le plus fondamental de tous, Baruch Spinoza. Tandis que le dualisme de Descartes conçoit l’âme et le corps comme deux substances ontologiquement distinctes, la philosophie moniste de Spinoza suppose une substance singulière de laquelle la pensée et la matière sont des attributs. Le dieu de Spinoza, contrairement au dieu de Descartes, n’est pas un créateur transcendent mais plutôt cette substance immanente même dans ses innombrables expressions; d’où la fameuse formule de Spinoza « dieu ou la nature » par laquelle il signifie » Dieu, c’est à dire la nature », identifiant dieu comme la concaténation- ou l’inter-relation immanente- entre toutes choses. (…) Il est difficile de lire la description que donne Moore de la nature comme « un flux de flux » sans se demander si Spinoza n’a pas déjà fourni à d’innombrables générations de chercheurs cette ontologie moniste et relationnelle que Moore invoque et qui constitue un principe fondateur de sa pensée. »
Les apories de la critique supposément paradigmatique qu’opère Moore du dualisme nature-société ont d’ailleurs été soulignées dans de nombreuses recensions, ici encore par Sara Nelson :
« Moore est vulnérable à sa propre critique puisqu’il est loin d’être évident que son vocabulaire de « faisceaux de natures humaines et extra-humaines » ou de « l’humanité dans la nature et la nature dans l’humanité » présente une alternative suffisamment non dualiste. Moore met en garde contre une « dualisme soft » qui représente la dialectique entre natures humaines et extra-humaines comme une alternative au binôme nature-société » mais on pourrait pardonner au lecteur de se demander comme sa « double intériorité » – décrivant « l’internalisation de la vie et des processus planétaires » ne présente justement pas les caractéristiques de ce dualisme « soft ». (….) Dans sa foi que l’usage du vocabulaire juste et de la méthode historique va nous libérer finalement » de la prison du binôme cartésien » Moore reproduit ironiquement ce binôme même ( c’est à dire la séparation originelle entre pensée et corps) dans la mesure où il reprend l’idée que le développement intellectuel procède à part de la réalité vécue et agit sur elle comme une force extérieure. «
On trouve une autre critique sur ce thème dans la recension signée par le groupe Out of the Woods dans le journal The new Inquiry :
» Quand Moore cherche à historiciser l’organisation de la nature par le capital à travers une analyse des régimes énergétiques et des révolutions agricoles successifs , il passe à côté de l’opportunité d’historiciser ce dualisme nature-société lui -même, et donc de comprendre à la fois sa persistance et son brin de vérité : la nature apparaît réellement au capital comme une « Frontière » à conquérir, des ressources et de la force de travail à exploiter, un évier dans lequel déverser la pollution, etc même si dans les faits le capital est une façon d’organiser la nature et non une force extérieur qui l’affronte. C’est à dire que le dualisme nature-société reflète la modernité capitaliste telle qu’elle apparaît réellement: une idéologie de la nature. »
Alf Hornborg dans son « étrillage » de la recension de Moore par Cox revient également sur ce point :
« Bien que Cox ait été charmé par les efforts de Moore pour penser de façon « holiste » l' »écologie-monde », il ne semble pas s’apercevoir du défaut philosophique fondamental au coeur du Capitalisme dans la toile de la vie. Ce défaut c’est l’incapacité à distinguer entre le dualisme ontologique ( « cartésien ») d’un côté et la distinction analytique binaire de l’autre. La première conçoit la nature et la société comme isolés l’un de l’autre dans le monde réel, matériel, la seconde uniquement comme deux aspects analytiques distincts du phénomène matériel. Dénier que des caractéristiques de la nature et de la société – par exemple l’entropie et la valeur monétaire- doivent être considérés distincts analytiquement est aussi intenable que de dénier qu’ils sont connectés dans la réalité matérielle. Mais Moore semble penser que les mots mêmes de « nature » et de « société » constituent des anathèmes -sauf quand il se laisse aller à les utiliser lui-même, comme quand il écrit que dans le capitalisme précoce « pour la première fois les forces de la nature furent déployées pour faire avancer la productivité du travail humain. » Dans de tels moments, il illustre -en contradiction avec son argumentaire- que la distinction conceptuelle entre « nature » et « société » est indispensable à toute analyse du processus historique. »
De même, du même, un peu plus loin, en en rajoutant dans le marxisme analytique et en couronnant le tout avec la suprême accusation d’usage :
« De dire que quelque chose est bon marché cela signifie rester confiné au cadre conceptuel même des capitalistes, celui de l’évaluation monétaire. Le matérialisme historique requiert une perspective plus détachée, comme dans l’intuition marxienne fondamentale selon laquelle les prix monétaires servent de voile qui mystifie les transferts matériels objectivement asymétriques en produisant une illusion de réciprocité fictive. Nous devrions consacrer notre attention à ces transferts asymétriques et aux moyens idéologiques par lesquels ils sont représentés comme équitables et réciproques. (…) Flouter les séparations analytiques entre nature et société revient finalement à suggérer que, comme les empires qui l’ont précédé, le capitalisme n’est pas moins « naturel » qu’un « barrage de castor ». Et naturaliser l’injustice c’est le signe distinctif de l’idéologie. «
Mieux vaut toutefois conclure sur cette importante question du dualisme » nature-société » avec ces deux réflexions pertinentes de Sara Nelson :
« Tandis que Moore prétend que les notions traditionnelles de limites environnementales absolues sous-estiment l’adaptabilité du capitalisme, son propre traitement du dualisme Nature/Société risque de répéter cette erreur en ne parvenant pas à se saisir des processus intersectionnels par lesquels ces catégories sont elles-mêmes transformées quand la ligne séparant production et reproduction ( et de ce fait capitalisation et appropriation) est retravaillée à travers l’histoire du capitalisme. »
« En traitant le binôme Nature/Société comme une constante trans-historique, Moore ne problématise pas la question du travail, laissant de côté le changement historique qualitatif dans les manières dont les virtualités socio-écologiques sont à la fois exploitées et appropriées. Tandis que les théoriciens autonomes ont souligné les temporalités irrégulières de l’exploitation dans le capitalisme contemporain, le capitalisme chez Moore reste bloqué à l’époque de l’usine, dans laquelle la production de l’équivalence dans le domaine de l’échange est combinée avec la production de l’homogénéité dans le temps et l’espace ( Moore suggère que la nature ne se rebelle pas contre l’exploitation en tant que telle mais « parce que personne, aucune forme vivante, ne veut faire la même chose, toute la journée, tous les jours »). La critique idéologique du binôme Nature/Société empêche de poser la question plus radicale du comment cette opposition a évolué dans le temps comme objet de lutte et comment elle est qualitativement transformée dans la conjoncture contemporaine. »
Tout à l’implication réciproque entre nature et société, Moore semble croire que celle-ci subsume, résume et résout tout, au point qu’on se demande quelle place exacte il laisse à l’activité humaine. Cet « angle mort du possible » dans Le capitalisme dans la toile de la vie a été souligné de façons différentes dans diverses recensions, notamment celle de Wack McEnzie « The capitalocene. On Jason Moore« , qui lui reproche de ne « penser que du point de vue » du capital ». Kate Sopper dans son article « Capitalocene » pour la revue Radical Philosophy va dans le même sens :
« La question centrale à laquelle Moore revient continuellement sans donner de réponse claire, est de savoir si la crise de notre temps est une crise d’époque ou une crise de développement, si, contrairement à ce qu’on pourrait penser, de nouvelles sources d’accumulation vont être localisées ou si la combinaison d’épuisement physique, de changement climatique, de tarissement des opportunités d’investissement et de nouveaux mouvements anti-systémiques indique un déclin définitif.
Il y a des moments où le dualisme sert à préserver des distinctions importantes pour le matérialisme historique. Par exemple la référence aux « rapports sociaux » dans la pensée rouge et verte ne vise pas à dénier le rôle de la nature dans l’activité humaine, mais à préserver la distinction entre le processus de travail au sein du capitalisme et sa forme purement matérielle ( qui, comme combinaison de travail, d’outils et de ressources peut être menée sous différents types de rapports sociaux). La tendance de Moore à considérer toutes les discriminations entre les intrants naturels et sociaux comme corrompant la compréhension historico-dialectique risque parfois de mélanger des généralités communes à toutes les époques et les modes de production avec des aspects particuliers au capitalisme.
Donc tandis que Moore spécule fréquemment dans une veine optimiste sur la possibilité imminente de la fin du capitalisme, il a par contre peu à dire sur la forme qui pourrait lui succéder. Si cela est du à un manque de vision culturelle, alors cela correspond bien à son attaque contre les autres penseurs écologiques qui auraient négligé le culturel et le symbolique et radicalement sous-estimé le rôle des idées dans le changement historique. Si d’un autre côté cela reflète la réticence à se confronter aux réalités du soutien ( de même qu’à la désaffection) populaire au marché et la culture consumériste, cela consiste donc à échapper précisément aux complexités de notre temps que le marxisme doit plus que jamais affronter. Ce serait extrêmement dommage qu’une argumentation innovante sur l’écologie se développant dans le cadre du matérialisme historique et dont ce livre et l’écologie-monde plus généralement sont d’excellents exemples, s’avèrerait incapable d’étendre ses perspectives jusqu’à la reconnaissance du capitalisme comme forme économique dépassée afin de mener une attaque tout aussi éclairante et dénaturalisante de la conception anachronique de la prospérité humaine et du bien être du capitalisme. »
Dan Boscov-Ellen dans sa recension parue dans le Graduate Faculty Philosophy Journal souligne de même les risques d’un trop grand optimisme concernant l’enchainement entre crise et émancipation : » Si le capitalisme est sur la voie du déclin terminal, il n’est toutefois pas sûr que l’apparent optimisme de Moore concernant ce qui lui succédera soit justifié. Moore dit peu de chose des mécanismes qui peuvent mener de la crise à l’action politique révolutionnaire. Il suggère à un moment que les « contradictions actuelles génèrent non seulement un mouvement vers une forme plus oppressive, violente et toxique de capitalisme mais aussi de puissants contre-mouvements. » Néanmoins les crises systémiques ne génèrent pas seulement une action politique anti-capitaliste; particulièrement dans une situations où il n’y pas de gauche organisée et influente, elles peuvent également produire tout aussi aisément une tendance au fascisme et à la xénophobie ou fournir le prétexte à de nouvelles expropriations. Dans le moment politique actuel, la crise écologique semble de fait être tout autant en mesure d’approfondir les divisions entre les groupes exploités et oppressés que d’encourager la solidarité dans la résistance à un réseau global et diffus de pollution et de pillage masqué par des instruments idéologiques hautement sophistiqués et renforcé par de puissantes et brutales forces policières et militaires. »
On retrouve ce point également dans la recension Juliana Sphar, « Beyond Red and Green », parue dans la revue Mediations :
» Moore est confiant dans le fait que la fin de la nourriture bon marché signifie que la crise ne pourra être ajournée. Car la nourriture bon marché est si importante que quand elle s’écroule elle emmène tout sur son passage. Puis il suggère que « la fin de la nourriture bon marché pourrait bien s’avérer être celle de la modernité et le début de quelque chose de mieux ». Oui, peut-être, peut-être non. Il n’y a aucune raison d’être sûr du « quelque chose de mieux ». Savoir ce qui succédera au capitalisme constitue bien sûr une vaste question ouverte et constamment débattue. Ces débats voient souvent s’opposer deux lignes l’une utopique, l’autre « dystopique ». Beaucoup ont théorisé -et même un certain nombre d’anti-capitalistes fervents- la possibilité d’un dépérissement massif. Moore est plus utopique. Il prétend que la politique de la nourriture offre un aperçu du futur. Quand il en arrive là dans les quatre dernières pages du dernier chapitre, il cite l’article de Rebecca Solnit dans The Nation « The Revolution Has Already Occured ». C’est un article dans lequel Solnit prétend que les jardins communautaires sont une sorte de révolution. Cet article est flou [« muddy »]. (..) Pas seulement flou mais aussi délirant dans sa recherche d’espoirs apaisants au point de proclamer qu’une révolte pourrait partir du jardinage communautaire occasionnel dans les pays riches. C’est presque choquant de voir cet article cité aussi longuement à la fin du livre de Moore car on avait l’impression qu’il luttait depuis le début de l’ouvrage contre ce type d’analyse. »
Si cette issue nous a également paru être une sorte de cheveu sur la soupe, Mr Moore nous a toutefois indiqué par mail qu’il ne soutient bien évidemment pas les formes « gentrifiantes » de jardinage partagé mais le mouvement, visiblement en plein essor, impliquant les communautés noires dans plusieurs villes des États-Unis…