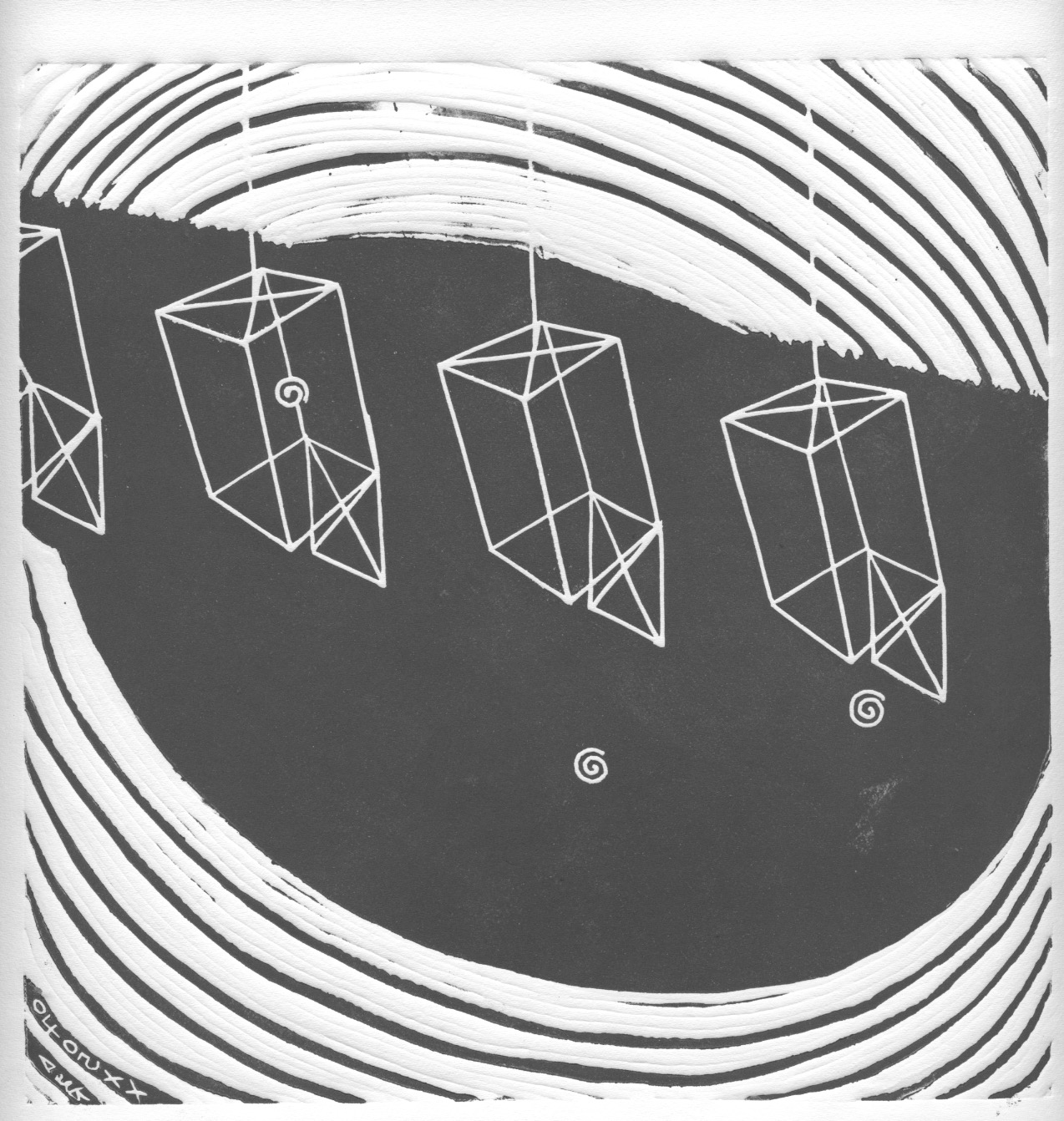Si elle continue, à l’image de sa cousine porcine, son « bonhomme de chemin », encore récemment un peu partout en Inde , en Europe et ces jours derniers en Afrique, la grippe aviaire n’a pourtant pas encore tenu toutes ses « promesses pandémiques » telles que résumées, entre des milliers d’autres, par un article (de 2006) de l’Institut National de Recherche et de Santé : « Jamais le monde n’a été aussi proche d’une nouvelle pandémie grippale puisque toutes les conditions préalables sont réunies, sauf une : l’établissement d’une transmission interhumaine efficace ». En l’occurrence l’apparition de nouveaux variants plus transmissibles, ainsi récemment chez les porcs et leur transmission effective quoiqu’encore occasionnelle des volailles aux humains, comme en avril en Chine, ou la fuite en avant dans l’industrialisation de la production, qui se fait en Asie au détriment de basses-cours présentées comme havres de toutes les infections ( pour une synthèse critique sur ce point : voir notamment Natalie Porter, « Risky Zoographies: The Limits of Place in Avian Flu Management« ), et son encadrement « sanitaire » ( vaccinations, antibiotiques, etc) laissent présager de nouveaux développements prometteurs…
Pronostic qui ne sort pas de l’ordinaire puisque depuis quelques décennies déjà, pour ce qui est des pandémies, dans le discours public, la question n’est plus « si » mais « quand » et « où ». Ainsi on pourrait dire du Covid-19, qu’il est probablement le fléau le mieux annoncé de l’histoire d’une espèce qui n’a pourtant eu de cesse que de prédire Apocalypse, Armageddon et autres « Fin des temps ». C’est qu’illustre par exemple le vaste ensemble d’ouvrages prophétiques écrits à ce sujet ces dernières années, et ce pour tous les goûts, que ce soit sur le mode du récit de « virologue baroudeur » comme The Viral Storm. The Dawn of a New Pandemic Age de Nathan Wolfe ou Spillover. Animal Infections and the Next Human Pandemic de David Quammen; de l’avertissement d’épidémiologistes sur le pied de guerre comme Deadliest Ennemy. Our War Against Killer Germs de Michael Osterholm et Mark Olshaker ou Pandemic. Tracking Contagions From Cholera to Ebola and Beyond de Sonia Shah ; ou d’ouvrages moins « sensationnalistes » et souvent plus instructifs que ce soit sur les tendances de long terme ( An Unnatural History of Emerging Infections de Ron Barrett et George J. Armelagos sur lequel on reviendra dans un post sur la « troisième transition épidémiologique ») ou sur le jour le jour de la veille pandémique ( Les sentinelles de pandémies de Frédéric Keck).
Si la toute fin du XXe, et les débuts de la grippe aviaire et l’orée du XXIe siècle, avec l’épidémie de SRAS, ont certes fourni un terreau suffisant au développement des inquiétudes « biosécuritaires », celles-ci remontent toutefois à un peu plus loin. On pourrait grossièrement distinguer plusieurs phases dans l’histoire de la perception des risques liés aux maladies infectieuses en Occident depuis 1945 avec une première période où dominent encore les peurs d’attaques bactériologiques associées à la guerre froide à laquelle succède une longue phase d’un optimisme amplement justifié, la prévalence de maladies infectieuses telles que le paludisme, la tuberculose, la diphtérie, la poliomyélite ou la rougeole, etc, s’écroulant littéralement dans le monde développé, et l’éradication globale de la variole étant célébrée en 1980. Un optimisme qui ira dans les déclarations (réelles ou attribuées) de plus d’une autorité médicale jusqu’au pronostic de la fin imminente « des maladies infectieuses » mais qui commencera sérieusement à être mis en doute avec l’émergence progressive du SIDA et ce, jusqu’à ce que le tournant des années 2000 ses nouvelles épizooties, zoonoses et « menaces terroristes » vienne parachever la naissance d’un nouveau paradigme.
On pourrait paradoxalement noter qu’avant même l’apparition au grand jour du SIDA ( dont on sait désormais que l’histoire remonte à « beaucoup » plus loin, voir, parmi de nombreux autres textes, Stephanie Rupp et alii « Beyond the Cut Hunter: A Historical Epidemiology of HIV Beginnings in Central Africa« ) la fin des illusions « éradicatrices », ou plutôt une nouvelle dialectique entre « éradication » et prolifération, s’est, d’une certaine manière, manifestée dès la seconde partie des années 70, via la réaction précipitée à l’apparition de la grippe porcine en 1976 et la campagne de vaccination en masse pour le moins hasardeuse menée aux États-Unis ( qui provoqua des milliers de cas du syndrome de Guillain-Barré) – qui n’est pas sans évoquer la « sur-réaction » qu’on a reproché à l’OMS face à une grippe du même type en 2009, voir plus loin- puis la « grippe russe » de 1977 dont il est désormais admis qu’elle a été le produit d’une fuite de labo, ou d’un essai de vaccination ayant mal tourné, en Sibérie ( voir notamment Michelle Rozo et Gigi Kwik Gronvall, « The Reemergent 1977 H1N1 Strain and the Gain-of-Function Debate« , qui offre une bonne synthèse des hypothèses existantes tout en essayant assez absurdement de dédouaner certaines recherches actuelles « en gain de fonction »).
Martin Furmanski dans son article « Laboratory Escapes and “Self-fulfilling prophecy” Epidemics » et Shanta M. Zimmer et Donald Burke dans « Historical perspective–Emergence of influenza A (H1N1) viruses » n’hésitent d’ailleurs pas à rapprocher directement les deux événements, la fuite de 1977 représentant un malheureux contre-coup de l’affolement de 1976 : « L’histoire du virus de l’influenza H1N1 est ponctuée par de fréquentes et sporadiques transmissions entre espèces notamment entre les porcs et les humains. Bien que les virus porcins transmis sporadiquement aux humains soient suffisamment pathogènes pour causer des maladies, ils se transmettent ensuite rarement entre humains. L’exposition et l’infection sont nécessaires mais pas suffisants pour qu’un nouveau virus épidémique émerge ; le virus doit aussi s’adapter et se transmettre. La seule grande exception à cette loi générale que les virus porcins ne se transmettent pas entre humains fut la contamination à Fort Dix [en 1976]. La virus ne s’est jamais répandu en dehors de l’installation militaire, car sa contagiosité intrinsèque était tout simplement trop faible. Pourtant la réponse globale à cet événement fut percutante, surtout compte tenu du fait que l’épidémie s’est auto-limitée. La décision de vacciner en masse la population américaine résulta en un nombre regrettable de cas de syndrome de Guillain-Barré. Une des conséquences encore plus sérieuse fut la dissémination accidentelle d’une variante adaptée à l’homme du H1N1 depuis un laboratoire [russe], menant à la résurrection et la diffusion globale de ce virus autrefois éteint, aboutissant à ce qu’on peut considérer comme une « prophétie épidémiologique auto-réalisatrice ». » ( Zimmer et Burke, P. 284). Expression qui n’a, semble-t-il, rien perdu de sa pertinence !
Malgré le cafouillage de 1976 et ses retombées ultérieures, les avertissements, toujours d’actualité, d’un René Dubos, la multiplication des zoonoses mises à jour dans les dernières décennies du XXe siècle ( citons parmi les « moins » connues – extraites de la liste donnée par David Quammen dans Spillover : Virus Machupo (1959), Marburg (1967), Fièvre de Lassa (1969), Hendra (94), Nipah (98), Nil Occidental (99)), l’échec, relatif, des campagnes d’éradication globales menées dans la foulée de celle de la variole et le maintien ou revival de certaines maladies infectieuses qu’on pensait en voie de disparition, ont contribué à dissiper un certain esprit conquérant mais un changement « ad-hoc » de paradigme va permettre à certains acteurs de la santé publique et de la recherche d’accompagner le ressac en limitant la casse.
Car bien évidemment aux États-Unis comme ailleurs, il s’agit toujours d’abord de naviguer au milieu des restructurations permanentes et autres coupes claires à répétition qui caractérisent ce secteur de la santé publique depuis plusieurs décennies. Mike Davis dans The Monster Enters : Covid-19, Avian Flu and the Plagues of Capitalism ( qui sort en septembre en français) le rappelle longuement dans son huitième chapitre, « Homeland Insecurity », déplorant notamment l’impréparation, particulièrement de la recherche vaccinale, face aux risques de nouvelle pandémie grippale. Pourtant, et d’ailleurs le succès dans la mise en oeuvre des vaccins anti-covid est venu en partie démentir son tableau alarmiste ( pour les pays riches), certains acteurs ont su, au nom de la prévention des risques infectieux, tirer leur épingle du jeu. Qu’on prenne par exemple la France, où les « mauvais coups portés à l’hôpital » ne doivent pas oublier les nouvelles sinécures ouvertes à « l’élite du welfare » par ce que certains chercheurs ont qualifié « d’agencification de l’État sanitaire« , c’est à dire la multiplication, au fil des crises sanitaires et de l’émergence de nouvelles menaces, de toute une galaxie « d’agences sanitaires » qui accompagne « une révolution doctrinale » de la santé publique s’articulant autour de la notion de « sécurité sanitaire ». L’époque est donc aux « épidémiologistes d’État » comme l’indique François Button et Frederic Pierru dans » Instituer la politique sanitaire. Mise en circulation de l’épidémiologie appliquée et agencification de l’État sanitaire. » : » Observer, surveiller, alerter » : telle est désormais la triple mission de ces épidémiologistes d’État situés aux avant-postes de la guerre contre les menaces sanitaires. Une fois établis au cœur de l’État, ces épidémiologistes ont pu, avec l’appui de l’administration centrale, élargir leur champ d’observation en étendant la catégorie du risque bien au-delà des maladies transmissibles et infectieuses. Ils ont profondément transformé la vieille « police sanitaire ». »
Ce sont les États-Unis qui ont, comme il se doit, ouvert la voie dans le domaine. Ainsi, dès 1989, le National Institutes of Health en collaboration avec la Rockfeller University organisa une conférence sur les « virus émergents » qui eut un profond impact comme le relate Nicholas B. King dans son article « Security, Disease, Commerce : Ideologies of Post-colonial Health » : « Dans la décennie qui a suivi, les inquiétudes exprimées lors de cette conférence seront largement relayées par ses participants, qui les consolideront en un ensemble orthodoxe de prédictions et de recommandations qui sera ensuite repris par un groupe plus large de personnes comprenant d’autres scientifiques, des journalistes de premier plan, des responsables locaux et nationaux de la santé publique et des experts de la sécurité nationale. La vision centrée sur les maladies émergentes en est vite venue à dominer la compréhension américaine de la santé publique internationale. » Certes, comme nous l’avons rappelé plus haut la situation sanitaire globale avait effectivement « objectivement » changé mais il s’agissait aussi de faire d’une pierre deux coups : « Associer les maladies infectieuses aux intérêts économiques et sécuritaires américains ( …) permettait aux initiateurs de la campagne de solliciter des fonds non seulement auprès des institutions de santé traditionnelles mais aussi du département de la défense. Cela constituait une opération politique astucieuse à une époque où le financement de la santé publique était régulièrement l’objet de coupes sévères. »
Ce qu’il faut retenir, plus que l’habileté institutionnelle, c’est l’habileté conceptuelle puisque le nouveau paradigme « biosécuritaire » qui émerge alors ne va avoir de cesse de s’étoffer et d’étouffer toute autre réflexion sur la gestion des nouveaux « risques ». Faire des maladies émergentes une question de sureté nationale et internationale s’articulait en effet parfaitement à la ré-configuration de la théorie et de la politique sécuritaire à l’ère de la globalisation triomphante. Comme le soulignent Bruce Magnusson et Zahi Zalloua dans leur introduction au recueil Contagion, Heath, Fear, Sovereignty » Depuis plusieurs décennies, la contagion est devenue une métaphore de choix pour à peu près tout, allant du terrorisme globale aux attentats suicides, de la pauvreté à l’immigration, des crises financières globales aux droits de l’homme, du fast-food et de l’obésité au divorce et à l’homosexualité. La prolifération sans précédent de la contagion comme outil heuristique ou catégorie interprétative devrait toutefois nous donner à penser. Qu’arrive-t-il quand le concept de contagion sort de son contexte épidémiologique originel et commence à contaminer les autres discours dans les sciences sociales et les humanités ? » Selon eux la contagion est devenu « le maitre-mot controversé de la mondialisation, une épée à double tranchant pour penser les processus globaux. » D’ores et déjà la peur de celle-ci rebattant les cartes de la souveraineté puisqu' »un virus est là, prêt à surgir et à briser les défenses hygiéniques, physiques et intellectuelles les plus élaborées des États et des individus souverains. » Cette reconversion heuristique des maladies émergentes a été également longuement soulignée par Bruce Braun dans son article « Biopolitics and the Molecularization of Life« : » Avec l’attention accrue portée à des phénomènes comme la grippe aviaire, le virus Ebola, la maladie de la vache folle et autres zoonoses, la vie moléculaire a été pensée comme intrinsèquement instable et, dans un sens, comme perpétuellement menaçante. La vie humaine est en retour conçu comme jetée dans ou exposée à ce monde moléculaire soumis à un constant changement chaotique. Loin du corps indépendant doté d’un code génétique clair – le fantasme d’une identité essentialisée stockée comme une banque de données sur un cd-rom- ce que nous trouvons dans le discours médical et politique sur les « maladies infectieuses émergentes » c’est un corps radicalement ouvert au monde, projeté dans le flux de la vie moléculaire où les recombinaisons ne sont pas ce que nous contrôlons mais ce que nous craignons. (…) La biosécurité est la réponse au problème de la mutabilité et de l’imprévisibilité de la vie biologique au sein d’un ordre politico-économique fondé sur l’intégration économique globale. »
Le virus érigé en révélateur du monde des flux, du juste-à-temps et de l’interconnexion globale ? Il s’agit certes désormais d’un lieu commun, d’autant plus depuis le début de la pandémie de Covid-19. Mais ce qui caractérisait à l’époque le discours et la pratique biosécuritaire c’est le changement d’approche qu’elle faisait découler de ce constat. Andrew Lakoff dans sa contribution « Epidemic Intelligence. Toward a Genealogy of Global Health Security » au recueil Contagion, Heath, Fear, Sovereignty le résume ainsi : « Ces projets contemporains de gestion des maladies infectieuses à une échelle globale prennent des aspects des politiques de santé publique précédentes mais les adaptent à un ensemble de circonstances différentes. La sécurité sanitaire globale cherche à orienter certaines structures des systèmes de santé nationaux existants vers son objectif de détection précoce et d’endiguement rapide des infections émergentes. Puisqu’elle se concentre sur des éclosions potentielles de maladie, dont on ne peut pas calculer la probabilité en utilisant des méthodes statistiques, elle développe des techniques de simulation d’épidémie qui modélise l’impact éventuel de celle-ci. » Steve Hinchliffe ( dont on recommande les nombreux textes sur le sujet) et alii dans Pathological Lives. Disease, Space and Biopolitics proposent une synthèse voisine : « La nature non calculable du comportement microbien, l’érosion des régulations étatiques de même que ce qui est perçu comme une hyper-connectivité des voyages et communications globaux, ont conduit à un tournant des logiques d’anticipation, de la prévention des risques connus à la préparation à l’événement sanitaire inconnu mais visiblement inévitable. » Pour ceux qui s’en souviennent, on retrouve bien entendu ici bien des ingrédients (menace omniprésente et permanente) et méthodes (« frappe » préventive) de la guerre anti-terroriste du tournant des années 2000, la secte aum et les lettres à l’anthrax ayant évidemment donné un utile petit coup de pouce à cette fusion avec la lutte contre les « infections émergentes »…
C’est Melinda Cooper dans son article » Pre-empting Emergence. The Biological Turn in the War on Terror » ( repris dans son livre Life as Surplus que nous évoquons plus loin) qui a le mieux, à l’époque (2006), analysé ce tournant où, pour « La défense américaine la frontière entre la guerre et la santé publique, la vie microbienne et le bio-terrorisme est devenue stratégiquement indifférente ». La vie microbienne, envisagée sous l’angle de la guerre, appelant donc la même redéfinition des limites de la souveraineté et les mêmes mesures « préventives ». Une institution centrale du complexe militaro-industriel américain, la DARPA ( Defence Advanced Research Project Agency) va poser les bases de la nouvelle politique bio-sécuritaire : » La DARPA, le centre chargé au Pentagone du financement des technologies militaires innovantes travaille sur une réponse similaire aux problèmes des maladies infectieuses émergentes et du bio-terrorisme. Un des projets actuels de la DARPA inclut des technologies de détection avancées (…) elle utilise notamment les nouvelles techniques de recombinaisons aléatoires d’ADN ( célébrées comme la seconde génération d’ingénierie génétique à cause de leur capacité hautement accélérée à recombiner aléatoirement des segments entiers de génome). La DARPA travaille sur une évolution préventive. Alors que la recherche est menée sous la bannière de la biodéfense, la DARPA se retrouve dans la situation paradoxale d’avoir à créer d’abord de nouveaux agents infectieux, ou des formes plus virulentes des pathogènes existants, afin de mettre au point un remède. Brouillant la différence entre recherche défensive et offensive, innovation et préemption, le Pentagone semble avoir décidé que la contre-prolifération agressive est la seule défense possible contre un futur biologique incertain. C’est une solution sans retour – si la possibilité d’émergence de résistances biologiques est inépuisable, la guerre préventive de la DARPA contre les maladies infectieuses et le bioterrorisme ne peut être qu’infinie. » Signalons également l’article antérieur (2004) et tout aussi éclairant de Susan Wright « Taking Biodefense too Far » qui dénonçait « la course aux armes biologiques contre nous-mêmes » que représentaient déjà ces manipulations génétiques visant à volontairement accroitre la virulence de microbes, bacilles et autres virus et menées sous prétexte de « biodéfense ».
On pourrait certes dorénavant passer directement de cette hâtive esquisse de « préhistoire » à l’Institut de Virologie de Wuhan et son éventuelle responsabilité dans la pandémie actuelle mais ce serait faire l’impasse sur une décennie d’évolutions, et parfois même de relatives involutions, significatives de ce secteur biosécuritaire. Le livre de Melinda Cooper Life as Surplus. Biotechnology and Capitalism in the Neoliberal Era, paru en 2009, témoigne, selon nous, assez bien à la fois des ambitions sous-jacentes aux projets biosécuritaires, et plus largement biotechnologiques et, quand on le relit aujourd’hui, des limites qu’a rencontré et rencontre encore une certaine « hybrisocène » technoscientifique. Pour Cooper, « Alors que les domaines de la (re)production biologique et de l’accumulation capitaliste se rapprochent, il devient difficile de penser les sciences de la vie sans solliciter les concepts de l’économie politique. (…) Nous devons désormais être sensibles à l’intense trafic entre les sphères économiques et biologiques, sans réduire l’une à l’autre, ni pétrifier l’une au bénéfice de l’autre. » Et si « le néo-libéralisme souhaite éliminer les séparations entre les sphères de la production et de la reproduction, entre le travail et la vie, le marché et les tissus vivants », il ne cherche pas « tant à imposer la marchandisation généralisée de la vie quotidienne – l’assujettissement de la sphère extra-économique aux nécessités de la valeur d’échange- que sa financiarisation. Son impératif n’est pas tant la mesure du temps biologique que son incorporation dans la temporalité non commensurable, a-chronologique de l’accumulation du capital financier. (…) Le néo-libéralisme et l’industrie biotechnologique partagent l’ambition commune de surmonter les limites économiques et écologiques à la croissance associées à la fin de la production industrielle au travers d’une réinvention spéculative du futur. »
Cooper, dans la lignée d’une certaine tradition post-operaïste, tend donc à hypostasier les ambitions tant de la science que de la finance dans la première décennie des années 2000 : » En l’absence d’un quelconque actif tangible ou de profits réels, ce que la start-up de la biotech peut offrir c’est une revendication de propriété sur les futures formes de vie auxquelles elle pourrait donner naissance, en même temps que les profits que celles-ci généreraient. » Car, » Tandis que la production industrielle dépend des réserves limitées disponibles sur la planète, la vie, comme la production contemporaine de dette, doit être analysée comme un processus de constante autopoïèse, un auto-engendrement de la vie à partir de la vie, sans début ni fin concevables. » Si Cooper n’en souligne pas moins longuement tous les paradoxes et limites de l’entreprise et que son ouvrage est bien plus riche et foisonnant que ne le laisse présager ces quelques citations, la perspective qu’elle dessine ne s’est pas réalisée jusqu’ici puisqu’une fois de plus ( cf. la crise financière de 2000 puis celle de 2009) la « Frontière » biotechnologique n’a pas tenu ses promesses, que ce soit d’ailleurs, pour parler comme Jason Moore, en terme d' »appropriation » comme de « capitalisation ».
Depuis l’orée, le secteur ne va en effet que de boom en crash, mais ce n’est certes pas que la faute de la finance. Comme le résumait magistralement André Pichot ( cité dans l’indispensable présentation de son parcours et de sa réflexion par Bertrand Louart : Le vivant, la machine et l’homme. Le diagnostic historique de la biologie moderne par André Pichot & ses perspectives pour la critique de la société industrielle) : » À en croire les médias, la biologie serait le dernier bastion de la révolution permanente. Il ne se passe pas un mois sans qu’on nous trompette une fabuleuse découverte susceptible d’éradiquer à jamais la misère et la faim, un bouleversement conceptuel annonciateur d’ébouriffantes perspectives thérapeutiques, à moins que ce ne soit, plus modestement, un exploit technique incongru ou photogénique, et donc riche de sens supposé. Merveilles répétitives forcément doublées d’enjeux financiers superlatifs, mais prudemment commentées au futur, temps des promesses sans garanties, et conjugaison préférée des biologistes – avec le conditionnel, qu’ils utilisent quand le morceau est un peu dur à avaler.
Devant un tel spectacle, les mauvais esprits (mauvaises langues, mais bons yeux) diront qu’une science qui connaît une révolution tous les quinze jours est une science qui tourne en rond. Et qu’une science qui ressent un tel besoin de se mettre en scène dans les médias en promettant tout et n’importe quoi est une science qui a perdu pied et se noie dans un fatras de résultats expérimentaux qu’elle est incapable d’évaluer et d’ordonner, faute d’une théorie cohérente. À y regarder de près, c’est bien le cas. Pour l’essentiel, ces prétendues révolutions ne sont que des affaissements successifs par lesquels pan par pan, s’effondre le cadre théorique de la génétique moléculaire (et par là, celui de la biologie moderne dont la génétique est le pivot). » (Mémoire pour rectifier les jugements du public sur la révolution biologique, revue Esprit, août-septembre 2003)
Même si on voit discours optimistes voire triomphalistes repointer le bout de leur nez, les deux décennies qui s’achèvent n’ont principalement débouché que sur des apories. Qu’on prenne le secteur agricole, et de l’aveu, il y a quelques temps déjà, d’un de ses plus précoces critiques : » Le besoin de maintenir les niveaux d’investissement et le cours des actions en bourse a mis une pression énorme sur les compagnies biotechnologiques pour qu’elles développent et déploient des produits aussi vite que possible. (…) Mais la vie est beaucoup plus compliquée que les sociétés de biotechnologie ou leurs équivalents académiques ne l’avaient anticipé. (…) la révolution génétique n’a pas encore eu lieue. Après plus d’une décennie à se précipiter pour lever des fonds au nom du code génétique, les géants du gène n’ont été en mesure d’amener sur le marché que deux OGM pour 4 productions agricoles. Les coûts financiers ont été énormes. Et au bout du compte, les coûts en terme de perte de capital culturel et politique dans la lutte contre les régulations et classifications ont peut-être été encore plus importants. » ( Jack R. Kloppenburg, First the Seed. The Political Economy of Plant Biotechnology, voir également sur le sujet, Jason Moore Le Capitalisme dans la toile de la vie pp. 368-375) Il en va de même pour la médecine où le séquençage individualisé du génome n’a pas donné les résultats escomptés ( voir sur ce point » Playing the Genome Card » de Ari Berkowitz et l’article « L’eldorado de la médecine sur mesure » de Raùl Guillén dans Le Monde Diplomatique de septembre), les ambitions de la recherche sur les cellules souches soulèvent de plus en plus d’interrogations et les thérapies géniques déçoivent.
Les folles ambitions du tournant du siècle et la crise, certes larvée mais tout autant économique qu’épistémique, qui lui a succédé constituent donc un arrière plan fondamental de la prolifération biosécuritaire, qui n’a pas, elle non plus, manqué de zigzaguer. Ainsi la transition de l' »international » au « global » de la santé publique mondiale qu’elle accompagnait, c’est à dire le passage d’une collaboration entre États souverains sur les questions de santé à la subordination de ceux-ci à des autorités transnationales, subordination rendue nécessaire par l’approfondissement de l’interdépendance et l’accélération de la circulation mondiales, ne s’est pas déroulée non plus comme prévu ( sur cette transition voir: Brown, Cueto et Fee « The World Health Organization and the Transition From “International” to “Global” Public Health« ) Ce fut notamment illustré en 2007 par le refus de l’Indonésie de continuer à collaborer avec l’OMS dans la collecte des échantillons de virus de la grippe aviaire qui frappait le pays. Refus motivé par la volonté du pays de passer un accord directement avec une firme pharmaceutique pour mettre au point un vaccin et non plus passer par l’OMS, que le gouvernement indonésien accusait de pourvoir l’industrie pharmaceutique en échantillons de virus sans s’assurer derrière que le vaccin mis au point serait accessible à un prix abordable pour les pays en développement. Les accusations à peine voilées de « biopiraterie » lancées par Jakarta, mais aussi par la Thaïlande, soulignant que les États du Sud refusaient d’être les idiots utiles d’une santé globale pensée comme un investissement des pays riches dans leur « auto-protection »( voir notamment David P. Fidler « Indonesia’s Decision to Withhold Influenza Virus Samples from the World Health Organization: Implications for International Law » et « A Science that Knows No Country: Pandemic Preparedness, Global Risk, Sovereign Science » de J Benjamin Hurlbut). Que le conflit ait été réglé grâce à l’intervention de la fondation Gates, modèle s’il en est de la nouvelle (plouto)philanthropie sanitaire, n’a fait qu’également souligner le déclin de la suprématie de l’OMS mais aussi de toutes les institutions nationales de sécurité sanitaire au profit de ce type de structures, certes peut-être plus enclines à financer la prolifération mais bien plus sujettes à la vigilance ou la méfiance du public et de la presse ( du moins celle qui ne survit pas grâce à leurs subsides cf le journal Le Monde en france). A propos de prolifération sans frontières, notons que le chercheur hollandais Ron Fouchier a tenté en 2012 de contourner l’interdiction qui lui avait été faite de publier les résultats de ses bidouillages à hauts risques sur la grippe aviaire (voir plus loin) en invoquant justement cette « souveraineté génomique » indonésienne puisque ses souches du virus provenaient de l’archipel… ( voir Porter et Hinterberger, « Genomic and Viral Sovereignty: Tethering the Materials of Global Biomedicine« )
Le cas de l’OMS et de ses homologues nationaux n’a en tout cas pas été arrangé par la « grippe porcine » de 2009, déclarée pandémique le 11 juin de cette année là alors qu’elle s’avérera au bout du compte plus bénigne que la grippe saisonnière ( cf le précédent de 1976, voir plus haut). D’autant que cet excès de précaution alimenta de nombreux soupçons concernant une collusion de l’institution internationale avec les compagnies pharmaceutiques. Le Docteur Wolfgang Wodarg, épidémiologiste, député européen social-démocrate et ancien président du sous-comité sur la santé du parlement de Strasbourg résumait bien ces soupçons lors d’une déclaration devant une commission de l’assemblée du Conseil de l’Europe en 2010 : » En conséquence du bruit fait autour de la grippe aviaire de 2005/2006, de nombreux contrats furent signés entre les États nationaux et des entreprises pharmaceutiques afin de garantir la disponibilité de vaccins spécifiques en cas de future pandémie . Les compagnies commencèrent alors à produire une seconde ligne de vaccins destinés à être utilisés lors d’une pandémie. Ils développèrent leurs nouveaux vaccins en utilisant des adjuvants brevetés. C’est la raison pour laquelle ces vaccins purent être monopolisés par quelques compagnies et vendus bien plus chers que les vaccins saisonniers, qui sont traditionnellement produits dans des oeufs de poule et qui peuvent donc, de ce fait, être produits très rapidement par de nombreux laboratoires de par le monde en utilisant des procédures non brevetées. (…) La fourniture de ces vaccins anti-pandémiques au niveau national était liée, par contrat, dans de nombreux pays à une clause de non recours en cas d’effets secondaires non désirables. Ces contrats et engagements commerciaux devaient prendre effet en cas de déclaration d’une pandémie par l’OMS. Donc celle-ci a simplement déclenché l’application des plans de préparation anti-pandémique et libéré ainsi d’importants revenus pour les producteurs de vaccins impliqués. » Ce qui aurait au total coûté aux États la rondelette somme de 18 milliards de dollars… ( voir également à ce sujet l’enquête « WHO and the Pandemic Flu « Conspiracies » publiée en 2010 dans le British Medical Journal)
Avec cette « fausse alerte », c’est évidemment le coeur du paradigme biosécuritaire, le développement de tout un appareil de surveillance et de recherche autour d’une partie du « vivant » érigé en menace, qui se trouvait pris en défaut. Ce qui n’empêcha pas, bien au contraire, cet appareil de surveillance de continuer à s’étendre y compris dans la collecte de données permettant un suivi toujours plus poussé des individus ( c’est la thèse défendue par Bronwyn Parry dans « Domesticating biosurveillance: ‘Containment’ and the Politics of Bioinformation« ). On a d’ailleurs surtout l’impression d’un empilement continu d’institutions, programmes, projets sur les maladies infectieuses émergentes : ainsi aux États-Unis, la création du Real Time Disease Outbreak System (RODS), système de surveillance en temps réel des données de santé pour déceler un début éventuel d’épidémie venant doubler celle du programme Biosense du CDC, autre programme de « surveillance syndromique » automatisé ; la DARPA lançant en 2018 sur le même créneau que le programme PREDICT de l’USAID ( abandonné en 2019 puis relancé par Biden), son programme PREEMPT, le tout venant concurrencer sur son terrain le Global Virome Project, etc, etc. Mais ce n’est certes pas que cette balkanisation qui explique les miracles accomplis en 2019 par tous ces professionnels de l’anticipation – quoique la france qui se croyait championne mondiale de la prolifération bureaucratique semble vouloir y puiser une inspiration nouvelle – puisque le système chinois de déclaration des maladies, qui faisait la fierté des responsables sanitaires du pays, est lui aussi passé à côté du virus.
Cette incompétence pourrait bien sûr ne sembler qu’anecdotique et bien inoffensive si l’autre versant de cette manie anticipatrice n’étaient pas de très concrets bidouillages de laboratoires. Et, comme dans toute cette histoire, il est principalement question « de voir venir », on peut, à défaut d’un panorama complet, suivre le développement de ces diverses manipulations et autres créations de chimères au fil de la montée progressive des inquiétudes à leur sujet (on trouvera par ailleurs un bon résumé analytique des divers rebondissements évoqués ci après dans l’article « L’alarme d’Antigone » de Frederic Keck). Ainsi, comme le rappelait Susan Wright dans « Taking Biodefense too Far » : « Dans le passé, certains biologistes ont avancé qu’il serait impossible de créer des organismes plus épouvantables que ceux déjà fournis par la nature – ce qui supposait que de folles tentatives de créer de nouveaux pathogènes seraient vouées à l’échec. Mais ce n’est plus le cas. Si des doutes demeuraient, ils ont été dissipés à la fin des années 90 quand la tentative par des scientifiques australiens de créer un vaccin contraceptif pour les souris, qui périodiquement prolifèrent hors de tout contrôle dans certaines parties de l’Australie, a pris un tournant inattendu. » En effet la manipulation génétique visant à garantir la stérilité a abouti à la création d’une version plus foudroyante d’un virus existant ( mousepox, la variole de la souris ?), ou comme le résumait le journal Libération à l’époque : « Au lieu de créer un vaccin anticonceptionnel pour les souris, les chercheurs ont mis au point une véritable bombe biologique, un virus nettoyeur de rongeurs. Il n’a pas quitté leur labo, mais son efficacité les a un peu décontenancés. « S’ils ont bien travaillé, il n’y a aucun risque de dissémination», explique Louis-Marie Houdebine, chercheur à l’Institut national de recherche agronomique (Inra) et spécialiste français des organismes transgéniques. Les chercheurs opèrent en principe en milieu confiné et dans des conditions de sécurité très élevées. Le virus génétiquement modifié des Australiens n’a probablement pas d’avenir. Trop difficile à contrôler et beaucoup trop dangereux. (…) D’après New Scientist, les scientifiques australiens redoutent surtout l’utilisation d’un vaccin transformé par des bioterroristes. «Si un imbécile introduisait ce gène de l’IL4 dans le virus de la variole humaine, la mortalité augmenterait de façon assez spectaculaire», explique le magazine. » Sachant que cette mortalité était déjà de 30 à 40%, sans oublier les très importantes séquelles pour les survivants…
Cette question de l’usage des données de recherche et de la variole humaine, dont on aurait pu espérer que l’éradication aurait découragé les vocations, s’est d’ailleurs reposée deux ans plus tard avec la publication d’un autre article, dans lequel des chercheurs décrivaient comment, pour étudier les facteurs respectifs de virulence du virus de la variole humaine et du virus de la vaccine ( à partir duquel Jenner a inventé la vaccination contre la variole), ils avaient mis au point une variante bien plus virulente de cette dernière, ce que certains ont décrit comme mode d’emploi pour une opération bioterroriste. Il faut noter l’argumentaire pour le moins saugrenu des chercheurs pour lesquels, puisqu’il reste, « officieusement », des échantillons du virus dans des laboratoires militaires américains et russes ( et pas seulement : comme on s’en est aperçu, par hasard !, en 2014 dans un labo du National Institutes of Health américain), la menace de la variole n’est pas éradiquée, ce qui autorise donc leurs manipulations pour la « ressusciter ». La récréation en 2005 du virus de la grippe espagnole, sous l’égide du CDC américain, suite à la récupération d’un échantillon du virus sur le corps d’une victime de l’époque conservée dans le permafrost en Alaska, toujours sous prétexte d’en comprendre la virulence, ne manqua pas de provoquer des angoisses similaires et ce, même chez certaines autorités sanitaires. Ces épisodes successifs ont donc amené le Conseil National de la Recherche américain a théoriser, dans Biotechnology Research in an Age of Terrorism le « dilemme de l’usage dual « , c’est à dire le fait que » la même technologie puisse être utilisée légitimement pour l’amélioration du sort de l’humanité ou pour le bioterrorisme » et à recommander d’affubler certaines recherches du label » Dual Use Resarch of Concern ». Après deux guerres mondiales, deux bombardements atomiques et une longue succession d’incidents nucléaires, industriels ou sanitaires jusqu’à aujourd’hui, il était effectivement temps de constater à quel point cette question du « double usage » préside à toute l’histoire de la technologie moderne et notamment de la bactériologie (voir entre autre les travaux de Paul Weindling ou l’article de Edmund Russel : « A propos d’annihilation » : mobiliser pour la guerre contre les ennemis humains et insectes, 1914-45″ qui paraît en novembre dans notre anthologie Épidémies et rapports sociaux) !
Dans la seconde décennie 2000, ce sont surtout les recherches dites, selon la définition officielle, « de gain de fonction entrainant une accroissement de la capacité de transmission ou la virulence de pathogènes potentiellement pandémiques » qui passeront au premier plan. En effet lors d’une conférence qui se tenait à Malte en septembre 2011, le professeur Ron Fouchier du Centre Medical Erasmus de Rotterdam présenta les résultats d’expériences de gain de fonction menées sur une souche humaine du H5N1 afin de faciliter une transmission inter-humaine, le virus étant ensuite inoculé à des furets ( l’animal fétiche des recherches sur la grippe depuis les années 30, du fait de la similarité des symptômes et modes de transmission du virus chez ces animaux et les hommes). Via des contaminations successives des animaux entre eux, Fouchet et son équipe étant ensuite parvenu à une transmission par les voies respiratoires, dont on sait, depuis qu’en 1933 un chercheur fut, pour sa plus grande joie, infecté par un de ses furets de laboratoire, qu’elle présage une transmission inter-humaine équivalente. L’annonce peu après par le chercheur japonais Yoshihiro Kawaoka et allii de la modification réussie d’une souche du H5N1, « grâce » à des techniques de génétique inverse, afin de faciliter la transmission inter-humaine, toujours par voies respiratoires, du virus vint à point nommé compléter le tableau. Plutôt que de retracer les controverses qui s’ensuivirent, avec notamment en 2014 la suspension provisoire du financement par la maison blanche de certaines recherches, les protestations de Fouchier et Kawaoka, etc, ce que l’article « L’alarme d’Antigone » de Frederic Keck fait très bien, il semble plus intéressant de relayer les critiques émises par certains chercheurs à l’époque.
L’un des plus connu et actif de ces critiques est l’épidémiologiste Marc Lipsitch qui s’est très tôt élevé contre certaines recherches en « gain de fonction » au nom d’ailleurs de méthodes de recherches alternatives et bien moins hasardeuses. Ainsi en 2014 dans l’article, co-écrit avec Alison P. Galavani, « Ethical Alternatives to Experiments with Novel Potential Pandemic Pathogens » il constatait » L’évaluation des risques entourant la recherche biomédicale n’a pas suivi le rythme des innovations scientifiques en termes de méthodologie et d’applications. Cet écart est particulièrement déconcertant concernant les recherches impliquant des « pathogènes potentiellement pandémiques » qui risquent d’être accidentellement libérés dans la nature et de se propager globalement. (…) Il existe des approches expérimentales plus sûres, qui sont à la fois scientifiquement plus porteuses d’informations et plus facilement applicables afin d’améliorer la santé publique via une surveillance, prévention et traitement approfondie de la grippe. » Dans un débat avec entre autres, le lui aussi très actif, Ron Fouchier, il notait « Contrairement à d’autres expériences à gain de fonction, la création de pathogènes potentiellement pandémiques (PPP) comporte le risque unique qu’un accident de laboratoire puisse déclencher une pandémie qui tuerait des millions de personnes. La question n’est pas de mener des recherches sur les PPP ou ne rien faire, c’est plutôt de savoir si on a un portefeuille d’approches pour battre un virus sans créer de risque pandémique et si il faut inclure les PPP dans ce portefeuille. Nous devrions par exemple décider si nous consacrons nos ressources limitées à des recherches qui créent expérimentalement des PPP – recherches qui sont couteuses, souvent poussives, d’une faible productivité, peu généralisables et qui créent un risque pandémique – plutôt que de les consacrer à développer les autres aspects de ce portefeuille de prévention de la pandémie grippale. » Il appelle même un peu plus loin, au vu des risques représentés par ces recherches, à ce que le public s’implique dans le débat, ce qui n’a pas du manquer de paraître une abomination à ses interlocuteurs et collègues ! (On peut également lire avec profit du même Lipsitch « Why Do Exceptionally Dangerous Gain-of-Function Experiments in Influenza?« )
Autre scientifique inquiet des dangers présentés par les opérations préventives de la recherche biosécuritaire, le virologue de l’institut pasteur Simon Wain-Hobson, rappelait dans « The Irrationality of GOF Avian Influenza Virus Research » que ces « expérimentations d’évolution forcée sur les virus grippaux n’ont que très peu de chances de délivrer des informations à partir desquelles un ministre de la santé pourrait agir. » Mais que par contre une fois publiées » ces études sont facilement réplicables à moindre coûts. Savoir ce que c’est faisable suffit. Et si la reproduction de ces expériences se fait dans d’autres laboratoires avec des normes de confinement moindre, ces nouvelles souches pourraient proliférer, avec un risque accru de libération accidentelle. » Là encore ce n’est pas la prolifération bioterroriste mais bien plutôt « bioerroriste » qu’il faut donc craindre, surtout vu la multiplication vertigineuse des laboratoires dits de « haut niveau de biosécurité » ces dernières années de par le monde.
Alexandra Peters décrit bien le phénomène dans son article « The global proliferation of high-containment biological laboratories: understanding the phenomenon and its implications » et constate que si « cette prolifération est paradoxale : plus nous construisons de laboratoires pour nous protéger, plus notre environnement devient précaire » elle n’en est pas moins à la fois « horizontale et verticale, c’est à dire que plus d’États construisent des laboratoires de haute sécurité et que les États qui ont déjà des laboratoires de ce type en construisent plus ». Précisons qu’il est question ici de laboratoires de type P3 ( laboratoires qui peuvent manipuler des pathogènes mortels pour lesquels des traitements ou des vaccins existent) et P4 ( laboratoires qui manipulent des pathogènes mortels pour lesquels aucun traitement n’existe). La carte mondiale des laboratoires P4 (ci contre), tirée du site de suivi et d’analyse Global Bio Labs , illustre presque caricaturalement ce bourgeonnement biosécuritaire.

Celui-ci est certes grandement facilité par la faiblesse de l’encadrement national et international. En effet en 2007 déjà, un rapport de l’United States Government Accountability Office, High-Containment Laboratories: Preliminary Observations on Federal Efforts to Address Weaknesses Exposed by Recent Safety Lapses, notait, dans ce qui fait penser au tableau clinique de la propagation d’une maladie, » Il se produit une prolifération majeure de laboratoires de haute sécurité de type P3 et P4 aux États-Unis (…) cette expansion se déroule dans de de nombreux secteurs – fédéraux, académiques et privés – et à travers tous les États-Unis. On est ainsi passé de 5 laboratoires P4 en 2001 à 15 aujourd’hui. » Au vu de la liste donné un peu plus loin dans le rapport ( p5 et 6) il semblerait n’importe quelle agence sanitaire ou sécuritaire voulait désormais son laboratoire de haute sécurité, cette mode étant facilité par le fait » Qu’il n’existe pas d’agence fédérale ayant la mission de surveiller et de déterminer les risques associés à l’expansion des laboratoires P3 et P4 aux États-Unis et aucune agence ne sait combien il y a de laboratoires de ce type dans le pays. Par conséquent personne n’est responsable des risques associés à la prolifération de ces laboratoires de haute sécurité. » Un paradoxe de plus de « l’agencification » ? En tout cas dans son rapport de 2017, l’organisme ne constatait pas d’évolution décisive sur ce plan.
La prolifération est bien évidemment également mondiale et à peine plus régulée, avec pas moins de 25 laboratoires P4 dans 23 pays ( 9 en Europe, 7 en Asie et 3 en Afrique). En Chine, comme le retrace l’article « Current status and future challenges of high-level biosafety laboratories in China » de Yuan Zhiming, la création de laboratoires de ce type a fait l’objet, d’abord en 2004 puis en 2016 d’un grand plan national de construction, allant pour ce dernier jusqu’en 2025, bien que, comme le note Zhiming, la surveillance à l’échelle nationale et la formation du personnel laissent à désirer et que faute de financement suffisant ( les laboratoires P3 et P4 ont des frais de fonctionnement annuels équivalent à 10% de leurs frais de construction) « plusieurs laboratoires de haute sécurité disposent de fonds opérationnels insuffisants pour mener des opérations de routine vitales. Du fait de ces ressources limitées, certains laboratoires P3 fonctionnent avec des coûts opérationnels extrêmement limités voire parfois nuls. »
Dans ce contexte la sempiternelle question des accidents et autres fuites ne manque pas de se reposer et à été d’ailleurs soulevée à de très nombreuses reprises par plusieurs chercheurs, en particulier Lynn C. Klotz, dont les travaux sont incontournables sur ce sujet. Rappelons que depuis la fuite en 1978, probablement par le système d’aération, du virus de la variole d’un laboratoire de Birmingham qui fit deux morts ( dont le directeur du laboratoire qui mit fin à ses jours), il ne s’agit certes plus de science-fiction. Encéphalite équine vénézuélienne en Amérique du Sud en 1995, SRAS en 2003 à Singapour et Taïwan puis 2004 en Chine, fièvre aphteuse en Angleterre en 2007, et les contaminations importantes et à répétition par la brucellose depuis des laboratoires chinois ces dernières années : les exemples spectaculaires, tragiques et plus ou moins admis par les autorités sont légion. Mais comme le souligne très justement Klotz, c’est le jour le jour des « évités de justesse », ou, si l’ont veut, d’un autre « juste à temps », qui semble plus effrayant encore. Dans son article de février 2019 ( sic!), « Human error in High-Biocontainment Labs: A Likely Pandemic Threat« , qui s’appuie sur 749 accidents de laboratoires de haute sécurité recensés aux États-Unis de 2009 à 2015, elle constate que ceux-ci sont à près de 80% dus à une erreur humaine et se distribuent selon sept catégories : 1) coupure ou piqure 2) chute d’un contenant ou projections de liquides 3) morsures par un animal de laboratoire 4) manipulation d’un pathogène hors d’une zone sécurisée 5) exposition due à un non respect des procédures de sécurité 6) défaut d’un équipement de protection 7) défaut d’une machine ou d’un équipement mécanique (Klotz ne mentionne pas par contre les coupures de courant, comme cela s’est produit a Atlanta en 2007, ou les inondations accidentelles ).
A cela s’ajoute la mise en circulation, voire le transport clandestin, lors d’échanges entre laboratoires, d’échantillons de virus insuffisamment désactivés, voire même parfois de confusion entre les lots, comme cela a été le cas à plusieurs reprises aux États-Unis pour l’anthrax ou les virus Ebola et Marburg … Enfin le climat va comme partout venir probablement mettre son grain de sel, et ce alors que les 3/4 de ces laboratoires se trouvent en zone urbaine. Comme l’ont calculé, il y a quelques temps déjà, Van Boeckel et alii dans « The Nosoi commute: a spatial perspective on the rise of BSL-4 laboratories in cities » « la population globale vivant à 30 minutes d’un laboratoire P4 est passée de 30 165 678 personnes en 1990 à 42 456 931 en 2000 et 96 986 631 en 2010. Les prédictions se basant sur les laboratoires construits depuis 2010 ou actuellement en construction suggèrent que ce chiffre pourrait atteindre 126 146 118 personnes en 2012. Dans l’ensemble, cela représente une multiplication par 4 du nombre de personnes concernées et le passage de 0,57% de la population mondiale à 1,8% après 2012. » On remarquera que si, par exemple, les récentes révélations de cas d’infections à la Maladie de Creutzfeldt-Jakob dans des laboratoires français a donné lieu à un peu de bruit médiatique et même à la mobilisation de proches d’une de ces « morts pour la science », on a pas encore entendu parler de protestations contre les nombreux laboratoires P3 et P4 qui maillent le territoire français, il n’y a certes pas de zones d’achalandage alternatif à y développer…
Si nous évoquerons dans la suite et fin du texte les manipulations menées plus spécifiquement sur les coronavirus et le nouveau paradigme « One Health » et les expériences transgéniques, etc qu’il promeut, on peut à l’issue de ce très « lapidaire » panorama de la prolifération biosécuritaire depuis le début du XXIe siècle, évoquer quelques pistes de réflexion sur ces « recherches préventives qui pourraient bien finir par engendrer ce qu’elles anticipent » (dixit Carlo Caduff dans The Pandemic Perhaps). D’ores et déjà la montée progressive des inquiétudes chez plus d’un acteur du « sérail » ( scientifiques, bureaucrates ou journalistes) et les critiques précoces de nombreux universitaires que nous avons cité, manifestent bien assez que ce n’est pas la pandémie de COVID-19 qui a permis de mettre au jour le phénomène, bien qu’il faille le relire un peu différemment à l’aune de l’hypothèse de la fuite de laboratoire à Wuhan. On pourrait de toute façon parfaitement considérer cette fuite en avant bio-sécuritaire comme une manifestation quasiment caricaturale de toute les tares originelles de ces techniques de manipulation du vivant que disséquait dès 1999 l’indispensable Remarques sur l’agriculture génétiquement modifiée et la dégradation des espèces : » Ces techniques de dégénération de la vie sont ainsi en elles-mêmes le désastre qu’elles préparent, et les ravages matériels à venir sont intégralement inscrits dans les ravages spirituels déjà là : car c’est dés maintenant que par tous leurs modus operandi elles excluent la conscience ; et même la simple connaissance de la réalité exacte de leurs manipulations, puisque si les généticiens se rêvent en programmateur de la nature ( et de la nature humaine) en réalité ils ne font que la bombarder à l’aveugle (…) Le terrain inconnu sur lequel s’avancent les techniciens de la mutation, ils le fabriquent ainsi en toute ignorance non seulement des effets à long terme de leurs manipulations, mais même de leurs résultats immédiats : ils ne savent ni ce qu’ils font, ni comment ils le font. » ( Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances)
Il ne vaut effectivement mieux ne pas s’arrêter au simple paradoxe ( « ils produisent ce qu’ils prétendent empêcher ») mais on est bien obligé aussi de constater que la « blitzkrieg » biotechnologique ne s’est pas déroulée comme annoncée pas plus d’ailleurs que n’a émergé tel ou tel « nouveau mode de production » et de subsomption ( cf l’hypothèse de Cooper dans Life as Surplus : » Ce qui est en jeu et nouveau dans les sciences de la vie contemporaines ce n’est pas tant la marchandisation de la vie biologique que sa transmutation en plus-value spéculative. ») et c’est plutôt cette « contingence » que souligne la prolifération biosécuritaire. De même la continuité qu’elle incarne avec la technoscience issue de la seconde guerre mondiale ( représentation scientifico-prétorienne du vivant, culture de l’urgence et de la mobilisation permanente débouchant sur des recherches expérimentales à visées pratiques et opérationnelles immédiates, « nationalisation » de la science et complexe militaro-industrialo-universitaire, optimisme scientiste fanatisé, etc, etc cf. Amy Dahan & Dominique Pestre (eds) Les sciences pour la guerre) signale, plus qu’un immuable grand projet cybernétique, de bien prosaïques nécessités de survie et reconversion pour des pans entiers des appareils sanitaires, scientifiques, etc, d’État. Bref, pour prendre au sérieux ces « apprentis-sorciers », mieux vaut ne pas les prendre au pied de la lettre.
Et tant bien même on le souhaiterait, il faudrait alors reconnaître le démenti apporté par la crise actuelle et celles qui l’ont précédé aux deux piliers « axiomatiques » qui semblent présider aux divers projets biosécuritaires, c’est à dire d’un côté l’utopie ou l’obsession du contrôle ou de l’anticipation du comportement de toute « forme vivante » et de l’autre, le rêve, lointain héritage de la révolution de la biologie microbienne, d’une éradication des menaces qui dispenserait d’avoir à prendre en compte l’ensemble des conditions qui les rendent possibles ( voir à ce sujet la bonne synthèse de Nancy Leys Stepan Eradication. Ridding the World of Diseases for Ever ?). On pourrait également noter que la « santé globale », dont la prolifération biosécuritaire représente la pointe la plus avancée, semble aussi « échouer » par là même où elle croyait réussir ( « urgentisme », ingérence dans l’indifférence aux situations locales, primat des solutions technologiques, etc cf. l’analyse de Randal M. Packard dans son introduction à A History of Global Health). Mais empiler les constats d’échec ne démentira toutefois pas l’adage « la guerre c’est la santé de l’État et de la science » et l’efficacité avérée de ce « plus vieux plan de relance du monde », d’autant plus depuis que sa mise en oeuvre n’a plus besoin d’être littérale (quoiqu’il ne faille jamais, bien sûr, exclure cette hypothèse). De ce point de vue le complexe biosécuritaire n’a donc pas de soucis à se faire : la simple réalité virologique ( « Il ne peut y avoir d’équilibre final dans la bataille contre les microbes car il n’y a pas de limites assignables à la coévolution de la résistance et de la contre-prolifération, de l’émergence et de la contre-émergence » René Dubos), les effets du changement climatique sur le développement de nouvelles maladies infectieuses ou le revival d’anciennes, etc, etc tout vient et viendra apporter de l’eau au moulin institutionnel et financier de sa guerre préventive contre le « bioterrorisme de mère nature » ( formule qui selon Debora Mackenzie tient lieu de « mantra » chez les virologues).
C’est dans ce contexte que l’hypothèse de la fuite depuis l’institut de virologie de Wuhan prend donc une importance certaine, comme hypothèse bien entendu et non comme vérité dernière ( que le pouvoir chinois s’est certainement désormais assuré de rendre invérifiable). On remarquera pourtant que c’est déjà trop demander à la critique sociale qui, quand elle ne chouine pas sur « l’appât du gain [qui] freine la recherche et la prévention » sur les pandémies ( 4eme de couverture de la version française du livre de Mike Davis), balaye d’un revers de main cette possibilité qui ne cadre pas avec ses raccourcis théoriques ( Social Contagion du groupe Chuang)… Un rapide coup d’oeil aux autres hypothèses existantes ne justifie certes pas un telle indifférence. Si le pangolin a ainsi été dédouané, le marché de Wuhan semble perdre un peu de sa centralité dans les débuts de la pandémie et les contres-théories du complot chinoises ( une fuite dans un laboratoire à Fort Detrick) ont été plusieurs fois prises lourdement en défaut. La seule hypothèse réellement mise en avant par l’équipe d’enquêteurs de l’OMS dans leur rapport, les élevages d’animaux sauvages, et semble-t-il plus particulièrement les élevages de visons, n’a par ailleurs pas connu de nouveaux développements depuis ce printemps et risque fort d’être difficile à étayer à l’avenir comme le déploraient récemment ces mêmes chercheurs.
Quant au sympathique, mais fourre-tout, théorème, très repris dans l' »anti-capitalisme » : « c’est l’extension des activités humaines qui en détruisant l’habitat des chauves-souris facilite le contact de celles-ci avec les animaux domestiqués et les humains et donc la propagation des virus », il est certes toujours absolument vrai et dans un sens rassurant ( opposer une « pure nature » à la « cupidité » des hommes) mais fait également fi de bien des réalités, comme le rôle indispensable que remplissent ces mêmes chauves-souris dans l’agriculture mondiale. En effet, leur centralité dans la lutte anti-nuisibles, dans la pollinisation, la qualité de leur guano très largement utilisé en Asie, au point que certains en ont créé des fermes, la menace que représente le syndrome du nez blanc qui les frappe en masse en Amérique du Nord ( où l’on soupçonne qu’il est arrivé sous les bottes d’un spéléologue européen !) pour la production agricole locale, voilà des réalités difficiles à réconcilier avec les essentialisations panthéistes. D’ailleurs, notons pour l’anecdote, et le paradoxe, que la « source originelle » probable de la fuite accidentelle de Wuhan, si fuite accidentelle il y a eu, c’est la mine de cuivre désaffectée de Mojiang au Yunnan peuplée de chauves-souris où six mineurs clandestins étaient justement venus, en avril 2012, récolter du Guano, mineurs qui sont par la suite tombés malades avec des symptômes très proches du Covid actuel, dont trois d’entre eux ne survivront pas. Ce qui n’avait pas manqué d’attirer l’attention des « chasseurs de virus » de l’Institut de Virologie de Wuhan ( IVW) qui y ont par la suite effectué d’intensifs prélèvements et mis à jour de nombreuses souches de coronavirus, dont l’une s’avérera, comme ils l’annonceront le 20 janvier 2020, à 96% identique au Covid-19.
Nous ne détaillerons certes pas ici tous les développements des débats autour de la validité ou non de l’hypothèse de la fuite de laboratoire de l’IVW, puisqu’on trouve aisément de bonnes synthèses dans la presse et surtout dans les textes de Nicholas Wade pour le Bulletin of Atomic Scientists (sic !). Par contre on ne peut que constater combien tout cela s’inscrit parfaitement dans tout le cours de la prolifération biosécuritaire évoquée jusqu’ici. Ce qui permet d’ores et déjà de faire un sort aux accusations de sinophobie ( Chuang parle même d’orientalisme !) lancées à ceux qui soulèvent cette question : les errements de la « recherche préventive » lapidairement décrits ici ne sont certes pas spécifiques à « l’empire du milieu »et il est toujours bon de rappeler que cet institut de virologie et son laboratoire P4 est un pur produit, certes dans des circonstances contrariées, de la prolifération scientifico-sécuritaire à la française, pays qui a également assuré la formation de la désormais fameuse « batwoman » Shi Zhengli dont les recherches étaient en partie financées par le National Institutes of Health américain via l’officine biosécuritaire EcoHealth alliance dirigée par le virologue Peter Daszak qui faisait parti de la mission d’enquête de l’OMS à Wuhan. Les débats quant au fait de savoir si ce financement de « recherches à gain de fonction » répondait aux critères fixés par le gouvernement américain n’a d’ailleurs fait qu’illustrer que ces régulations n’ont, selon l’expression de Alina Chan aucune prise ( « Have no teeth ») réelle sur ce qui se manipule dans les laboratoires.
D’ailleurs personne ne pouvait se leurrer sur ce qui pouvait bien se tramer depuis au moins 2015, avec la publication dans la revue Nature d’un article de Shi Zhengli, du chercheur américain Ralph S. Baric et d’une dizaine d’autres annonçant la création d’une « Chimère virale », version hybridée d’une souche de coronavirus prélevée sur des chauves souris ( probablement dans la mine du Yunnan préalablement évoquée) afin de la rendre plus transmissible chez les souris et de là chez les humains. Les auteurs notaient d’ailleurs comiquement à la fin de leur texte : « La possibilité de se préparer à et de réduire les risques de futures épidémies doit être envisagée au regard du risque de créer des pathogènes plus dangereux. Dans les développement des politiques de recherche à l’avenir, il est important de considérer la valeur des données générées par ces études et si ces types d’études à partir de chimères virales doivent continuer compte-tenu de leurs risques inhérents. » (On pourrait relire ce genre de profession de mauvaise foi à l’aune de l’analyse donnée par Shi Zhengli de la pandémie actuelle : « Le coronavirus 2019 est la nature punissant l’humanité pour avoir gardé des habitudes de vie non civilisées. »)
C’est ce genre de précédents qui ont en tout cas alimenté certains soupçons sur la nature effective du coronavirus, la thèse complotiste de l’arme biologique, ou celle, rapidement réfutée, d’un croisement intentionnel avec le VIH, venant à point nommé, pour le lobby biosécuritaire et ses divers relais, occulter des hypothèses bien moins fantaisistes. Yuri Deigin et Rossana Segretto ont ainsi soulevé, sans la trancher, la question du caractère « chimérique » du Covid-19 dans plusieurs articles dont « The genetic structure of SARS-CoV-2 does not rule out a laboratory origin« . L’un des enjeux principaux sur ce point c’est que comme ils le notent dans « Should-we discount the Laboratory Origin of the Covid-19 ? » : « Plusieurs caractéristiques du SARS Cov-2 prisent ensemble ne s’expliquent pas aisément par l’hypothèse d’une origine zoonotique naturelle. Cela inclut un faible taux d’évolution dans la première phase de transmission [ c’est à dire que le SRAS-COV2 à ses débuts ressemblait beaucoup à son prédécesseur de 2002-2003 tout en se montrant bien mieux adapté aux cellules humaines] ; l’absence de preuves d’une recombinaison virale ; la forte affinité de sa protéine Spike avec les récepteurs ACE2 ; l’insertion d’un site de clivage par la furine (…) » C’est ce dernier point en particulier qui a retenu l’attention car comme le constate Deigin et Segretto : » La site de clivage par la furine confère au SARS-Cov2 une plus grande pathogénicité pour les humains et n’a jamais été identifié dans aucun autre coronavirus. Et dans le même temps des insertions de site de clivage par la furine dans des coronavirus ont été réalisées de façon courante dans des expériences en « ‘gain de fonction ». »
Dans « Retrouver les origines du SARS-CoV-2 dans les phylogénies de coronavirus » Erwan Sallard et ses co-auteurs premettent de replacer dans son contexte cette épineuse question :
« Avant 2002, et bien qu’à l’origine d’épidémies importantes chez les animaux de rente (ou animaux de production), les Coronavirus étaient considérés comme des virus de faible intérêt en santé publique : ils n’étaient principalement responsables que de pathologies bénignes, comme les rhumes saisonniers. Depuis l’émergence du SARS-CoV, en 2002-2003, des études ont testé la possibilité de transfert zoonotique des virus de chauves- souris (Bat-SCoV) chez l’homme et ont tenté d’élucider les processus conduisant à l’émergence de nouveaux pathogènes. À partir du génome de ces virus Bat- SCoV, des virus recombinants potentiellement adaptés à l’espèce humaine ont été construits dans des laboratoires américains et chinois, notamment en remplaçant le RBD de chauve-souris par celui du SARS-CoV humain. Ces expériences ont révélé que l’infection des cellules humaines reste cependant souvent limitée car l’activation de la protéine S nécessite une protéolyse par des protéases exprimées par les cellules de l’hôte, qui est incomplètement réalisée par les cellules humaines pour des virus animaux. Cette difficulté peut néanmoins être contournée en laboratoire en traitant les virus par la trypsine (une protéase), ou en ajoutant, en aval du domaine RBD du génome viral, un site de protéolyse par la furine. Ces manipulations ont été réalisées et on en retiendra que, d’une part, il est possible d’adapter les virus de chauves-souris pour infecter des cellules humaines ou des cellules de différents modèles animaux, et que, d’autre part, les CoV de chiroptères ont un potentiel de transmission zoonotique directe vers l’homme, notamment s’ils acquièrent un site de protéolyse adapté, ce qui ne nécessite que quelques mutations ou l’insertion d’une courte séquence riche en acides aminés basiques. Un facteur aggravant le risque lié aux manipulations génétiques qui produisent des gains de fonction doit aujourd’hui être pris en considération : les progrès spectaculaires des méthodes de biologie synthétique et de génétique inverse réalisés ces 20 dernières années permettent en effet d’assembler, en une dizaine de jours, un génome viral à partir de différents fragments d’ADN synthétisés à partir de séquences d’un ou plusieurs génomes de virus sau-vages. On obtient ainsi un « nouveau » virus en moins d’un mois. »
Si bien évidemment tout cela est difficile à suivre pour le profane, on remarquera que même de fermes opposants à la thèse de la fuite de laboratoire, comme le chercheur Etienne Decroly (ici dans un entretien au journal du CNRS) admettent que la question reste en suspens : « Devant la difficulté à comprendre l’origine de ce virus, nous avons conduit des analyses phylogénétiques en collaboration avec des bio-informaticiens et des phylogénéticiens. Leurs résultats montrent que trois des quatre insertions que l’on observe chez le SARS-CoV-2 se retrouvent chacune dans des souches plus anciennes de coronavirus. Notre étude indique de façon certaine que ces séquences sont apparues indépendamment, à différents moments de l’histoire évolutive du virus. Ces données invalident l’hypothèse d’une insertion récente et intentionnelle de ces quatre séquences par un laboratoire. Reste la 4e insertion qui fait apparaître un site de protéolyse furine chez le SARS-CoV-2 absente dans le reste de la famille des SARS-CoV. On ne peut donc pas exclure que cette insertion résulte d’expériences visant à permettre à un virus animal de passer la barrière d’espèce vers l’humain dans la mesure où il est bien connu que ce type d’insertion joue un rôle clé dans la propagation de nombreux virus dans l’espèce humaine. »
Notons enfin que la découverte toute récente chez des chauves souris au Laos de coronavirus plus proches encore du Covid actuel que la souche présentée (et probablement largement utilisée précédemment dans leurs manipulations) en janvier 2020 par les chercheurs de l’institut de virologie de Wuhan ( voir plus haut) n’a pas permis encore d’élucider le problème comme le note Marc Gozlan sur son blog : » La totalité des sarbecovirus des espèces chauves-souris capturées au Laos (R. marshalli, R. malayanus, R. pusillus) partagent une caractéristique majeure : ils sont dépourvus d’une séquence particulière, dénommé « site de clivage de la furine », que possède en revanche le SARS-CoV-2 et qui joue un rôle majeur dans la fusion entre les membranes virale et cellulaire, ainsi que dans la transmission du virus. (…) Selon les auteurs, il n’est pas impossible que des prélèvements supplémentaires chez des chauves-souris finissent par aboutir à l’identification de souches virales possédant un site de clivage de la furine. On ne peut toutefois exclure d’autres hypothèses, à savoir que ce site de clivage ait été acquis à la faveur de la transmission du virus à un hôte intermédiaire, voire après une circulation du coronavirus passée inaperçue chez des individus ne présentant que peu de symptômes. »
Au-delà de cette question du caractère « chimérique » ou non du virus, on trouvera, dans la presse et dans le texte de Nicholas Wade évoqué plus haut, de nombreuses autres pistes et conjectures sur cette question qui recoupent les inquiétudes habituelles entourant les pratiques quotidiennes des institutions biosécuritaires, ainsi le niveau des normes de sécurité dans le laboratoire P4 de Wuhan qui alarmait depuis un certain temps, ou la possibilité de la contamination d’un employé de l’institut par une chauve souris avancée récemment par un des enquêteurs de l’OMS le docteur danois Peter Ben Embarek… Que cette responsabilité de l’institut de virologie de Wuhan soit un jour établie ou infirmée, elle n’en permet donc pas moins en tout cas d’illustrer, et ce dans tous ses aspects, la trajectoire de la prolifération biosécuritaire de ces dernières décénnies (et le patient zero de cette autre pandémie n’est certes pas né au bord du Yangzi-Jiang !). Mais l’indifférence quasi-générale au « 50-50 » qui entoure désormais cette hypothèse signale aussi fondamentalement une forme d’assentiment, ce qui était malheureusement prévisible au regard de l’immuabilité du consensus étatiste et étatisant que sont notamment parvenus à imposer, à force de matraquage idéologique, etc. , ces « fractions de classe » pour qui l’État est seul horizon car unique prébende.
Cela ne laisse donc pas présager de « retour de bâton » mais, de toute façon, la prolifération biosécuritaire ne manque pas de ressources comme en témoigne une de ses dernières moutures, le paradigme « One Health » (« une seule santé »). La définition officielle (ici sur le site de l’INRA – on ne s’étonnera pas de retrouver, comme à l’habitude, un certain pays en première ligne dès qu’il s’agit de commettre des infamies au nom de grands principes-) est plutôt convenue : « Le concept One Health, c’est penser la santé à l’interface entre celle des animaux, de l’Homme et de leur environnement, à l’échelle locale nationale et mondiale. Cette manière d’aborder la santé dans le contexte mondial actuel de la pandémie liée à la Covid 19, permet de raisonner l’ensemble du système et trouver des solutions qui répondent à la fois à des enjeux de santé et des enjeux environnementaux. » Sauf que bien évidemment, il ne s’agit que d’un faux semblant d’approche « écosyndémique » puisque comme le rappellent Nathalie Porter et Javier Lezaun dans leur passionnant article « Containement and Competition. Transgenic Animals in the One Health Agenda » : « L’émergence de l’agenda « One World, One Health » (OWOH) coïncide avec l’essor d’approches alternatives de la gestion de rapports humains-animaux : la manipulation génétique des animaux pour réduire leur capacité d’être des vecteurs ou des hôtes de pathogènes humains. (…) Les modifications génétiques promettent une forme d’évolution animale dirigée, qui épargnerait aux humains d’avoir à changer leurs comportements afin de prévenir les maladies. »
L’issue de cette nouvelle vague de manipulations est bien sûr grotesquement prévisible : » Du fait de sa perspective obtue, la solution transgénique est donc aveugle aux dynamiques interspecistes qui vont probablement émerger des interventions biotechnologiques et néglige les nouvelles cascades parasitaires que l’arrivée d’une nouvelle vie génétiquement modifiée risque de provoquer. (…) La promesse du fix transgénique est en fait d’établir un périmètre d’isolement au sein de l’organisme de l’hôte ou du vecteur. Le principe n’est pas de contenir l’activité humaine mais plutôt de l’étendre et de la rendre incontrôlable ». Bref « les animaux génétiquement modifiés seraient moléculairement adaptés à l’anthropocène. » Le fameux Aedes aegypti dont les ravages sont bien connus est semble-t-il le cobaye préféré de cette nouvelle vague de bidouillages mais l' »International Barecode of Life » ne devrait pas manquer de continuer à ouvrir de passionants horizons, comme la re-création d’espèces disparues qu’on nous annonce depuis deux décennies déjà… « Une seule santé » disent-ils mais qui s’appuiera donc sur une « seconde nature », modifiée ou générée en laboratoire et le contrôle tatillon et permanent de ce qui reste de « vie sauvage » ( voir à ce sujet, en attendant mieux, l’insuffisant livre de Nathanael Rich Second Nature. Scenes from a World Remade). Et pour les humains, le « deep mutational scannning« , nouvelle étape de l’évolution préventive qui permettra de prévoir en amont les mutations virales, offrira la possibilité de « Protéger les gens en programmant leur système immunitaire contre de futurs pathogènes et non seulement contre ceux qui circulent; cela constituerait un tournant fondamental dans le sens, la mission et l’éthique de la vaccination » ( Predict and Survive in The Economist 07/08/21). On n’est effectivement jamais trop prudent, surtout vu l’ampleur que semble prendre une autre prolifération, le biohacking, où de simples quidams peuvent opérer leurs propres bidouillages génétiques ou autres dans leur cuisine grace à la démocratisation de la technique de modification du génome CRISPR-Cas ( voir l’édifiant article « The Rise of the Biohacker » in FT 22/09/2021). C’est certes presque indéfiniment que s’énumérent ces calamités qui se mijotent plus ou moins délibéremment…
Bref pour conclure et reprendre les termes de l’alternative un peu grossière qui chapeaute cette serie de textes, la crise du covid pourrait effectivement constituer le signe d’une crise d’époque, particulièrement si on prend en compte l’hypothèse qu’un secteur technoscientifique de pointe de ce mode de production a éventuellement généré une pandémie dont le bilan tutoiera peut-être celui de la grippe espagnole. La « guerre préventive aux microbes » et l’obsession de contrôle du vivant menant donc à une forme sans précedent historique de retournement « non militaire » de l’activité humaine contre elle-même. Certes comme disait Nietzsche « En temps de paix, le belliqueux s’agresse lui-même. » ( Par-delà bien et mal) ! Mais on peut tout autant y voir un acccident de parcours nécessaire et les prolégomènes d’une possible transition sous l’égide d’une nouvelle organisation capitaliste de la nature qu’incarneraient notamment, et ce coup-ci effectivement, les biotechnologies et leur appendice biosécuritaire. Cette transition ne se déroulant bien évidemment pas sur le mode joyeusement inéxorable et progressiste qu’elles nous vantent mais plutôt au rythme de la progression des désastres que sous pretexte de prévenir, etc. De toute façon, la question ne sera pas tranchée sur une paillasse de laboratoire et l’analyse critique de ces proliférations technoscientifiques, de leur trajectoire historique et de leurs déterminants sociaux, est donc plus indispensable que jamais. Et ce dans bien des secteurs, comme nous tacherons de l’illustrer dans le prochain post sur l’aquaculture…