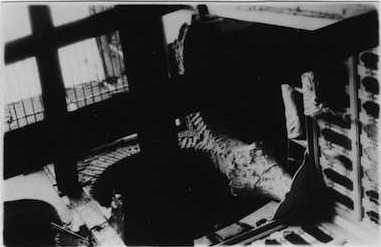On peut difficilement clore ces quelques notes sur les « racines pré-coloniales » de l’autogestion et aborder le rapport de cette dernière à la décolonisation en Algérie mais aussi ailleurs, sans mentionner les analyses en termes de segmentarité et les critiques qui en ont été faites.
La définition donnée par Jeanne Favret Saada dans son article « La segmentarité au Maghreb » repris dans Algérie 1962-1964. Essais d’Anthropologie politique nous a semblé la plus éclairante : » La segmentarité constitue la stratégie politique de groupes tribaux soucieux d’éviter, autant que possible, l’emprise de l’État. (…) Ce qui unit une tribu nord-africaine selon Ernest Gellner [dont les études sur le Maroc ont été fondatrices des analyses segmentaires du Maghreb] c’est d’abord la volonté d’autonomie vis à vis du pouvoir central. Ce choix essentiel de la marginalité -politique sinon culturelle- est renforcé ou rendu possible par une organisation fondée sur le principe de segmentarité, l’opposition équilibrée des groupes tient lieu d’institutions politiques spécialisées, dont on ne trouve d’ailleurs pas la trace au Maghreb (…) La segmentarité est ici la conséquence de l’état de dissidence dans lequel vivent les tribus et l’on peut exprimer son principe en contrariant l’adage : » Divisez-vous pour ne pas être gouvernés ». » Ou encore via ce proverbe arabe (cité par Favret-Saada) : » Moi contre mes frères, mes frères et moi contre mon cousin, mes cousins, mes frères et moi contre le monde ».
Il est intéressant d’évoquer longuement l’expérience qui a mené Favret Saada à privilégier une analyse en terme de segmentarité de la société algérienne. En effet comme elle le relate dans son introduction à Algérie 1962-1964 : « En 1963, Mohammed Harbi, conseiller à la présidence de la République, me propose d’étudier avec mes élèves le fonctionnement démocratique des comités ruraux d’autogestion. Un laisser-passer du Président nous donne autorité pour rencontrer qui nous voulons, depuis les sous-préfets jusqu’aux ouvriers saisonniers. Par groupe de trois, nous visitons quantité de fermes, toujours selon le même scénario. Le jour de notre arrivée, les responsables nous parlent, tandis que les ouvriers, muets, nous observent intensément. Le lendemain, nous nous mettons à les questionner, sans privilégier les responsables. Le soir, les mécontents nous prennent à part : l’histoire du domaine, après le départ précipité des Européens l’été 1962, surgit dans sa brutalité. Bien que nous évitions avec soin de jouer les cowboys, nous sommes souvent pris pour les justiciers que le peuple attendait. En quelques jours, les petits arrangements locaux explosent d’eux-mêmes, des notables de l’administration ou de l’armée s’agitent, des comptes commencent à se régler sous nos yeux, y compris de façon violente. Nous visitons aussi, évidemment, des exploitations gérées par une équipe honnête et qui a su créer un consensus, mais elles sont le plus souvent en train de succomber aux chimères du regroupement administratif ou aux appétits des big men régionaux. »
Avant de rentrer en France, Jeanne Favret Saada remettra son rapport à Harbi, rapport dont l’unique exemplaire se perdra dans les convulsions du coup d’État de 1965, Catherine Simon revient d’ailleurs sur cette histoire dans un chapitre, « L’étude perdue de Jeanne Favret-Saada : un constat inaudible », de son livre Les années pieds-rouges. Quoique le document ait disparu, Favret-Saada en résume (toujours dans son introduction à Algérie 1962-1964) la teneur : « Ce rapport est pessimiste : sauf exception, la « réorganisation démocratique » des comités d’autogestion ruraux n’a pas eu lieu. Non que les travailleurs, dans leur ensemble, aient manqué de sens des responsabilités ou d’initiative. Mais ils étaient peu appuyés et fort mal informés par ceux qui étaient chargés de les aider à s’organiser ; les cadres, même ceux qui sont honnêtes et consciencieux, se comportent comme des bureaucrates autoritaires. Pour finir, les terres héritées des Français sont devenues, trop souvent, la possession privée d’un potentat local, ancien officier de l’ALN ou chef de l’administration. »
Un fois de l’autre côté de la Méditerranée, elle se demande que faire des matériaux réunis lors de son travail sur le terrain et se tourne vers les travaux de Ernest Gellner mais aussi de Clifford Geertz. Ce dernier a, dans un article de 1963, « The Integrative Revolution : Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States », théorisé le fait que dans « les nouveaux États [ issus de la décolonisation] sont sujets de façon anormale à une sérieuse désaffection fondée sur des attachements primordiaux. (…) C’est le processus même de formation d’un État civil souverain qui, parmi d’autres facteurs, stimule les sentiments d’esprit de clocher, de communautarisme et d’identité raciale, etc car il introduit dans ces sociétés un nouveau butin à convoiter et se disputer et une nouvelle force menaçante qu’il faut désormais prendre en compte. » Ernest Gellner dans son article de 1962 sur le Maroc « Patterns of Rural Rebellion in Morocco: tribes as minorities » allait déjà dans le même sens en analysant les insurrections tribales qui ont accompagné la décolonisation du pays , » cette étrange récurrence d’insurrections rurales depuis l’indépendance, avec leur effondrement rapide et leurs suites – relativement-clémentes. La bataille nationale n’a pas encore eu lieue, et en attendant qu’elle se déroule, ces petites répétitions générales rurales, ces exercices d’échauffement du patronage se déroulent avec un certaine retenue : une petite éruption, et ensuite tout le monde guette les réactions, l’état des forces en présence est analysé, comme aux échecs et la partie la plus faible se soumet de façon civilisée – pour le moment. Il est donc faux de voir dans ces soulèvements un retour atavique à l’indépendance tribale : ils sont bien plutôt l’inverse, une façon de participer au jeu national. » Ou comme le résume Favret Saada : « L’accession à l’indépendance provoque souvent la renaissance des divisions politiques traditionnelles : les citoyens sont provisoirement incapables de concevoir leur appartenance à un État abstrait, sans traditions historiques, autrement que par la participation à des groupes plus immédiats ( ethniques, religieux, linguistiques). Si bien que l’exaltation des sentiments primordiaux est une conséquence inattendue mais pas nécessairement dysfonctionnelle pour l’unité de l’État- de l’accession à l’indépendance. »
Il faudrait de surcroît lire ce « revival « de structures « pré-coloniales » tout autant à l’aune de la période coloniale que du moment immédiatement « post-colonial » : » On est ici en présence d’un type particulier de traditionalisme, celui d’une société sous-développée qui a été si fortement exposée aux idéaux et aux réalités économiques de la société industrielle qu’elle en a perdu son identité ; ses institutions traditionnelles ne servent plus les fins qui ont présidé à leur création : elles sont désormais un moyen d’attirer à soi, ou d’attendre, la modernisation. » (Favret-Saada « Le traditionalisme par excès de modernité » reproduit dans le recueil Algérie 1962-1964)
C’est surtout ce pan des analyses segmentaires qui nous intéresse et on pourrait d’ailleurs probablement dégager les signes d’une dynamique « triangulaire » voisine ( la relative vacance de départ puis la lente consolidation post-coloniale de l’État facilitant le revival ou la perpétuation des structures pré-coloniales et/ou coloniales ) dans différentes phases de l’histoire de l’autogestion agricole algérienne. Ainsi dans l’initiative spontanée et souvent défensive de remise en marche des exploitations par les ouvriers agricoles ( « L’essentiel est d’occuper les places. Par un réflexe d’autodéfense, les ouvriers permanents font barrage à ceux, combattants, militants, saisonniers qui profitant de l’incertitude, tentent de s’installer dans les domaines » Serge Koulitchisky L’autogestion, l’homme et l’État), dans le maintien tant des structures coloniales de travail ( » Dans les premières années de l’indépendance, l’autogestion a été réduite à n’être qu’un système de gestion chargé de remplacer la gestion par le colon. Le pouvoir reconnu théoriquement aux travailleurs a été exercé par les contremaîtres. Ce système oligarchique a pu maintenir à peu près la potentiel de production des fermes (..) en se substituant aux patrons sans modifier les relations sociales internes au domaine (…) L’institution mise en place sous le nom d’autogestion avait conservé le patrimoine. Elle n’avait pas résolu les contradictions de cet héritage, ni libéré les hommes. » Claudine Chaulet, La Mitidja Autogérée) que sociales traditionnelles ( « Rapport avec l’État, relations hiérarchiques dans le travail; solidarité familiale l’emportant en général sur toute autre forme de solidarité ; maintien des traditions même si elles sont économiquement négatives ( coût du mariage) ; place et fonction des femmes ; tout indique qu’aucune nouvelle vision n’a pénétré le secteur autogéré qui, sur le plan théorique du moins, implique une relation nouvelle à l’égard du travail, de l’État et du monde. » Chaliand et Minces, L’Algérie indépendante). Le tout débouchant sur l’émergence, certes progressive et décentralisée, d’une nouvelle « classe dominante » dans les campagnes, issue tant des vieilles hiérarchies pré-coloniales ( claniques, tribales), coloniales ( les contremaîtres) que post-coloniales ( les bureaucrates et anciens combattants de l’ALN) : « La nature autoritaire, népotique et corrompue de certains comités de gestion n’était pas le résultat d’une manipulation délibérée de l’administration. Elle était le produit des superstructures sociales et culturelles de la société coloniale pré-existante. Celles-ci, soit basées sur l’économie rurale traditionnelle ou sur le capitalisme colonial, se maintenaient dans l’Algérie post-coloniale car le fait de l’indépendance en tant que tel n’était pas suffisant pour changer le mode dominante de valeurs. » (Ian Clegg Worker’s Self-management in Algeria).
Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad dans Le déracinement. La crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie ont plus spécifiquement souligné l’imbrication paradoxale entre tradition et modernité qui selon eux gouvernait la vie des ouvriers agricoles dans les grandes exploitations coloniales et qui se serait perpétuée dans l’indépendance : « Les ouvriers agricoles qui vivaient sur le domaine même du colon trouvaient dans le dédoublement une manière d’échapper à la contradiction qui découlait inéluctablement de leur participation à deux univers étrangers : les mêmes qui, chauffeurs de tracteur, tailleurs de vigne ou maraîchers, travaillaient les terres du colon selon les méthodes de travail les plus rationalisées et avec les techniques les plus modernes, revenaient, pour la culture des lopins que leur cédait le colon aux confins de son domaine, aux usages agraires les plus traditionnels (…) Nul ne songeait à faire intervenir dans son activité de fellah’ les préoccupations de l’ouvrier agricole et, par exemple à s’inquiéter de la relation entre la quantité ou la qualité de l’effort fourni et le produit du travail.(…) Ce dualisme s’exprimait dans tous les domaines de l’existence, qu’il s’agît de la vie religieuse, des loisirs ou des échanges matrimoniaux : un îlot de traditionalisme pathologique, c’est à dire excessif et decontextualisé, se trouvait transporté au coeur même du domaine de l’agriculture capitaliste, hautement mécanisée et rationalisée. » Et après la fuite du colon : » Installés sur des terres riches, pourvus des moyens de culture les plus modernes, ils étaient invités par toute la situation à adopter les fins ultimes qui s’y trouvaient inscrites et à rechercher, par exemple, la rentabilité et la productivité ; mais cela n’était pas assez pour les déterminer à un reniement total des fins et des valeurs traditionnelles. Trop mal assurés d’eux-mêmes et de leur situation pour choisir, ils agissaient comme s’ils voulaient cumuler les avantages des deux systèmes, en sorte qu’on les voyait poursuivre des fins traditionnelles par des moyens modernes, ou, inversement, poursuivre des fins modernes avec des moyens traditionnels. » On trouverait une synthèse contrariée similaire lors de la réforme agraire des années 70 et sa création de « villages socialistes » : » Ce mode de groupement des attributaires de la réforme agraire semble assez bien correspondre aux habitudes et aux aspirations des paysans algériens dans la mesure où il respecte le principe de l’individualisation des parcelles ( principe que la colonisation française a ancré dans les mentalités) tout en conservant les modes communautaires de mise en valeur qui eux correspondent à un passé plus ancien ( indivision). » ( Martine Camacho, « La paysannerie algérienne, l’autogestion et la révolution agraire »). Bien entendu tout cela a un petit parfum « d’inexorable post-festum » que tout ce site cherche certes, à sa modeste échelle, à démentir…
Quoique inscrivant les phénomènes étudiés dans le champ de force spécifique de la décolonisation, c’est pourtant parfois une forme d’inertie dans le conflit ou du moins d’équilibre dynamique de ces « sociétés contre et avec l’État » que semblent postuler les analyses segmentaires, ainsi chez un de leurs tenants contrariés, Pierre Bourdieu qui sans jamais citer le concept n’en s’en rapproche pas moins dangereusement : « Différents traits inclinent à croire que les conflits entre les lignées revêtaient une forme institutionnelle et que les combats ressortaient de la logique du jeu rituel plutôt que de la guerre proprement dite. Cette « organisation dualiste » garantit par une étrange et obscure pondération, un équilibre assuré par la crise elle-même. Les forces s’opposent, se composent, se compensent. Tout se passe comme si l’équilibre était recherché dans la plus grande des tensions. » ( Sociologie de l’Algérie) C’est notamment cette immuabilité supposée que vont attaquer certains critiques de la « segmentarité ».
Nous nous évoquerons principalement ici la critique développée par René Galissot dans un article de 1978, « Au Maghreb : sociétés segmentaires et violence politique. Critiques des interprétations par la segmentarité : rapports d’exploitation et reproduction sociale. » La critique de Galissot commence bille en tête et de façon pour le moins acerbe : » les techniciens de la colonisation (…) pratiquaient la segmentarité sans le savoir, en manipulant les éléments de division des groupes qu’ils avaient à contrôler. Ces sont quelques uns d’entre eux, officiers et administrateurs à tête pensante, qui entreprirent de théoriser cet art de circonscrire les sociétés (…) Par méchanceté, je pourrais dire que les théories de la segmentarité cherchent à donner un statut scientifique à la pratique des affaires indigènes ; mais elles ont très bien traversé l’indépendance et évoluent vers une systématisation d’explication de l’organisation sociale maghrébine à fond tribal, par la prééminence du lignage. » Tout cela étant motivée par une forme d’idéalisation/essentialisation d’un « fait tribal » qui semble coupé de toute influence extérieure : « Le vice de fond de toute systématisation segmentaire est de prendre la partie pour le tout : l’explication absorbe dans le modèle par idyllisme démocratique, par hyperbole de la parenté, par satisfaction de fonctionnalisme politique, par culte de l’éternel retour (…) Or qu’elles qu’elles soient, les sociétés dites segmentaires n’existent que dans un lieu de relations économiques et culturelles, un champ de pouvoir qui les débordent, pour ne rien dire des contradictions internes d’inégalités sociale et des hiérarchies de puissance qui sont dissimulées sous les apparences de solidarité lignagière et le jeu des alliances (…) La complaisance idéalisante tient à l’illusion démocratique que l’on place dans les sociétés traditionnelles, préservées de l’éthique de la ville moderne et de la perversion capitaliste. La djemaa est exaltée en assemblée libre ; les sociétés segmentaires seraient autogestionnaires par leurs équilibres familiaux qui modèrent l’appropriation , par leur régulation des échanges. en réciprocité, par la force des alliances (…) L’approche idyllique révèle une étonnante méconnaissance des contraintes collectives et des rapports de dépendance dans les campagnes ( et en pays montagnard) quelles que soient les compensations communautaires. »
Et ce ne serait non pas du fait de caractéristiques absolument intrinsèques mais bien d’une forme spécifique de pénétration capitaliste que ce sociétés sont en quelque sorte devenues « segmentaires » : « Le mouvement de domination capitaliste puis coloniale fabrique de l’ethnographie en instituant des sociétés enclavées, en rendant les formations socio-politiques prisonnières de leur espace tribal (…) La pénétration capitaliste, qui n’est pas seulement monétaire, fait son chemin à l’intérieur, quand ces sociétés sont exclues des liaisons extérieures et à plus forte raison des centres d’initiative, fondamentalement des chances d’accumulation mercantiles ; elles deviennent non-capitalistes en conservant ou plutôt en dégradant, voire en archaïsant leur fonctionnement social, mais en étant comprises dans la mouvance capitaliste. Les sociétés dites segmentaires sont d’abord des sociétés enclavées ; les rapports de parenté n’y prennent une place majeure que par coupure des relations socio-politiques, par disqualification ou sclérose des formes organiques plus larges. »
A cette réinscription dans un cours historique plus général, on peut ajouter les critiques plus récentes que recensent Mohammed Hachemaoui dans « Y a-t-il des tribus dans l’urne ? Sociologie d’une énigme électorale (Algérie) » . Après avoir lui aussi donné sa définition de la segmentarité : « La théorie présente la morphologie tribale comme une société « acéphale », « égalitaire », composée de « segments lignagers » en opposition complémentaire. », il résume certaines des critiques qui lui ont été faites : » : l’oubli du gouvernement central ; la négligence de la hiérarchisation statutaire des familles et des positions de domination; l’hétérogénéité et la démultiplication des lignages; le caractère labile et conjoncturel des alignements tribaux ; la non prise en compte de la culture dans la compréhension du fait tribal. » De fait, la trajectoire de ce « fait tribal » dans l’Algérie indépendante dément l’allure « inoxydable » et « autogène » que semblent lui prêter les analyses en termes de segmentarité. On trouvera dans les différents textes de Yazid Ben Hounet un panorama complet de cette trajectoire. Dans « Gérer la tribu ? Le traitement du fait tribal dans l’Algérie indépendante (1962-1989) » il rappelle que si « l’État Algérien s’est constitué sur les ruines de la tribu » cela n’empêchait pas une instrumentalisation occasionnelle : » si la tribu était vue comme une organisation archaïque, on n’hésitait pas à valoriser parfois l’organisation tribale en la présentant comme un système social égalitaire et solidaire » Ainsi on n’hésite pas à « la réactiver soit pour disqualifier des mouvements de revendications — comme ce fut le cas en Kabylie, durant le printemps berbère (1980) ou encore peut-être dans une certaine mesure en 2001 —, soit pour faire l’apologie de certains traits de la culture des tribus et des zawiya, comme ce fut le cas durant la réforme agraire à partir de 1976 ou au début des années 1990, pour endiguer la montée du FIS ». Dans sa contribution au recueil La constante « Tribu » , intitulée « Algérie : la tribu pour horizon politique ? » il rappelle que si » La tribu demeure encore un horizon politique, idéel ou réel, fantasmé ou non, critiquable ou non. » « La réactivation de l’argument de la tribu apparaît en particulier dans des contextes politiques de transition, pour asseoir les formes de mobilisation collectives, leur donner une légitimité. L’évocation de la tribu fonctionne alors à la fois comme justificatif du bien-fondé de l’action collective – en l’inscrivant dans le registre des bonnes traditions tribales- et de son potentiel mobilisateur – puisqu’elle repose sur des liens considérés comme pérennes et primordiaux, en somme fiables. » Précisons qu’on trouvera dans le Chapitre VI « De Tafsut Imazighem au printemps noir » de Dissidences algériennes un panorama complet des positions variées de l’extrême gauche algérienne sur cette question à la fin du XXe siècle… Cette plasticité, du moins souplesse fonctionnelle de la référence tribale s’est bien entendu encore manifestée lors de la révolte de 2001 en Kabylie avec la création de la coordination des aârouch : « Si cette coordination est loin d’opérer selon un mode tribal, que ce soit au niveau de son organisation interne ou de ses revendications – la mention de la tribu ne fut proposée que par quelques représentants – il est tout de même intéressant d’observer que la mention des tribus (‘arûsh) fut acceptée dans la dénomination de la coordination, et qui plus est comme premier élément de dénomination. Comme si l’usage du terme permettait de légitimer davantage l’emprise de ce mouvement au niveau local. » ( « Algérie : la tribu pour horizon politique »).
C’est ce que souligne également Mohammed Hachemaoui dans « Y a-t-il des tribus dans l’urne ? Sociologie d’une énigme électorale (Algérie) » qui parle d’un « tribalisme sans tribu » résultant de « L’inanité de la tribu en tant que « communauté exerçant une souveraineté sur un territoire » et d’autre part l’efficacité du tribalisme en tant que discours social et mode d’identification » Ou donc, du côté du pouvoir et de ses affidés comme moyen de disqualification des mouvements de contestation ou au contraire d’articulation « systémique » : « Trois répertoires performatifs, gouvernés par des logiques de concurrence et d’hybridation, sont à l’œuvre dans cette fabrique du politique : au tribalisme d’offrir la grammaire du lien de solidarité et la représentation de la société idéale; au clientélisme d’instaurer un échange social entre inégaux et un mode de régulation de la rareté ; à la corruption électorale de combler, par les libéralités et l’achat des voix, les déficits de régime des deux premiers. Le tribalisme représente, pour les candidats à la députation, le mode d’allégeance et de solidarité culturellement le plus ancré pour affirmer leur prétention à la représentation. Ces derniers ont toutefois besoin, pour contourner les effets de la désagrégation de la tribu et de l’autoritarisme électoral, de mobiliser d’autres ressources : le patronage, qui du pouvoir central, qui des puissances d’argent. Le tribalisme, en tant qu’idéal de structure hiérarchique et de contrôle social, représente pour les groupes du centre — qui sont soucieux de la résilience d’un « régime à pluralisme limité, non responsable et sans idéologie directrice élaborée ni volonté de mobilisation intensive ou extensive » —, un dispositif de contrôle, un répertoire de revendication non programmatique et un mode d’intégration des groupes sociaux dans le système. » N’en déplaise aux laudateurs ou pourfendeurs des structures « archaïques », ces reconfigurations post-coloniales du « fait tribal » semblent donc surtout on ne peut plus « modernes ». Notamment si on en juge par l’obsession récente de la science politique américaine pour la « tribalisation » de la société états-unienne avec ses tribus cachées et ses inquiétants effets anthropologiques : éternel retour tout autant social, politique qu’académique de l’essentialisation organiciste.
Notons pour conclure que si les théories segmentaires permettent entre autre d’approcher de façon originale et pertinente le premier « moment post-colonial« , il ne faut pas oublier de lire aussi celui-ci à l’aune du champ de possibilités qu’il représentait, ce dont a témoigné, malgré ses multiples contradictions, l’autogestion algérienne…