Le mouvement des gilets jaunes est parvenu, à ses débuts, à mailler assez précisément le territoire, ce qui soulignait l’ampleur et la profondeur de la mobilisation et le rôle joué dans la préparation de celle-ci par les réseaux d’interconnaissance et de solidarités locales. C’est d’autant plus frappant que ces derniers ont été, comme on le sait, largement mis à mal ces dernières décennies particulièrement dans le monde rural et ce tant pour l’ex-paysannerie que pour les ouvriers. Une revue de littérature sur un concept devenu courant dans la sociologie française, le capital d’autochtonie, c’est à dire « l’ensemble des ressources que procure l’appartenance à des réseaux de relations localisées », permet d’aborder, pour le monde rural, au delà des banalités habituelles ce rapport entre ancrage local et identité de classe, et sa crise, dont cette révolte témoigne probablement à sa manière.
La chasse et les nouveaux venus
Si le terme d’autochtonie vient de la Grèce antique ( les autochtones sont ceux qui sont nés de la terre, c’est à dire les athéniens pure souche seuls aptes à gérer les affaires de la cité), c’est dans le cadre d’une étude des évolutions de la chasse en France que Jean-Paul Chamboredon a réactualisé le concept. Dans le contexte d’une dépaysanisation/ deruralisation qui s’accélère à partir des années 50, la pratique traditionnelle de la chasse et les usages du territoire qu’elle suppose sont mis à mal. Dans le conflit entre deux conceptions de la nature et du territoire, l’une moderne et urbaine et l’autre traditionnelle et paysanne, l’affirmation d’une autochtonie, de l’ancienneté de l’ancrage dans un territoire devient alors un moyen de se défendre contre les « étrangers », écologistes ou promeneurs, qui viennent remettre en cause les usages traditionnels de la nature. Chamboredon note d’ailleurs que la chasse devient même « un domaine d’expression de valeurs menacées dans les autres sphères de l’existence ». Bien des années plus tard, Julian Mischi constate également dans son article « Protester avec violence. Les actions militantes non conventionnelles des chasseurs » que « la chasse permet d’exprimer une relation particulière au terroir villageois comme compensation à la dépaysanisation. », « l’appropriation du territoire » devenant « l’envers de la dépossession sociale. ». On sait que la dislocation de la paysannerie, qui ne s’est pas faite sans douleur dans un pays où elle s’est si formidablement défendue depuis 1789, a mené à une dépossession bien particulière que Pierre 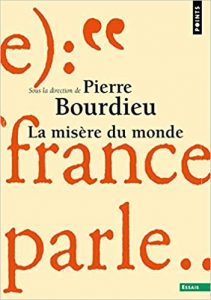 Bourdieu résumait joliment dans La misère du monde : « Ils sont un peu dans la situation de kolkhoziens qui auraient financé leur propre kolkhoze. Les aléas des décisions politiques de l’État ou des instances communautaires, plus lointaines encore, commandent directement leurs revenues, parfois leurs décisions en matière d’investissement productifs de manière aussi brutale et imprévisible que le faisaient en d’autres temps (..) les aléas du climat et les calamités naturelles. » La définition par le même Bourdieu de la paysannerie comme « classe objet », « contrainte de former sa propre subjectivité à partir de son objectivation » prend une allure d’autant plus cruelle que la modernisation a supposé une reniement ( « Tout se passe comme si les fils des paysans ne pouvaient ou n’acceptaient de rester à la terre qu’à la condition de nier le statut de paysan et de renier les valeurs paysannes et leur appartenance au groupe villageois. » P. Champagne) qui n’est finalement payé en retour que par un « agribashing » « spirale dépréciative », dans laquelle la société est passée de « l’indifférence au dénigrement » ( Bertrand Valiorgue & Thomas Roulet « Malaise dans l’agriculture française »).
Bourdieu résumait joliment dans La misère du monde : « Ils sont un peu dans la situation de kolkhoziens qui auraient financé leur propre kolkhoze. Les aléas des décisions politiques de l’État ou des instances communautaires, plus lointaines encore, commandent directement leurs revenues, parfois leurs décisions en matière d’investissement productifs de manière aussi brutale et imprévisible que le faisaient en d’autres temps (..) les aléas du climat et les calamités naturelles. » La définition par le même Bourdieu de la paysannerie comme « classe objet », « contrainte de former sa propre subjectivité à partir de son objectivation » prend une allure d’autant plus cruelle que la modernisation a supposé une reniement ( « Tout se passe comme si les fils des paysans ne pouvaient ou n’acceptaient de rester à la terre qu’à la condition de nier le statut de paysan et de renier les valeurs paysannes et leur appartenance au groupe villageois. » P. Champagne) qui n’est finalement payé en retour que par un « agribashing » « spirale dépréciative », dans laquelle la société est passée de « l’indifférence au dénigrement » ( Bertrand Valiorgue & Thomas Roulet « Malaise dans l’agriculture française »).
Et si la première « restructuration de l’espace villageois » décrite par Patrick Champagne dans son article éponyme, semble en tout cas achevée sous les coup de boutoir des agriculteurs eux-mêmes, de la désertification, de la mécanisation, de la fin des réseaux d’entraide et de leur remplacement par un nouveau régime de dépendance aux banques et aux marchés mondiaux, c’est toutefois un autre type de transition, aux effets encore inconnus qui se prépare, avec le repeuplement accéléré des campagnes tant par les classes moyennes que par des fractions paupérisées (dans les régions où le foncier est encore bon marché). « Pendant très longtemps, les agriculteurs ont occupé de manière majoritaire et dominante les territoires ruraux. Ils étaient maîtres du territoire et n’avaient pas à se soucier des conditions de frontières et de cohabitation avec les autres habitants. Ils dominaient. Les rapports sont désormais inversés ou en passent de l’être et les agriculteurs constituent des minorités banalisées dans ce qu’ils ont longtemps considéré comme des fiefs imprenables. » ( Valiorgue & Roulet)
L’effet de ces nouvelles interactions et de leur rythme – nous avons pu constater par nous mêmes que les remplacements des autochtones décédés par des nouveaux arrivants extérieurs à la région est parfois très rapide, même dans des coins isolés – a été assez justement évoqué par plusieurs sociologues dans un tribune parue dans le journal Le Monde intitulée « En Picardie, ces solitudes qui se tournent vers le Front national » : « Il faut ré-encastrer les votes frontistes dans leurs contextes sociaux : des contextes de raréfaction des pratiques collectives, de déstabilisation des entre-soi ruraux et de dévaluation des pratiques autochtones. S’effondrent tous les lieux qui garantissaient une sécurité et une prévisibilité des échanges sociaux, qui généraient l’estime de soi, la réputation locale et une définition solide de son identité propre. Au final, ne reste plus d’autre » identité positive » disponible que nationale : » être français « .(…) Parfois, ces ruraux abandonnés ont, en outre, à cœxister avec de nouveaux arrivants néo-ruraux mieux lotis : des cadres ou techniciens fuyant les villes, qui rachètent des pavillons ou des bâtiments de ferme pour leur » caractère » et leur prix. Le vote FN se nourrit aussi de cette proximité sociale neuve et du désenclavement culturel (partiel) qui s’engagent dans des inter-actions qui dévalorisent, et que » les gens d’ici » ne sont pas sûrs de maîtriser : ce que traduisent toutes les stratégies d’évitement des nouveaux résidents. Le » on est chez nous » exprime haut et fort cette insécurité. Ces votes Le Pen ne vont pas disparaître miraculeusement. » ( Willy Pelletier, Emmanuel Pierru et Sébastien Vignon, Le Monde 27/05/19)
Cet enjeu de la coexistence entre les classes pourrait sembler bien subsidiaire, il pourtant constamment sollicité pour expliquer les trajectoires résidentielles et ségrégatives en france comme ailleurs et il ne manque pas d’avoir des effets sur les questions de logement et de pouvoir local.
Le pouvoir local
Dans une très utile présentation de l’histoire du concept ( « Classes populaires et capital d’autochtonie. Génèses et usages d’une notion ») Nicolas Rehany souligne que l’autochtonie représente un « poids social permettant de se positionner sur différents marchés (politique, travail, matrimonial et associatif) ». Or c’est justement ces différents « marchés » qui ont vu des évolutions importantes ces dernières décennies. Ainsi pour le logement, selon Jean-Noël Retière : « Alors que l’accès au logement passait naguère fréquemment par la cooptation (capital d’autochtonie) et obéissait aux logiques de l’interconnaissance, le prix du marché a eu pour effet de monopoliser entre les mains des agences immobilières et des notaires la tractation qui, il y a peu de temps encore, pouvait échapper à l’anonymat du rapport d’argent. Ceci est une illustration de plus du processus d’obsolescence du capital d’autochtonie. » ( « Autour de l’autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire »). Ce constat doit tout à la fois être complété par l’essor des annonces immobilières par internet qui draine de nouvelles populations et être tempéré par le rôle important joué par les élus dans l’attribution des logements sociaux et des permis de construire voire des zones à bâtir. Ce qui permet le développement de logiques clientélaires, et donc le recours à un éventuel capital d’autochtonie, ainsi que d’éloigner les indésirables ( voir Violaine Girard « Un peuplement au-dessus de tout soupçon ? Le périurbain des classes populaires blanches. ») Or c’est du côté des élus qu’une mutation importante s’est produite. En 25 ans la proportion d’agriculteurs parmi les 500 000 élus locaux du pays a baissé de 57%, celle des commerçants de 50% celle des notaires et des médecins dans des proportions équivalentes, tandis qu’explosaient littéralement le nombre d’élus retraités ( +83%) et employés (+80%) et que la part des salariés de la fonction publique prenait une importance toujours plus croissante. On évoque souvent la plus grande « expertise » demandées aux élus municipaux, du fait notamment de la décentralisation (« La décentralisation devait, selon ses promoteurs, rapprocher les élus des citoyens. Elle n’a fait que les en éloigner socialement. » Michael Kobel « Les élus municipaux représentent-ils le peuple ? » Texte dont nous tirons les chiffres précédemment cités) et du développement de l’intercommunalité. Mais la déstructuration du groupe paysan, la disparition des quelques rares enclaves où les ouvriers étaient majoritaires dans le groupe municipal ont aussi ouvert la voie à ce que deux auteurs ont appelé l’accession au pouvoir de la petite bourgeoisie (Bruneau et Rehany « Une petite bourgeoisie au pouvoir. Sur le renouvellement des élus en milieu rural. » ). Celle-ci est en général datée de 1977 lorsque lors des élections municipales on assista à « une poussée très forte des fonctionnaires et agents publics parmi les nouveaux maires (7,35% en 71, 19,31% en 77) qu’ils améliorent en 83 et en 89 faisant plus que tripler leur position de 1971. » ( Marie-Françoise Souchon Zahn « Les nouveaux maires de petites communes. Quelques éléments d’évolution (1971-1989). »)
La fin d’un couple
Cette évolution est d’autant plus marquante que comme le rappelle Julian Mischi (« Ouvriers ruraux, pouvoir local, conflit de classe »), les ouvriers sont « le premier groupe social dans les campagnes françaises, (ils) sont aussi proportionnellement plus nombreux dans les territoires ruraux que dans les grandes villes. ». Pourtant sur les 500 000 élus locaux on ne compte que 803 ouvriers en 2008. Le déclin inexorable du « communisme municipal » y compris dans ses bastions ruraux ou semi-ruraux y est probablement pour beaucoup mais celui-ci est également à relier à « la progressive dissociation des scènes professionnelles et résidentielles » bien décrite dans l’ouvrage de Nicolas Rehany Les gars du coin. Enquête sur une jeunesse rurale. 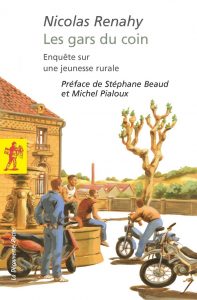 Les effets de cette dissociation ont été particulièrement importants là où un patronat paternaliste avait tout fait pour fidéliser et fixer la main d’oeuvre. Conséquence du départ des industries ou de leur réorganisation (précarisation, fin des avantages à l’embauche des locaux) « l’isolement géographique qui était loin de constituer un handicap pour des populations ouvrières disposant somme toute d’un capital d’autochtonie monnayable sur un marché de l’emploi stabilisé se transforme en isolement social lorsque l’économie se distend des réseaux localisés. » (Nicolas Rehany)
Les effets de cette dissociation ont été particulièrement importants là où un patronat paternaliste avait tout fait pour fidéliser et fixer la main d’oeuvre. Conséquence du départ des industries ou de leur réorganisation (précarisation, fin des avantages à l’embauche des locaux) « l’isolement géographique qui était loin de constituer un handicap pour des populations ouvrières disposant somme toute d’un capital d’autochtonie monnayable sur un marché de l’emploi stabilisé se transforme en isolement social lorsque l’économie se distend des réseaux localisés. » (Nicolas Rehany)
Cette fin relative du couple habitat/travail, qui est au centre de la « crise des gilets jaunes » et dont nous aurons l’occasion d’étudier divers effets au fil de cet abécédaire, d’une socialisation intimement associé au salariat ou a l’activité agricole si elle dévalue effectivement le capital d’autochtonie, aboutit toutefois à survaloriser cette dernière comme substitut aux identités ouvrières et paysannes démantibulées dans la restructuration, ouvrant ainsi la voie au « on est chez nous » lepéniste qui n’apparaît d’ailleurs que comme une déclinaison de plus d’un phénomène mondial bien décrit il y a presque vingt ans par Jean-François Bayart et Peter Geschiere: « Qu’y a-t-il de commun entre les îles Fidji et le Kosovo, la région des Grands Lacs en Afrique et le Caucase, la province indonésienne d’Aceh et la Corse, Jérusalem et Bruxelles, le Vlaams Blok de la Flandre belge et la Ligue du Nord italienne, le général ivoirien Robert Gueï et le tribun français Jean-Marie Le Pen ? Le recours à l’idée d’autochtonie et à l’argument d’antériorité de peuplement pour instituer et légitimer des droits politiques spécifiques à l’avantage de ceux qui se disent indigènes. Et pour exclure ceux que l’on étiquette comme allogènes, la parole de ces derniers important peu en l’occurrence. Les conflits – politiques, agraires, commerciaux, voire religieux ou culturels – s’énoncent alors non plus sur le mode du « ôte-toi de là que je m’y mette », comme dans les colonisations de peuplement classiques, mais sur celui du « ôte-toi de là que je m’y remette ». (« J’étais là avant » Problématiques politiques de l’autochtonie » )
Reste à voir dans quelle mesure le mouvement, ô combien cocardier, des gilets jaunes, a éventuellement permis de changer la donne en déstabilisant quelques piliers de cette autochtonie de substitution.

Laisser un commentaire