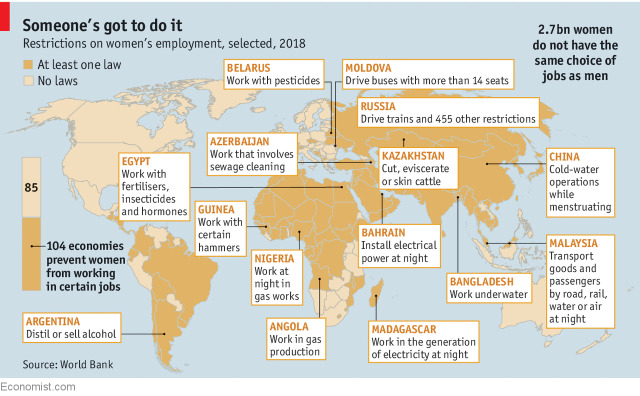La couverture qui illustre ce texte est celle du premier numéro du journal Nüzo Shijie (Le Monde des Femmes) paru en janvier 1904 à Shanghai. Les chercheurs de l’université de Heidelberg qui ont entamé un travail de scanérisation des journaux féminins chinois du début du XX ème siècle donne cette description de la trajectoire significative de la revue : « Avec un total de 18 numéros publiés de 1904 à 1907, Nüzo Shijie a l’honneur d’être de loin celui qui a connu la plus grande longévité parmi la vingtaine de journaux féminins qui apparurent dans la dernière décennie de l’ère Qing. Plusieurs de ses contributeurs réguliers devinrent des figures importantes du monde culturel après la chute de la dynastie. On y comptait notamment les poètes Gao Xie ( 1879-1958), Gao Xu ( 1877-1925) et Liu Yazi ( 1887-1958), les deux derniers étant les co-fondateurs de Nanshe, la société républicaine de poésie (1909-1923). Bien que le comité de rédaction ait été contrôlé par des hommes, comme la plupart des journaux de la fin des Qing et des débuts de la période républicaine, Nüzo Shijie fut le troisième journal à émerger au tournant du siècle qui visait spécifiquement les femmes comme lectorat, suivant en cela les traces de deux journaux édités par des femmes Nüxuebao 女學報 and 女報 . Nüzo Shijie publiait régulièrement des appels à contribution dans tous les styles – essais, poèmes, chansons, programmes scolaires de même que d’autres documents concernant l’éducation des femmes et des photos de classe. Les étudiantes et les professeurs des nouvelles écoles d’un peu partout en Chine répondirent régulièrement à ces appels à contribution. »
Même lorsqu’ils étaient dirigés par des hommes, ces journaux contribuèrent effectivement au « désenclavement » social et psychologique des femmes chinoises, comme le souligne Charlotte E. Beahan : « Les nouveaux journaux pour les femmes s’adressaient à celles-ci comme étant partie intégrante de la société, leur donnant des informations sur le monde par delà les barrières des quartiers des femmes, favorisant un sentiment d’identification collective et fournissant de nouvelles alternatives à la vie de confinement physique et intellectuel dictée par la tradition. »
D’ailleurs leurs promoteurs ne manquaient pas d’ambitions, ainsi Chen Xie-fen, la première femme à fonder et en partie rédiger elle même une revue, Nüxue bao ( Journal des études féminines) – et qui fut par ailleurs une des administratrices de l’école patriotique pour filles de Shanghai- indiquait en avril 1903 : « J’écris pour exhorter mes 200 millions de sœurs… J’espère sincèrement que vous pourrez toutes me lire et agir en conséquence. » Bien entendu l’analphabétisme dominant dans la majeure du pays et la diffusion très restreinte ( quelques milliers d’exemplaires au mieux) réduisaient l’audience de cette presse au monde urbain et aisé. Néanmoins, couplé au développement de l’éducation et plus ouvertes que leurs prédécesseurs, exclusivement contrôlés et rédigés par des hommes, à l’expression directe des femmes, ces revues de la première décennie du vingtième siècle jouèrent un rôle non négligeable dans l’émergence d’une conscience féministe autonome.
Et, si à ses débuts, cette presse relaie encore principalement le discours nationaliste mâtiné de préoccupations pour les droits des femmes qui dominait à l’époque, elle va progressivement se radicaliser. Ainsi Chen Xie-fen, très influencée au départ par les thèses de Liang Qichao ( voir post à ce sujet sur ce blog), change de ton une fois qu’elle est obligée de s’exiler au Japon et qu’elle prône désormais, avec des accents parfois clairement xénophobes, le renversement de la « dynastie Mandchoue », : « Les femmes chinoises vivent à dans une époque de révolution, si elles unissent leurs esprits et saisissent l’opportunité, développent leur force et remplissent leur cœur de haine venimeuse, détruisant et organisant, alors celles qui ont fait verser le sang, qui ont accomplies leur mission, doivent devenir les égales des hommes. Si dans une période de changement, elles assument leurs responsabilités à l’égale des hommes, alors leurs droits devront être égaux aussi. »
De même, on trouve dans une autre revue fameuse de l’époque, Le monde des femmes fondée par Ding Chu-o, un appel original à la « révolution familiale », que résume Charlotte E. Beahan :
« Le monde des femmes appelait à une révolution familiale contre l’autocratie domestique comme nécessaire au bien-être national, qui dépendait lui même d’une révolution contre l’autocratie politique :
« Hélas, qu’est ce qu’une révolution ? C’est le prix à payer pour avoir des droits, l’opposé de l’esclavage… de fait ceux qui ne connaissent pas l’oppression de l’autocratie n’ont pas besoin de croire à la révolution, ceux qui ne vivent pas sous les nombreuses couches d’oppression autocratique n’ont pas besoin de croire à la révolution féminine de la famille… Pour construire un pays, construisez d’abord la famille, pour produire des citoyens, produisez d’abord des femmes. »
Ding Chu-o était consciente du rapport entre l’autocratie politique et celle du pater familias chinois :
« La révolution politique émerge directement de l’oppression des lois monarchiques, tandis que la révolution de la famille émerge indirectement de celles-ci… car regardez la prétention du chef de famille, il tient indirectement son pouvoir tel un second prince. » La révolution de la famille devait se diriger contre les multiples couches d’oppression telles qu’exercées par les pères, les frères, les beaux-parents et le mari. La première étape serait la liberté du mariage, suivie ensuite de l’éducation, de l’activité sociale et économique. Mais il n’était pas mentionné comment ces changements devaient être initiés si ce n’est que la révolution familiale n’aurait pas besoin d’être violente, contrairement à la révolution politique qui lui succéderait. La famille en tant que telle serait gardée, mais reformée d’une façon qui n’était pas précisée. L’action individuelle serait la clé.
« Si vous voulez la révolution nationale, il faut d’abord la révolution familiale ; si vous voulez la révolution familiale, il faut d’abord une révolution personnelle. » (Feminism and Nationalism in the Chinese Women’s Press, 1902-1911 p 19-20 )
On pourrait enfin citer également Le journal de la femme chinoise fondé par Qiu Jin ou le quotidien Le journal de la femme de Pékin à la direction totalement féminine, toutes ces publications partageant sensiblement les mêmes thèmes et inclinaisons ( nationalisme, critique modérée du confucianisme mais aussi fascination pour les femmes terroristes de la Russie de l’époque).
Dans ce paysage, c’est bien évidemment Tianyi ( Les Principes Naturels) publié à partir de 1907 par He-Yin Zhen et ses camarades depuis le Japon, qui paraît et de très loin, la plus en pointe. He-Yin Zhen refuse de subordonner la lutte des femmes à la lutte nationale, de même qu’elle ne place pas non plus ses espoirs dans l’émergence d’un capitalisme modernisateur autochtone calqué sur les modèles japonais ou occidentaux. Sa critique systématique du système confucéen est une des toutes premières de l’histoire chinoise et préfigure toutes celles qui écloront dans les années 10 et 20. Et plutôt que de prôner égalité des droits ou meilleure intégration, c’est la destruction de toute forme de domination qu’elle défend : « Selon mon point de vue, l’objectif ultime de la libération des femmes est de libérer le monde de la domination des hommes et des femmes. » Si sa voix est probablement resté très marginale à l’époque, les thèmes qu’elle développe deviendront par contre dominants dans la presse féminine et intellectuelle des décennies suivantes…
Sources :
Charlotte E. Beahan « Feminism and Nationalism in the Chinese Women’s Press, 1902-1911 » Modern China Vol. 1 N°4, 1975
Elisabeth Croll Feminism and Socialism in China. Schoken Books
Catherine Gipoulon Qiu Jin. Pierres de l’oiseau Jingwei. Femme et révolutionnaire en Chine au XIXe siècle, des femmes
He-Yin Zhen La revanche des femmes, Éditions de l’Asymétrie
Ono Kazuko Chinese Women in a Century of Revolution. 1850-1950, Stanford University Press
Jacqueline Nivard. « L’évolution de la presse féminine chinoise de 1898 a 1949. » Etudes Chinoises, Association Francaise d’études chinoises, 1986, Vol. 5 N° 1-2
Rong Tiesheng « The Women’s Movement In China Before and After The 1911 Revolution » Chinese Studies in History Vol. 16, N° 3-4, (1983)